-
Co
chevron_right
Aron v. Hayek : une conversation sur la liberté du libéralisme
ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Wednesday, 22 February, 2023 - 03:50 · 9 minutes
L’actualité politique française, tout imprégnée d’antilibéralisme et friande de raccourcis journalistiques, a souvent tendance à réduire le libéralisme à une sorte d’idéologie politique homogène destinée à imposer le marché comme un dogme et les libertés individuelles comme une morale publique ne souffrant aucune discussion contradictoire.
C’est passer sur son histoire, ses nuances et ses théorisations sous le rouleau compresseur de l’opinion commune pour en oublier sa richesse philosophique et son inventivité fondamentales.
Plutôt que de reprendre la rhétorique illibérale du « néolibéralisme triomphant », pour mieux le comprendre, il convient de reprendre à Montaigne son idée de « conversation 1 » à plusieurs voix au sein d’une même tradition intellectuelle, parfois concordantes, souvent discordantes, pour rendre compte de l’émergence de la liberté individuelle comme principe d’organisation du monde social et politique.
Afin de participer pleinement à cette conversation, arrêtons-nous par exemple à la divergence de positions entre deux grands philosophes libéraux sur la définition même de la liberté.
Dans ses essais sur la liberté Raymond Aron se fait critique de Friedrich Hayek , qu’il estime réduire à sa seule dimension économique. Nous exposerons ici rapidement sa thèse, mais à notre tour nous tenterons d’en montrer aussi les limites, là encore sans quitter la conversation libérale sur ses propres fondements.
Aron reproche en particulier dans la recension 2 qu’il fait de La Constitution de la liberté de définir la liberté uniquement comme une absence de contrainte arbitraire, oubliant de ce fait quatre autres dimensions directement connectées à la contrainte elle-même, faisant des libertés une réalité plurielle.
Les libertés selon Raymond Aron
Pour Raymond Aron , il existe aussi une liberté intérieure, c’est-à-dire le pouvoir de penser librement, ce qui implique une éducation à l’autonomie pour la faire vivre.
Il y a également une liberté politique qui consiste à permettre aux individus de participer pleinement à l’exercice de la vie politique comme à la désignation de ses représentants.
Trosièmement, la liberté est une capacité, c’est-à-dire une puissance d’agir, qui, comme le rappelle Gwendal Chaton 3 , « nécessite généralement l’intervention de l’État, souvent la seule entité à même de garantir l’effectivité d’un ensemble de libertés qui demeurent sinon strictement formelles ».
Enfin, Raymond Aron, grand penseur des relations internationales, ajoute à ces libertés celle nationale, qui exige qu’une nation soit souveraine, c’est-à-dire à la fois gouvernée par un groupe restreint de dirigeants et préparée à l’éventualité de la guerre pour conserver ses libertés menacées.
La liberté dans tous ses états
Commençons par observer que la critique adressée à la définition hayékienne de la liberté se retrouve dans toute la littérature libérale, qui lui reproche essentiellement son caractère flou ou limité.
Anthony de Jasay observe 4 par exemple que si celle-ci nous donne une bonne indication sur le fait que la coercition en elle-même ne peut être perçue comme bonne par elle-même, son indétermination laisse le champ libre à ce sur quoi elle s’applique.
Imaginons que la coercition s’applique uniquement à tuer des individus innocents, sa nature « minimale » n’est pas entamée. Rien dans sa définition ne nous dit qu’elle doit s’apposer à des domaines aussi variés que la propriété, la santé publique ou tout autre domaine jugé nécessaire par ceux qui s’en réclament. Inversement, rien n’indique que l’application du droit libéral (les règles de juste conduite) demande une limitation de principe pour en faire respecter le caractère obligatoire en société.
Seulement, Aron dans sa critique nous semble davantage insister sur la coercition que sur la condamnation de l’arbitraire de la contrainte, terme pourtant tout aussi important dans la définition qu’il donne de la liberté dans les premières pages de La Constitution de la liberté , à savoir : « l’état de choses dans lequel un homme n’est pas soumis à la volonté arbitraire d’un autre, ou d’autres hommes » (c’est nous qui insistons). Le défenseur intransigeant de la rule of law et l’admirateur du parlementarisme libéral n’est pas un admirateur de Thomas Hobbes, il ne partage pas sa conception de la liberté comme uniquement absence de contrainte 5 .
Parler de contrainte arbitraire présuppose que c’est à la fois le pouvoir politique discrétionnaire de certains sur d’autres qui est condamné et qu’il est possible d’accepter un certain type de contrainte, certes minimale, mais qui réponde à des exigences de légitimité qui dépasse à la fois la simple liberté comme absence de contrainte ou comme coercition minimum.
Par son caractère expéditif, la définition hayékienne de la liberté est imparfaite mais présuppose tout de même implicitement l’acceptation des règles formelles du droit libéral, qu’il s’attachera par la suite à développer dans Droit, Législation et liberté .
Pour se réaliser, la liberté doit être protégée dans un cadre institutionnel où les interférences discrétionnaires de l’État sont contraintes par certains types de lois, et doit répondre aux développements sociaux spontanés de l’individualisme (les règles de juste conduite), ce qui offre une précision importante quant au caractère minimal de la coercition nécessaire à l’existence de la liberté : c’est l’interférence politique qui doit être limitée, car mère de toute oppression du fait du caractère central que lui confère le monopole étatique de la violence.
L’État démasqué
C’est de cette défiance fondamentale que découle la différence d’analyse entre Aron et Hayek.
Le premier, en disciple de Max Weber , observe à l’endroit de l’État comme à ses justifications idéologiques une révérence que n’a pas Hayek et qui aura totalement disparu sous la plume de ses successeurs intellectuels, en particulier les théoriciens de l’ école des choix publics comme Gordon Tullock ou James Buchanan.
Le second, en anglophile accompli, tente de rendre compte de l’autonomie comme de la rationalité évolutive de la société par rapport à un État qui se pense toujours comme son inventeur et son ordonnateur essentiel.
En effet, dans les différentes libertés énumérées par le libéral français, toutes ont en commun de faire de l’État un partenaire indispensable, que ce soit comme éducateur, arbitre entre les conflits d’intérêts ou encore tuteur indispensable à la création des libertés.
Autonomie, démocratie, souveraineté
Comme le fait Raymond Aron, doit-on associer étroitement liberté et autonomie individuelle ?
Pour le philosophe Jan Narveson 6 , la confusion entre les deux est très commune. Seulement, rien n’indique qu’il faille contraindre tout le monde à subordonner la liberté comme choix personnel à la réalisation de l’autonomie comme valeur ou bien ultime. Si X se choisit comme fin l’autonomie, rien ne lui donne le droit de l’imposer à Y comme une catégorie morale objective nécessitant intervention et donc coercition de l’État. Libre à chacun d’être Montaigne, ou pas. En tout cas, ce n’est pas à l’État de choisir pour nous.
Des institutions démocrates sont-elles la garantie de la liberté ?
De Constant à Hayek en passant par Tocqueville , le principe majoritaire associé à la démocratie est perçu autant comme menace, et donc conditionné à l’état de droit comme aux respects de droits fondamentaux, en particulier celui de la propriété. La réflexion engagée à la suite de Hayek, qu’on retrouve au sein des théoriciens du public choice , a montré que le marché politique institué par la démocratie fait de l’expropriation une condition essentielle pour établir le marchandage entre élus et citoyens. En proposant aux seconds des biens publics pour accéder au pouvoir les premiers élargissent naturellement l’assiette du pouvoir politique et des dépenses publiques au détriment de l’autonomie de la société civile et du marché.
En reprenant la distinction d’origine marxienne entre libertés formelles et libertés réelles, Raymond Aron indique que l’État a pour rôle social de corriger certaines inégalités de ressources qui entravent l’exercice effectif de la liberté individuelle.
Cela revient pour Anthony de Jasay à confondre « liberté » avec un certain type de droit, le droit pour certains individus de jouir de la propriété, ou d’une partie de la propriété d’autres individus que l’État expropriateur met à disposition des classes jugées dans une position moins favorable que les autres individus en société.
Il y a droit et non liberté car en contrepartie, le « correctif social » de l’État crée des obligations pour certains envers d’autres, et rompt avec le principe de libre échange économique. La question qui reste en suspens ici est donc de savoir sur quelle base l’obligation de fournir des biens publics à certaines catégories de la population peut être considérée comme juste ou optimale pour que la démocratie libérale continue de fonctionner en tant que telle.
La souveraineté nationale n’est pas nécessairement protectrice de la liberté individuelle. Le « libéral de guerre froide » Raymond Aron comprend la souveraineté nationale comme un bouclier contre les ingérences liberticides étrangères, on peut penser ici aux incursions de l’Union soviétique, mais ajoute se faisant à la notion une connotation qui n’existe pas dans le droit international public : le droit classique accordé au pouvoir politique de faire et de casser la loi sur son propre territoire ne présuppose absolument pas l’existence ou la conservation de libertés nationales établies.
Si dans certains cas, la souveraineté nationale se fait protectrice des libertés collectives locales, sous d’autres latitudes et dans d’autres circonstances, elle peut très bien se faire la protectrice de l’oppression et des pratiques dictatoriales. Qu’on pense par exemple à la physionomie contemporaine des relations internationales : ce sont aujourd’hui la Chine et la Russie qui se font les défenseurs les plus acharnés de la souveraineté nationale qu’elles opposent aux incursions étrangères nord-américaine et à l’idéologie libérale des droits de l’Homme qu’elles jugent corrosives pour leurs systèmes autocratiques de droit nationaux.
En résumé, le lien entre souveraineté et libertés est conjoncturel et non essentiel, et en faire un absolu comme le fait Aron ne signifie pas non plus la réduire à une simple « superstition » comme le fit Hayek.
Le fil de la conversation sur la liberté ne s’arrête pas au débat Hayek-Aron, loin de là. D’autres économistes, philosophes, penseurs et théoriciens ont repris la discussion qui ne s’est toujours pas interrompue et continuent encore aujourd’hui de l’enrichir par leurs réflexions et leurs critiques, avec patience et intelligence. Sans doute faut-il s’écarter du tintamarre médiatique pour l’entendre désormais, sa discrétion témoignant aussi, hélas, de sa marginalité croissante.
- Montaigne, Les essais , chapitre 8. ↩
- Raymond Aron, Archives européennes de sociologie, 1961. ↩
- Gwendal Chaton, Libéralisme ou démocratie ? Raymond Aron lecteur de Friedrich Hayek, Revue de philosophie économique, 2016. ↩
- Anthony de Jasay, Political Philosophy, Clearly. Essays on Freedom and Fairness, Property and Equalities, Liberty Fund, 2010. ↩
- Thomas Hobbes, Léviathan , chapitre 14. ↩
- Jan Narveson, The Libertarian Idea, encore éditions, 2001. ↩
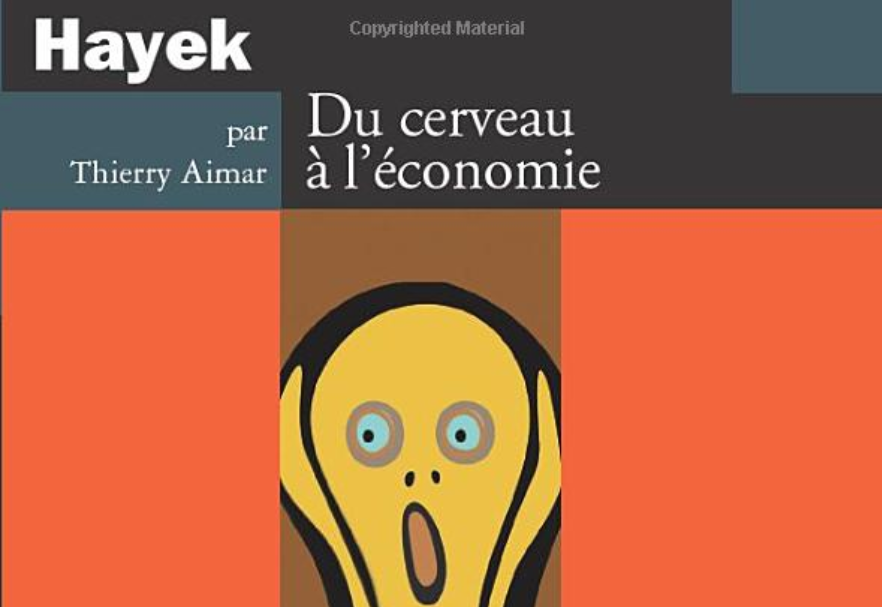










 Ceux qui pensent que, pour reprendre les termes de Hayek, « nous ne devons pas craindre le système mais le risque qu’il soit géré par de mauvaises personnes » sont des utopistes naïfs qui seront éternellement déçus par le socialisme.
Ceux qui pensent que, pour reprendre les termes de Hayek, « nous ne devons pas craindre le système mais le risque qu’il soit géré par de mauvaises personnes » sont des utopistes naïfs qui seront éternellement déçus par le socialisme.





