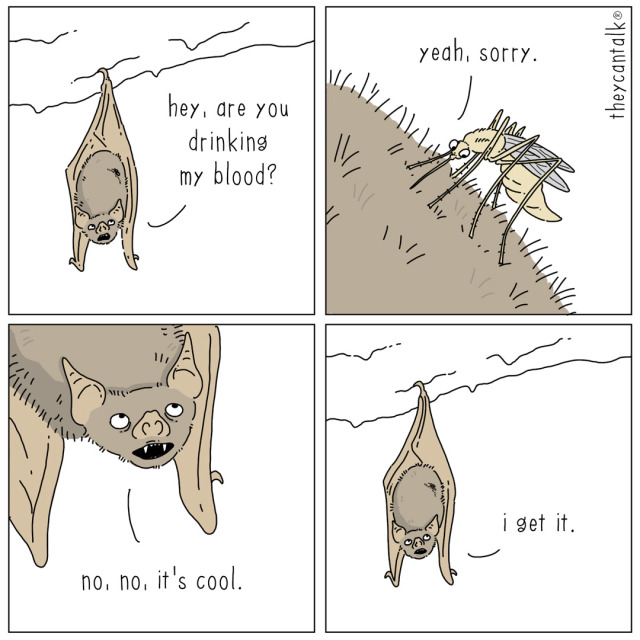-
 chevron_right
chevron_right
BD, comics, mangas… ce qu’il ne fallait pas manquer en octobre 2023
news.movim.eu / JournalDuGeek · Monday, 6 November - 15:31
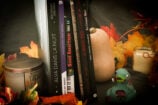

On a lu quoi en octobre ? Des bandes dessinées et des romans graphiques à faire frémir les lecteurs et les lectrices les plus courageux, mais aussi quelques romans graphiques plus légers.
BD, comics, mangas… ce qu’il ne fallait pas manquer en octobre 2023



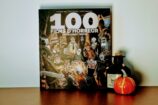
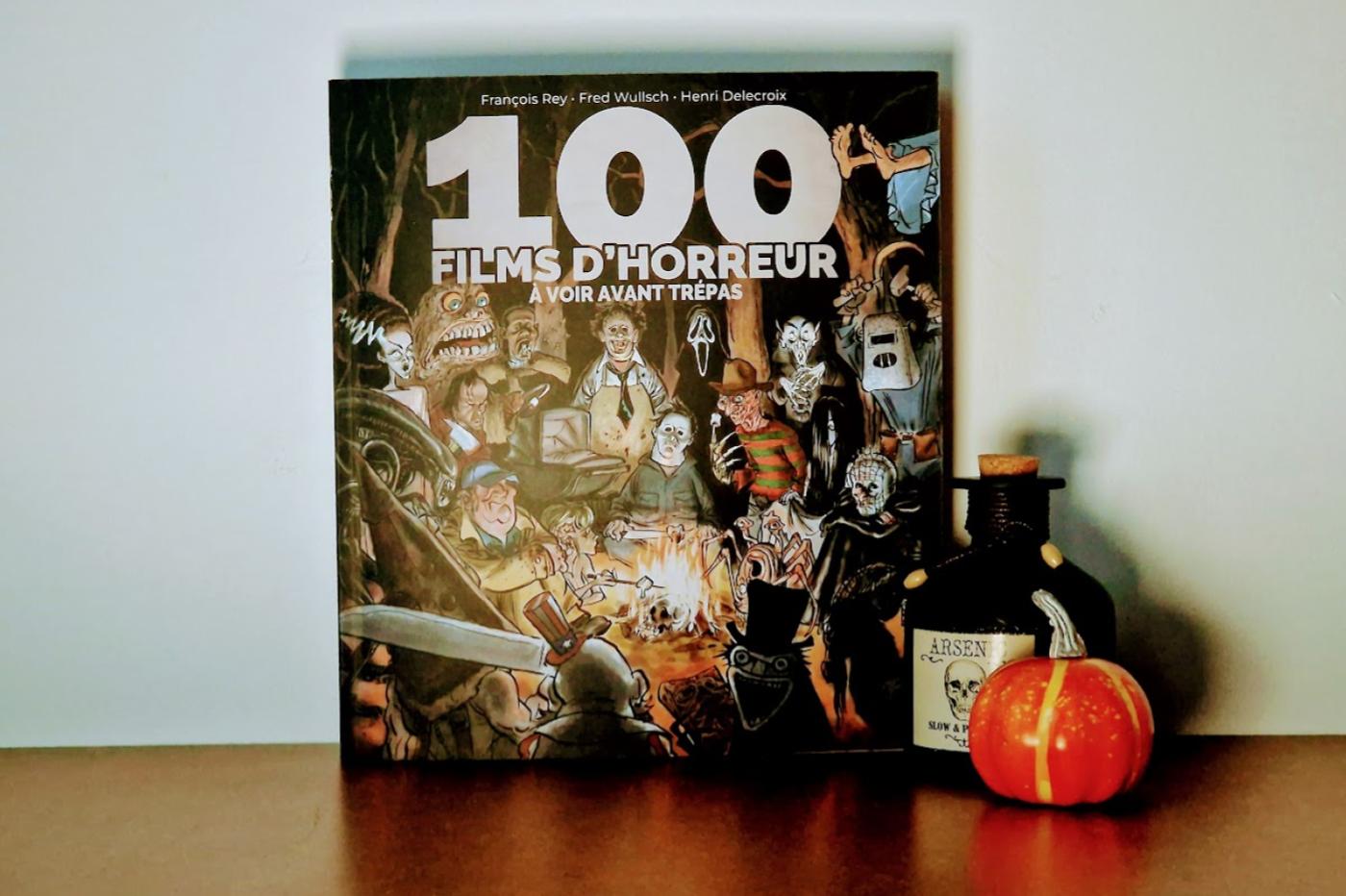

 ️
️