-
Co
chevron_right
Petit traité de libéralisme à l’attention de Sandrine Rousseau
ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Wednesday, 19 April, 2023 - 03:30 · 21 minutes
Le 5 avril 2023, la députée Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau a affirmé dans un tweet que « le libéralisme engendre le fascisme ».
Comment ne pas être résigné, tant ces manipulations sémantiques sont devenues choses courantes dans le paysage intellectuel et politique français ? Cette déclaration devrait susciter une hilarité à la hauteur du travestissement des mots qu’elle engendre. Pourtant, à l’exception de l’indignation de quelques braves libéraux sur les réseaux, le mutisme a régné, et rares ont été les réactions venues d’ailleurs.
Qu’une députée et universitaire puisse à ce point parodier le réel dans l’indifférence totale ne manque pas d’intriguer. En fait, tout porte à croire que ce silence est hautement significatif. Le libéralisme et ses variantes ( néolibéralisme , ultralibéralisme , turbo libéralisme , libéralisme sauvage …) sont devenus autant de qualificatifs vidés de leur sens et instrumentalisés péjorativement. C’est parce que l’antilibéralisme et ses lieux communs ont progressivement envahi l’univers mental collectif des Français qu’il est possible, en 2023, de soutenir qu’il y aurait continuité ou équivalence entre la philosophie libérale et le fascisme. Ce tour de passe-passe rhétorique prospère au prix d’une méconnaissance profonde de l’histoire, de la diversité et de la richesse de la pensée libérale.
50 nuances d’antilibéralisme
Ainsi n’est-il pas rare de lire ou d’entendre que le libéralisme ne serait qu’un vulgaire économisme se résumant à un « laisser-faire » immoral ; un individualisme forcené, construit sur une forme d’anarchisme sauvage et de darwinisme social, menant à l’atomisation du corps social et détruisant la fraternité et l’altruisme ; un « rouleau compresseur » 1 uniformisant et globalisant ; une pensée « conservatrice », « de droite » ; et enfin… le libéralisme serait le germe, le porte-parole, le concepteur, si ce n’est la réplique d’une forme de « totalitarisme ». Son bras armé ? La « dictature du marché ».
Si cette dernière idée reçue nous intéresse tout particulièrement, c’est qu’elle procède d’une véritable inversion des valeurs : en réalité, le libéralisme est l’opposé le plus chimiquement pur du totalitarisme ou du « fascisme », pour reprendre les mots de madame Rousseau.
Plutôt que de réfuter ce qu’il n’est pas , tâchons plutôt de rappeler ce qu’est le libéralisme en évoquant succinctement ses fondations conceptuelles, tout en gardant à l’esprit que, par-delà ce socle commun, la pensée libérale brille par sa diversité, et son histoire est caractérisée par d’innombrables tensions sur des points de doctrines capitaux.
Le libéralisme est une défense de la souveraineté individuelle
« La liberté naturelle de l’homme, c’est de ne reconnaître sur terre aucun pouvoir qui lui soit supérieur, de n’être assujetti à la volonté de personne »
John Locke, Traité du gouvernement civil , 1690.
« Le but des anciens était le partage du pouvoir social entre tous les citoyens d’une même patrie : c’était là ce qu’ils nommaient liberté. Le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées ; et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances. »
Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes , 1819.
« J’ai défendu quarante ans le même principe, liberté en tout, en religion, en philosophie, en littérature, en industrie, en politique : et par liberté, j’entends le triomphe de l’individualité, tant sur l’autorité qui voudrait gouverner par le despotisme, que sur les masses qui réclament le droit d’asservir la minorité à la majorité. Le despotisme n’a aucun droit. »
Benjamin Constant, Mélanges de littérature et de politique .
Le libéralisme trouve son origine dans l’absolue nécessité de défendre la souveraineté de l’individu. Au XVII e siècle, John Locke (1632-1704) soutient, dans son Traité du gouvernement civil (1690) que chaque individu possède des droits naturels inaliénables (la vie, la liberté, la propriété) et assigne au gouvernement la mission d’en garantir l’existence.
Partant de ce constat, la souveraineté de l’individu débouche inévitablement sur la défense des libertés individuelles (liberté d’expression, d’association, de religion, de conscience, d’entreprendre…). Personne n’a exprimé avec plus de brio que Benjamin Constant (1767-1830) le contenu et la spécificité de cette « liberté des Modernes ». Cette dernière, contrairement à la « liberté des Anciens », se concentre sur la protection des droits individuels et la limitation du pouvoir de l’État. Pour Constant, les citoyens devraient être libres de poursuivre leurs propres intérêts et aspirations sans qu’un pouvoir ou une morale extérieure n’interfèrent. Pour ce faire, le pouvoir politique ne peut être absolu, quelle que soit sa source, là où la liberté des Anciens repose sur « l’assujettissement complet de l’individu à l’autorité de l’ensemble » 2 . Le libéralisme défend donc l’autonomie personnelle : à savoir, l’existence d’une sphère d’action propre à l’individu dans laquelle il peut se mouvoir à sa guise, vivre selon ses propres idéaux et convictions, du moment que cette liberté n’altère pas celle d’autrui.
Contrairement aux caricatures et aux lectures erronées du discours de Constant, La liberté des Anciens comparée à celle des Modernes n’est pas l’éloge d’un individualisme égoïste, de la monade, de l’être replié sur soi. Il avertit au contraire sur les dangers que court la liberté si elle ne s’investit pas dans les arcanes de la cité, dans l’administration de la chose publique. La liberté individuelle et la liberté politique vont de pair. Le citoyen et l’individu doivent cohabiter. Constant nous invite à ne pas mésestimer cette association : « Le danger de la liberté antique était qu’attentifs uniquement à s’assurer le partage du pouvoir social, les hommes ne fissent trop bon marché des droits et des jouissances individuelles. Le danger de la liberté des modernes, c’est qu’absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique » 3 . Ces nuances sont importantes puisqu’elles battent en brèche les caricatures d’un libéralisme et d’un individualisme atomiste, destructeurs du lien social et politique.
Mais pour qu’elle ne soit pas vidée de son contenu, cette liberté n’est pas une licence, une « liberté métaphysique » illimitée. Elle est encadrée par le réel , qui dessine les contours du faisable et du non-faisable. Et cette liberté va de pair avec la responsabilité individuelle, autre concept maltraité par de nombreuses mécompréhensions et caricatures. Celle-ci est, pour les libéraux, la condition sine qua non d’une liberté bien comprise : « seul un homme maître de ses choix est susceptible d’en recueillir les bienfaits et d’en subir les conséquences » 4 . C’est un point que ses adversaires négligent totalement lorsqu’ils opposent une « liberté réelle » à la « liberté sur le papier » des libéraux. Cette opposition est d’ailleurs intimement liée à l’expression d’un anti-individualisme fort, puisque la croyance en un individu socialement construit implique sa déresponsabilisation. C’est méconnaitre que les libéraux défendent la responsabilité individuelle sur le plan politique avant de la défendre sur le plan métaphysique. Autrement dit, d’un point de vue descriptif, un libéral pourrait totalement admettre l’axiome selon lequel la liberté individuelle n’existe pas réellement car chaque individu serait le produit de sa biologie et de son environnement, tout en continuant à prôner normativement que la responsabilité individuelle est une nécessité d’un vivre-ensemble respectueux des libertés individuelles.
Les libéraux ne s’accorderaient pas tous sur cette conception de la responsabilité (voir l’anthologie d’Alain Laurent, L’autre individualisme ). Mais ce qui nous importe ici est surtout de défaire l’idée selon laquelle les progrès récents des sciences sociales et des neurosciences rendraient caduques la notion libérale de responsabilité individuelle, et in fine de l’individualisme qu’elle implique.
Le libéralisme est un système de gouvernement
« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ».
Charles de Montesquieu, L’Esprit des Lois , 1748.
« Prions l’autorité de rester dans ses limites ; qu’elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d’être heureux ».
Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes , 1819.
Ce primat donné à l’individu et à sa souveraineté, traduit politiquement, est très loin de se résumer à un simple antiétatisme primaire. Au contraire, le libéralisme intègre la question étatique au cœur de ses préoccupations, et ce depuis ses origines. Seulement, si les libéraux ne s’opposent pas à la présence d’un pouvoir politique, ils s’attachent à lui poser des limites strictes.
L’émergence du libéralisme politique est intimement liée aux grands débats de la période moderne autour de la légitimité du pouvoir politique. Cette dernière ne résulte plus de l’onction divine ; la monarchie absolue perd de son prestige ; subsiste désormais le contrat social issu du consentement des individus. C’est le contractualisme . Thomas Hobbes (1588-1679) sera le premier théoricien à penser l’individu, né des nécessités de l’état de guerre – s’en prémunir pour sauvegarder sa personne – désormais devenu l’échelon légitime pour céder à l’État la prérogative de garantir sa sécurité via le contrat social. Suivra alors John Locke qui développera, dans sa version « libérale » du contrat social, l’existence de droits naturels inaliénables, qui consacrent dès lors une souveraineté et une dignité préalables à l’instauration de la société politique. En ce sens, l’absolutisme est rejeté dans ses fondations : il y a un droit qui précède l’État, et qui l’astreint. Si le gouvernement venait à sortir du cadre de ses attributions, ou s’il échouait à protéger ces droits, alors les citoyens seraient fondés à le renverser.
De ce souci de lutter contre le gouvernement absolu naîtra le besoin de limiter et de contrôler le pouvoir. Charles de Montesquieu (1689-1755) est sur ce point un penseur incontournable tant sa théorie de la séparation des pouvoirs a joué un rôle considérable dans l’histoire de la philosophie politique, établissant la nécessité de diviser le pouvoir entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Cet outillage institutionnel serait pour Montesquieu le moyen le plus efficace pour se prémunir contre toute forme de tyrannie. Cette théorie inspirera largement l’un des pères de la Constitution américaine de 1787, James Madison , à laquelle il ajoutera la défense du fédéralisme, autre moyen de partager et décentraliser le pouvoir politique.
Enfin, pour les libéraux, la séparation des pouvoirs ne saurait constituer un garde-fou suffisant. Il faut aussi et surtout inscrire dans le contrat qu’est la Constitution des limites fixes et indépassables au pouvoir afin de garantir les droits de l’Homme. Ils ajoutent ici, comme le fait merveilleusement Benjamin Constant (voir la citation ci-dessus), que le rôle de l’État n’est pas de « faire le bien », mais d’empêcher le mal en donnant aux individus les moyens de se réaliser et de rechercher leur bonheur. Comme le dit très justement Mathieu Laine dans son dictionnaire 5 , les libéraux s’intéressent davantage au contenu du pouvoir qu’à sa source.
C’est pour cette raison qu’ils se méfient de la « démocratie absolue » car la légitimité de la source du pouvoir ne l’empêche pas d’être tyrannique. Au contraire même, le surplus de légitimité que confère la décision prise de manière démocratique peut favoriser et justifier la négation des droits de l’individu au nom de l’intérêt général de la collectivité. Constant encore, dans ses Principes de politique (1806), met en garde contre « l’erreur de ceux qui, de bonne foi dans leur amour de la liberté, ont accordé à la souveraineté du peuple un pouvoir sans bornes » 6 . Si ces derniers ont « vu dans l’histoire un petit nombre d’hommes, ou même un seul, en possession d’un pouvoir immense, qui faisait beaucoup de mal ; […] leur courroux s’est dirigé contre les possesseurs du pouvoir, et non contre le pouvoir même. Au lieu de le détruire, ils n’ont songé qu’à le déplacer » 7 .
Dans son célèbre ouvrage De la démocratie en Amérique (1835), Alexis de Tocqueville fait part d’inquiétudes semblables au sujet du « despotisme de la majorité » : « Les démocraties sont naturellement portées à concentrer toute la force sociale dans les mains du corps législatif. Celui-ci étant le pouvoir qui émane le plus directement du peuple, est aussi celui qui participe le plus de sa toute-puissance. On remarque donc en lui une tendance habituelle qui le porte à réunir toute espèce d’autorité dans son sein. Cette concentration des pouvoirs, en même temps qu’elle nuit singulièrement à la bonne conduite des affaires, fonde “le despotisme de la majorité” » 8 . Pour lutter contre ce despotisme, Tocqueville affirme que « le pouvoir accordé aux tribunaux de se prononcer sur l’inconstitutionnalité des lois, forme encore une des plus puissantes barrières qu’on ait jamais élevée contre la tyrannie des assemblées politiques » 9 .
L’ordre spontané contre l’interventionnisme
« Le vice est aussi nécessaire dans un État florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une Nation célèbre et glorieuse. »
Bernard Mandeville, Fable des abeilles , 1714
« La liberté générale d’acheter et de vendre est donc le seul moyen d’assurer, d’un côté, au vendeur, un prix capable d’encourager la production ; de l’autre, au consommateur, la meilleure marchandise au plus bas prix. Ce n’est pas que, dans des cas particuliers, il ne puisse y avoir un marchand fripon et un consommateur dupe ; mais le consommateur trompé s’instruira et cessera de s’adresser au marchand fripon ; celui-ci sera discrédité et puni par là de sa fraude ; et cela n’arrivera jamais fréquemment, parce qu’en général les hommes seront toujours éclairés sur un intérêt évident et prochain. »
Turgot, Deuxième Lettre à un grand vicaire sur la tolérance , 1754
Si les principes du libéralisme politique font relativement consensus aujourd’hui, ceux du libéralisme économique sont au contraire presque unanimement rejetés, et c’est sur ce plan que madame Rousseau condamne le libéralisme dans son ensemble, « parce qu’il broie les humains, qu’il se fout des conséquences de son économie, que seul le court terme l’intéresse et surtout le profit et l’accumulation. Il détruit tout, de nos États sociaux à notre planète en passant par nos démocraties ». Cette diatribe ambiguë et désordonnée, qui ne fait que reprendre de manière confuse la panoplie des clichés sur la pensée libérale, cache en réalité une incompréhension des enjeux que recouvre le thème des libertés économiques.
Dans ce monde simpliste et manichéen que dessine maladroitement madame Rousseau, les libéraux ne seraient que des financiers cyniques, obsédés par les indices économiques, traversés par une vision statistique et mathématique de la réalité sociale et imprégnés d’un mépris pour le « bas peuple » n’ayant d’égal que sa fascination pour les « élites » dominantes. En fait, la défense du libre marché et d’une économie libérale est tout aussi fondée sur des arguments moraux et politiques qu’utilitaristes. Pour les libéraux, le marché est un outil au service d’un modèle socio-économique basé sur « l’ordre spontané », jugé plus juste, efficace et respectueux des libertés individuelles que son antithèse, l’interventionnisme.
Loin d’être une machine qui « broie les humains », le concept de marché désigne un « Espace abstrait qui désigne l’ensemble des transactions entre individus, il s’agit d’une procédure qui permet à chacun de découvrir et de recueillir des informations indispensables à sa propre action, […] il s’agit d’un processus de découverte » 10 . Murray Rothbard (1926-1995) explique ainsi que le « laisser-faire ou le libre marché ne supposent pas que chacun connaît toujours le mieux dans son propre intérêt, il affirme plutôt que chacun devrait avoir le droit d’être libre de poursuivre son propre intérêt comme il considère le mieux » 11 . Les libéraux reconnaissent donc l’imperfection du marché, mais ils jugent qu’aucun système socio-économique n’atteint son niveau d’efficacité et de justice.
L’adhésion au marché et la lutte contre l’interventionnisme sont en fait les pendants politiques d’une très riche réflexion épistémologique soutenant l’individualisme contre le constructivisme . La pensée de Friedrich Hayek (1899-1992) est à ce sujet inégalable. Pour le penseur autrichien, il suffit d’approcher l’immense complexité du monde, et donc notre incapacité à l’appréhender totalement, pour réfuter toute approche constructiviste. Il soutient ainsi que les planificateurs centraux ne disposent jamais de l’ensemble des informations nécessaires pour prendre des décisions économiques optimales, tant ces dernières sont nombreuses, dispersées et difficiles à identifier. Il oppose à cette planification étatique et centralisatrice le concept de catallaxie , qui désigne l’ordre spontané émergeant de l’infinité des interactions prenant place sur le marché. Les prix jouent un rôle important en tant que mécanisme de communication transmettant à l’ensemble des acteurs du marché les informations nécessaires à leurs actions, leur permettant de prendre des décisions « éclairées » sans l’aide d’un acteur central quelconque. Avec la catallaxie, Hayek illustre comment un ordre complexe et coordonné peut émerger des interactions volontaires et décentralisées des acteurs du marché.
Surtout, cette lutte contre l’interventionnisme s’inscrit dans une lutte contre la croissance du pouvoir étatique. En effet, les libéraux considèrent qu’il ne peut y avoir de libertés individuelles sans libertés économiques. Ils ajoutent que l’absence de ces dernières mène inévitablement à un système politique autoritaire. Lorsqu’Hayek soutient, dans La route de la servitude (1944), qu’un contrôle excessif de l’État dans l’économie conduit nécessairement à une perte de libertés individuelles, il s’inscrit dans la droite lignée de la défense des libertés modernes de Benjamin Constant. Produire et consommer sont des actes profondément intimes et personnels, et une trop grande intervention du pouvoir politique dans la vie économique correspond à une intrusion liberticide d’un pouvoir toujours arbitraire dans la vie des individus.
L’esprit totalitaire n’a pas disparu…
« Une élite, qui prétend édifier une société parfaite, incline d’autant plus à la brutalité qu’elle s’imagine viser une fin plus sublime. Du messianisme à la violence, de la violence à la tyrannie, la leçon n’a pas le mérite d’être neuve, et l’on n’ose même pas espérer qu’elle soit jamais retenue. »
Raymond Aron, Préface de Lénine et la IIIe Internationale (Branko Lazitch), 1950
Ces quelques lignes auront suffi à démontrer que, loin de tenir la main au fascisme ou au totalitarisme, le libéralisme s’est en fait bâti, tout au long de son histoire, contre toute forme de tyrannie. Les totalitarismes du XX e siècle se sont tous construits autour d’une vision constructiviste de l’Homme et de la société dans une perspective profondément antilibérale. Il est d’ailleurs marquant d’observer à quel point l’illibéralisme et la lutte contre « la bourgeoisie libérale » sont les dénominateurs communs du fascisme italien, du stalinisme soviétique et du national-socialisme allemand.
Contre ces visions totalisantes et autoritaires « prétendant édifier une société parfaite », les auteurs libéraux se sont soulevés sans aucune forme d’ambiguïté, reconnaissant bien que ces projets visaient à détruire l’individu pour en faire un simple outil au service d’un projet politique holistique. Ce n’est pas un hasard si, parmi les grands analystes du phénomène totalitaire et des religions séculières, on trouve nombre de penseurs libéraux : Élie Halévy, Ludwig Von Mises, Raymond Aron , Friedrich Hayek, François Furet, Jean-François Revel , pour ne citer qu’eux…
Les prises de position de madame Rousseau autour de la crise environnementale ou des enjeux autour de la défense des minorités montrent bien qu’à travers le contrôle de l’économie, il est en fait question de soumettre l’individu aux exigences d’un intérêt général toujours plus abstrait et arbitraire. N’y a-t-il pas, dans la volonté d’interdire certains types de productions et de consommations (on pense par exemple à la volonté d’ interdire les jets privés ), une vision profondément morale de l’économie, visant à distinguer des « pollutions légitimes » et des « pollutions illégitimes » selon des critères profondément arbitraires et subjectifs ? Dans le monde décroissant et égalitaire de madame Rousseau, quelle sera la place du divertissement sur YouTube ? Légitime ? Illégitime ? Que dira-t-elle à ceux qui veulent voyager ? Visiter de la famille sera-t-il plus légitime que de participer à un colloque universitaire à l’autre bout du monde ? Est-ce que des vacances studieuses dans des musées seront considérées comme plus légitimes que des vacances oisives sur une plage de sable blanc ? N’est-ce pas également une posture potentiellement totalitaire que de considérer que le privé est politique et que, ce faisant, aucun aspect de la vie ne devrait échapper au contrôle du pouvoir politique ? Ou encore, qu’en est-il de la liberté de conscience quand certains se réjouissent de l’apparition de sensibility readers dont le rôle est de réécrire des œuvres , dans le but très admis d’agir jusque dans l’inconscient des individus en expurgeant certains mots ou certaines idées d’œuvres classiques ?
Ces différents exemples tracent tous un même dessein : la volonté de contrôler l’ensemble de la réalité sociale afin de faire advenir une société parfaite, débarrassée de tous ses maux. Face à cette prétention totalisante, la pensée libérale apparaît plutôt comme un antidote à ces dérives pernicieuses. Pour ne prendre que l’exemple de la crise climatique (puisque madame Rousseau est députée écologiste) : plutôt que d’interdire la viande et les jets privés, de limiter la consommation de débit internet et d’imposer des pratiques, de manière égalitaire, au prix d’une négation totale des individus et de leurs aspirations profondes, les libéraux proposent l’instauration d’un prix carbone afin de laisser arbitrer le marché en donnant à l’ensemble des acteurs privés les informations nécessaires pour faire des choix informés et personnels selon leurs propres conceptions d’une bonne vie. Cette solution permettrait de concilier la sauvegarde des libertés individuelles aux enjeux climatiques, tout en conservant un système économique à même de favoriser les innovations qui seront nécessaires pour nous adapter aux bouleversements déjà enclenchés par le changement climatique et la perte de biodiversité. Madame Rousseau, loin de l’épouvantail que vous dressez et qui est infiniment plus aisé à combattre, le véritable libéralisme, pour qui veut l’appréhender avec un tant soit peu d’honnêteté et de curiosité, révèle une richesse, une vigueur, une force d’âme insoupçonnée qui, pour les « Hommes de bonne volonté », est une source inaltérable face aux maladies de notre temps.
Tâchons simplement de ne pas confondre le mal et le remède, car assurément, l’esprit totalitaire est ailleurs.
- On trouvera une liste des idées reçues les plus fréquentes sur le libéralisme dans l’excellent : Mathieu Laine, Dictionnaire du libéralisme , Paris, France, Larousse, 2012 ↩
- Benjamin Constant, De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes , 1819. ↩
- Benjamin Constant, De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, 1819. ↩
- M. Laine, Dictionnaire du libéralisme …, op. cit. , p. 526. ↩
- M. Laine, Dictionnaire du libéralisme …, op. cit. ↩
- Benjamin Constant, Principes de politique applicables à tous les gouvernements: version de 1806-1810 , Paris, Hachette Littératures, 2006. ↩
- Ibid. Constant Benjamin, Principes de politique applicables à tous les gouvernements: version de 1806-1810 , Paris, Hachette Littératures, 2006 ↩
- Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique , Paris, France, Garnier-Flammarion, 1981, vol. 2/. ↩
- Ibid. , p. 172. ↩
- Mathieu Laine, Dictionnaire du libéralisme , Paris, France, Larousse, 2012. ↩
- https://www.wikiberal.org/wiki/ Laissez-faire ↩







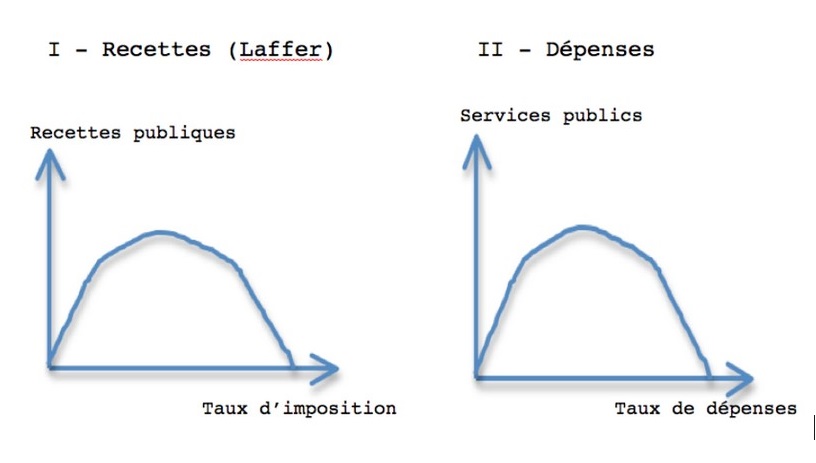 Comment est-ce possible ? On peut évoquer trois pistes, trois virus, trois maladies.
Comment est-ce possible ? On peut évoquer trois pistes, trois virus, trois maladies.


