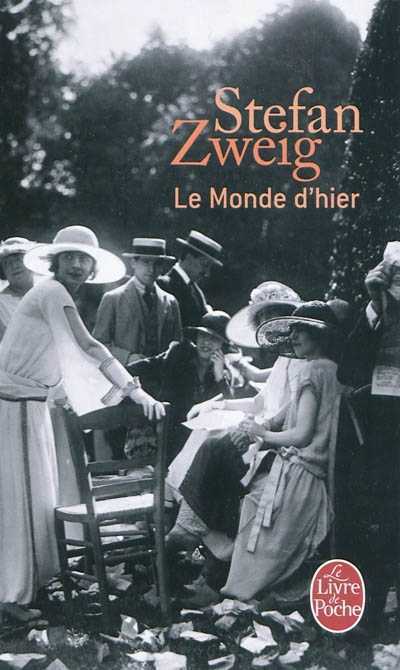La victoire d’
Erdoğan à la présidentielle turque a été analysée en Europe comme une simple conséquence de l’autoritarisme du régime, qui aurait emprisonné ses opposants, bâillonné les médias et bourré les urnes. Or, si Erdoğan est incontestablement un autocrate, une telle lecture omet de pointer l’incohérence du programme de l’opposition. Celle-ci ne proposait en effet aucune solution à la question kurde et se contentait de promettre un retour au néolibéralisme le plus traditionnel.
Article du journaliste turc Cihan Tuğal,
publié par la New Left Review
et traduit par Piera Simon-Chaix.
La Turquie n’en a pas fini avec les difficultés. Le 28 mai dernier, Recep Tayyip Erdoğan a été réélu pour un troisième mandat avec 52 % des voix au second tour des élections, tandis que le candidat de l’opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, obtient 48 % des votes. Alors que la plupart des sondages avaient anticipé un retournement de la majorité parlementaire, la coalition gouvernementale nationale-islamiste a conservé sa majorité avec 320 sièges sur 600 (contre 344 lors de la précédente législature). Et même si Kılıçdaroğlu a obtenu davantage de suffrages que les précédents concurrents d’Erdoğan lors de l’élection présidentielle, son parti n’a pas été à la hauteur des attentes puisqu’il n’a obtenu que 25 % des voix aux législatives, contre 30 % des suffrages lors des municipales de 2019. L’opposition était convaincue que la hausse brutale de l’inflation et le fiasco des
opérations de secours après le tremblement de terre
lui offrait une occasion inédite de battre Erdoğan. Pourquoi ces espoirs se sont-ils révélés infondés ?
L’endurance du régime ne tient pas uniquement à son autoritarisme.
Il existe tout d’abord des raisons institutionnelles évidentes qui expliquent la résilience de l’erdoğanisme. Le gouvernement monopolise les médias de grande écoute et le pouvoir judiciaire depuis des années. Les prisons débordent de militants d’opposition, de journalistes et de politiciens. L’opposition kurde, la seule force organisée du pays à ne pas pencher à droite, a vu ses maires démocratiquement élus remplacés par des agents nommés par l’État, qui ont consolidé l’emprise du gouvernement sur les provinces de l’Est et du Sud-Est. Il ne s’agit cependant que de la partie visible de l’iceberg :
l’endurance du régime ne tient pas uniquement à son autoritarisme. Sa popularité est bien plus profonde. Pour le comprendre, il faut tenir compte de trois facteurs majeurs que la plupart des commentateurs et des politiques refusent d’envisager.
Le premier facteur est économique. En plus de recourir aux programmes d’aide sociale pour s’arroger la confiance des fractions les plus pauvres de la population, l’administration d’Erdoğan a intégré des
outils de capitalisme d’État
dans son programme néolibéral. Cette combinaison a permis de maintenir la Turquie sur un chemin certes peu conventionnel, mais toujours praticable malgré les aléas rencontrés. Le régime a ainsi mobilisé des fonds souverains, mis en place des substitutions aux importations et opté pour des incitations ciblées dans certains secteurs, tels que la sécurité et la défense. Il a également abaissé les taux d’intérêt et soutenu la production des industries
low tech
comme la construction. Si ces mesures ont rebuté les économistes orthodoxes et la classe managériale, elles ont renforcé l’emprise de l’AKP sur les petites et moyennes entreprises et les capitalistes dépendants de l’État, ainsi que sur leurs travailleurs.
Le deuxième facteur est géopolitique. La
politique étrangère
du gouvernement, qui vise à établir la Turquie comme une grande puissance et un médiateur indépendant entre l’Orient et l’Occident, vient compléter son nationalisme économique. Bien sûr, la Turquie est en réalité dépourvue de la base matérielle nécessaire pour changer l’équilibre mondial des forces. Malgré tout, les partisans d’Erdoğan le présentent comme un puissant faiseur de rois, tandis que les adeptes les plus fous le voient comme le prophète d’un empire islamique en gestation. Une telle illusion participe du maintien de l’aura du président, et permet d’étayer sa légitimité, en particulier parmi les franges les plus à droite de l’AKP.
Le troisième pilier de la puissance du régime est sociopolitique : il repose sur sa capacité à l’organisation de masse. L’AKP dispose d’une forte implantation locale et chapeaute une grande variété d’associations civiles : organismes de bienfaisance, associations professionnelles, clubs de jeunesse, syndicats… Le parti tire également profit de son alliance avec le parti d’extrême droite MHP (Parti d’action nationaliste), dont l’aile paramilitaire, les Loups gris, peut compter sur ses ancrages dans l’armée, l’éducation supérieure et les quartiers sunnites de classe moyenne. Pour les classes populaires, ces groupes sont synonymes d’un sentiment de puissance, de stabilité, de force et souvent d’avantages matériels, même en périodes de difficultés économiques. La seule mobilisation capable de les égaler est celle des organisations de masse kurdes (soutenues par leurs alliés socialistes dans les régions non-kurdes). Cependant, la prévalence du sentiment anti-kurde a pour l’instant entravé la formation d’un bloc contre-hégémonique rassemblant à la fois Turcs et Kurdes.
Pendant plus d’un an, la campagne électorale turque a occulté, voire exacerbé, les problèmes les plus urgents auxquels est confronté le pays. L’opposition traditionnelle, communément surnommée la Table des six, est composée de partis laïcs et de centre-droite. Elle est dirigée par le Parti républicain du peuple (CHP) de Kılıçdaroğlu, le parti fondateur de la République turque. Si le CHP penchait plutôt à gauche dans les années soixante, il a viré à droite à partir du milieu des années 1990, à la fois en matière de politique économique et sur la question kurde. Le deuxième parti le plus important de la coalition est İyip, une ramification laïque du MHP, qui s’enorgueillit d’être tout aussi nationaliste sans néanmoins recourir de la même façon à la violence politique. Deux des partis moins importants de la coalition sont des dissidents de l’AKP, menés par l’ancien vice-Premier ministre Ali Babacan et l’ancien Premier ministre Amet Davutoğlu. Malgré leur base électorale minuscule, ces partis ont pesé d’un poids significatif dans le programme de l’opposition.
Le programme peu enthousiasmant de l’opposition
Durant la campagne, la Table des six a refusé de débattre des conséquences sociales et écologiques des réformes libérales de la Turquie des quarante dernières années ; elle a mis sous le tapis le coût de la dépendance à l’égard des puissances occidentales (qui n’a guère changé malgré la proximité croissante d’Erdoğan avec la Russie) et ne s’est pas prononcée sur la question kurde. Escamotant tous les enjeux les plus saillants du jeu politique, l’opposition a promis de conduire une grande « réhabilitation » supposée guérir tous les maux de la Turquie
.
Les parties les plus explicites de son programme consistait à rétablir l’État de droit et à réhabiliter les institutions étatiques en engageant des administrateurs compétents pour remplacer les fidèles d’Erdoğan.
Même si Kılıçdaroğlu a saupoudré ses discours de vagues promesses de redistribution, cette approche néolibérale constituait le cœur de son programme de politique intérieure.
L’objectif implicite de l’opposition, cependant, consistait à revenir aux stratégies de développement national antérieures à 2010 et à rétablir des relations positives avec l’Occident. Le modèle économique des années 2000, élaboré par Babacan alors qu’il était une figure majeure de l’AKP, reposait sur une privatisation rapide, des afflux de capitaux étrangers et d’énormes déficits de la dette publique. Même si Kılıçdaroğlu a saupoudré ses discours de vagues promesses de redistribution, cette approche néolibérale constituait le cœur de son programme de politique intérieure.
La politique étrangère proposée par l’opposition était tout aussi faible. La Table des six a en effet adopté une ligne largement pro-occidentale et anti-russe qui revenait en pratique à approuver l’hégémonie états-unienne au Moyen-Orient. Dans un même mouvement, l’opposition laissait de côté les problèmes régionaux les plus urgents, tels que les incursions de la Turquie en Irak et en Syrie. Questionné sur ces enjeux, Kılıçdaroğlu a affirmé que les institutions étatiques, telles que l’armée, étaient entièrement indépendantes, et qu’il était donc impossible de faire des promesses en leur nom. La coalition nationale-islamiste d’Erdoğan a, en revanche, laissé le champ libre aux sentiments anti-occidentaux et s’est engagée à affermir l’influence turque sur la scène mondiale, avec une campagne reposant sur l’entretien d’un fantasme national de renaissance ottomane.
L’opposition espérait que la flambée de l’inflation et la mauvaise gestion publique, notamment du tremblement de terre, allaient mettre à mal la crédibilité du gouvernement. Mais le mécontentement soulevé par ces problèmes n’a finalement pas suffi à renverser le pouvoir en place. Il fallait une autre vision, substantielle, populaire, concrète. La Table des six n’en avait aucune. Son programme bancal et médiocre a scellé son destin.
La question kurde
L’opposition était également confrontée à une autre difficulté : le mouvement kurde. Les Kurdes étaient exclus de la Table des six depuis les débuts de l’alliance, même s’il était évident que Kılıçdaroğlu ne pouvait pas l’emporter sans leur soutien. En dépit du soutien du CHP et de ses alliés aux incursions militaires d’Erdoğan en Syrie et en Irak, la majorité des Kurdes considérait qu’il s’agissait d’un moindre mal et le parti kurde YSP et ses alliés socialistes ont apporté leur soutien à Kılıçdaroğlu quelques semaines avant les élections. Mais les négociations avec les Kurdes ont entraîné une fracture au sein de l’opposition. Le dirigeant du İyip, Meral Akşener, a ainsi quitté la Table des six juste avant l’annonce du YSP et n’est rentré dans le jeu que quelques jours plus tard. Lorsque les résultats du premier tour sont tombés — Erdoğan en tête avec une marge de 5 % —, de nombreux commentateurs ont fait remarquer que la tentative de Kılıçdaroğlu de conquérir les Kurdes lui avait coûté la base électorale nationaliste. De fait, les données suggéraient qu’un grand nombre de votants d’İyip avaient soutenu leur parti pour les élections législatives, mais sans donner leur voix à Kılıçdaroğlu pour les présidentielles.
L’opposition a entamé un virage vers l’extrême droite durant l’entre deux tours, dans l’espoir d’attirer les votes anti-syriens et anti-kurdes tout en espérant pouvoir garder les votes kurdes motivés par l’opposition à Erdoğan.
En réaction, l’opposition a entamé un virage vers l’extrême droite durant l’entre deux tours, dans l’espoir d’attirer les votes anti-syriens et anti-kurdes tout en espérant pouvoir garder les votes kurdes motivés par l’opposition à Erdoğan. Cette stratégie ambitionnait de récupérer les 5 % de voix du candidat radical anti-immigration Sinan Oğan, un ancien membre du MHP et seul autre candidat à la présidence au premier tour. Ayant échoué à obtenir le soutien d’Oğan lui-même, Kılıçdaroğlu a signé un pacte avec son partisan le plus en vue, Ümit Özdağ, en promettant d’expulser tous les migrants indésirables — Kılıçdaroğlu a avancé le chiffre de 10 millions — et de reprendre les politiques anti-kurdes d’Erdoğan. Les libéraux ont affirmé qu’il s’agissait d’une tactique électorale, et non d’un véritable engagement. Quoi qu’il en soit, la tentative a échoué. Seule la moitié des électeurs d’extrême-droite ont reporté leurs votes sur Kılıçdaroğlu au deuxième tour, tandis que ses appels du pied vers l’extrême-droite ont démobilisé les Kurdes, avec une participation en baisse dans les provinces de l’Est et du Sud-Est.
À présent, suite à sa défaite, l’opposition traditionnelle est prise entre un libéralisme impossible à perpétuer et un nationalisme hors de contrôle. Le premier repose sur un certain nombre de perspectives illusoires : adhésion de la Turquie à l’UE,
Pax Americana
au Moyen-Orient et modèle économique domestique dépendant de la faiblesse du crédit. La décennie la plus prospère de la Turquie, les années 2000, reposait sur l’argent frais de l’Occident et sur des niveaux élevés de dette publique et privée. Ce modèle est devenu impossible à cause du considérable essoufflement des flux monétaires mondiaux suite aux augmentations des taux d’intérêt en Occident. Le tournant nationaliste de l’AKP des années 2010 a eu lieu en réaction à cette évolution. Son industrie militaire et ses politiques de substitution des importations ont fourni la base matérielle de ses invectives contre l’Occident d’une part et les Kurdes d’autre part. À défaut d’un soubassement matériel équivalent, les franges nationalistes les plus à droite de l’opposition classique sont creuses. Avant le deuxième tour, il est devenu clair que l’opposition ne pouvait pas égaler la rhétorique anti-kurde du gouvernement et elle a alors tenté de faire son beurre des sentiments anti-syriens. Sans les soubassements nationalistes dont jouit le régime, ce pari était cependant voué à l’échec. Il a simplement eu pour effet de rendre l’extrême-droite encore plus légitime et de renforcer les fondations idéologiques de l’erdoğanisme.
La question qui se pose désormais à la Turquie est de savoir s’il existe la moindre chance de prendre un autre chemin non-libéral, non-nationaliste, tourné vers l’avenir plutôt que vers le passé. Au cours de son troisième mandat d’Erdoğan, le nationalisme économique orienté vers l’exportation dépendra de l’exploitation accrue du travail bon marché. En théorie, cela ouvre des possibilités d’organisation des classes subalternes, grandes oubliées de tous les partis traditionnels. Plutôt que d’imiter les politiques d’exclusion du gouvernement, les forces anti-Erdoğan pourraient consacrer leur lutte à l’inclusion des travailleurs et des Kurdes dans leur coalition. L’opposition, après avoir constaté son incapacité à égaler le président en exercice en matière de nationalisme, pourrait plutôt tenter d’introduire le mouvement kurde dans le champ de la politique « acceptable ». Elle s’est pour l’instant trop reposée sur les classes moyennes, les bureaucrates et les « experts » dans sa lutte contre le populisme autoritaire d’Erdoğan. La défaite historique de 2023 est le signe qu’une opposition viable doit avant tout élargir sa base de soutien.
 chevron_right
chevron_right