-
chevron_right
« Un conflit avec la Russie ne débuterait pas nécessairement sur le terrain militaire », avertit le premier ministre norvégien
news.movim.eu / Numerama · Monday, 19 February - 17:21
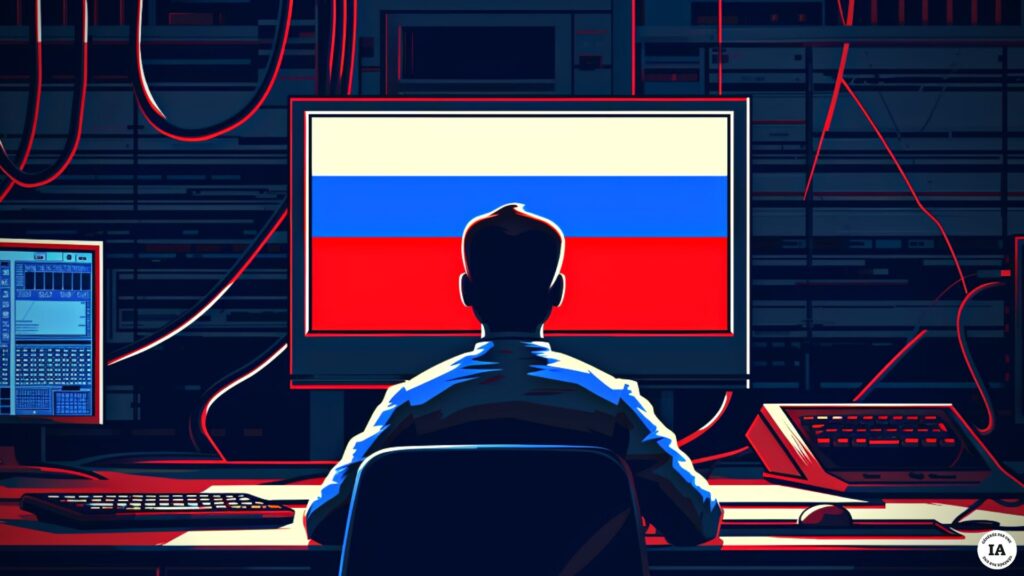
Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre a prévenu qu'un conflit avec la Russie commencerait par une déstabilisation avant tout affrontement militaire.

 Diana Shoshoake and the
Diana Shoshoake and the  on May 15
on May 15