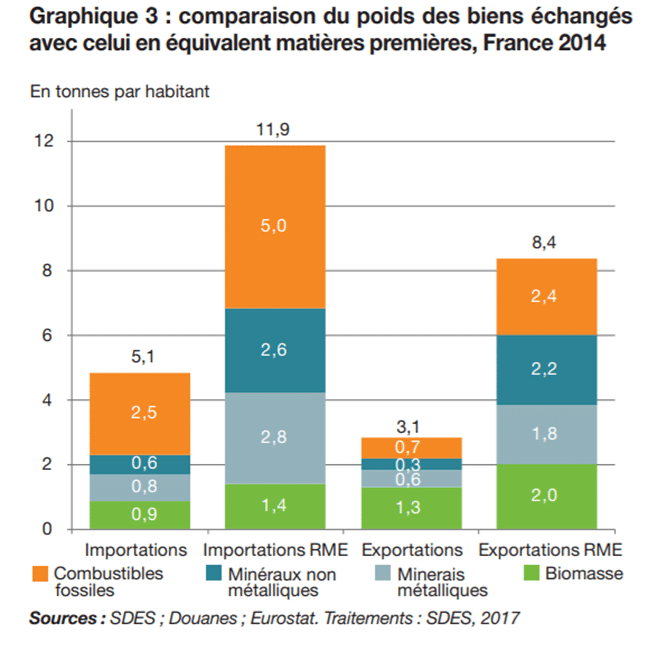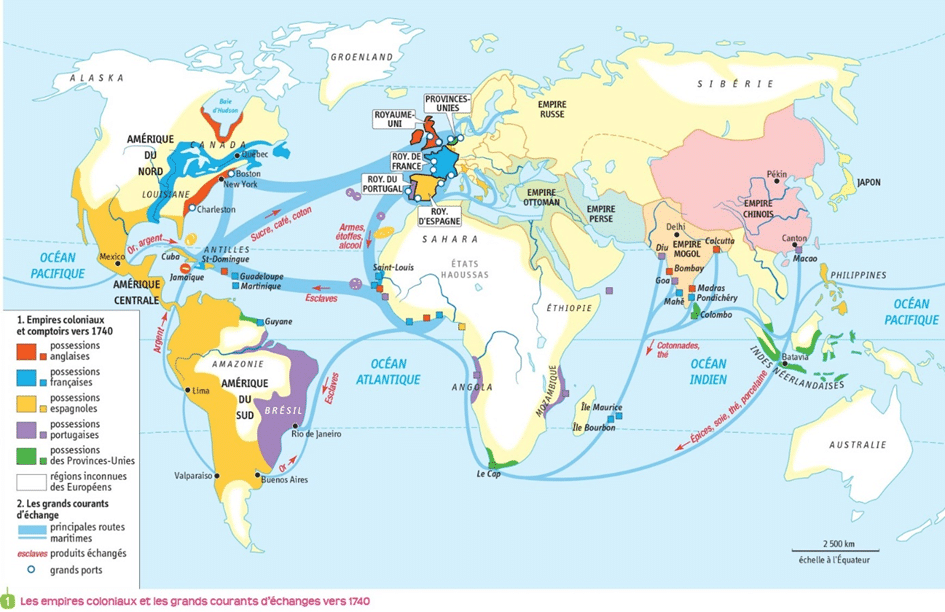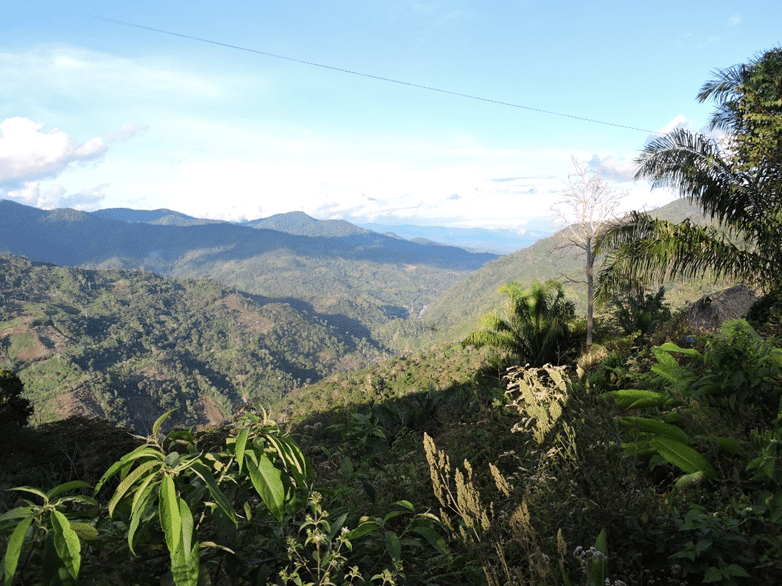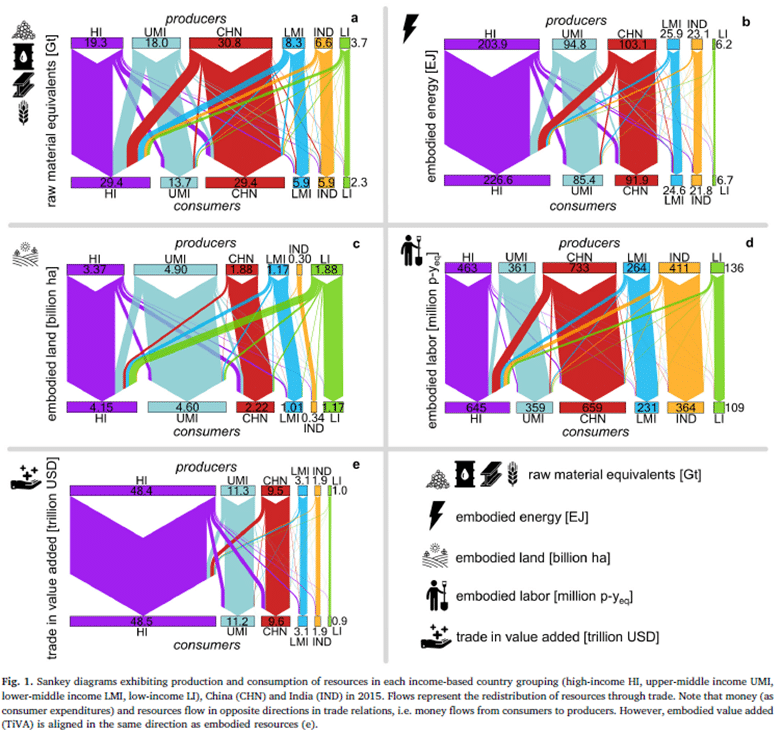Dérèglement climatique, perturbation du cycle de l’eau, sixième extinction de masse, pollution de l’air, des sols et des rivières. Récemment, le dernier rapport du GIEC nous donnait trois ans pour inverser notre courbe d’émissions de dioxyde de carbone pour limiter le réchauffement climatique à un niveau acceptable d’ici la fin du siècle. De même, les niveaux de pollutions atteints dans l’ensemble des écosystèmes ainsi que la baisse rapide de la biodiversité obligent à agir rapidement. Pourtant, la régulation des rapports économiques avec l’environnement nécessite de dresser un constat clair des causes de sa dégradation généralisée. Où faut-il les chercher ? C’est à une analyse sans concession du système à l’origine de cette rupture avec la nature – le capitalisme – qu’il faut se livrer, répondent les chercheurs éco-marxistes John Bellamy Foster et Brett Clark dans leur dernier livre,
Le pillage de la nature
, dont
la traduction française vient de sortir en avril aux Editions critiques.
Dans cet essai, ils se livrent à une analyse fine du lien entre le mode de production et de valorisation capitaliste et la destruction généralisée de la nature. Ils proposent une minutieuse enquête à partir des œuvres de Marx et Engels pour construire une matrice globale d’analyse de la crise écologique et sociale. L’objectif affiché est de proposer une synthèse plus générale de la pensée de Marx en intégrant les prémisses de la pensée écologique présentes dans son œuvre. L’utilisation des outils d’analyse issus du marxisme est intéressante à plusieurs titres. La matrice idéologique marxiste, et sa doctrine matérialiste, permet de penser l’interaction entre un mode de production, et donc notre rapport à notre environnement, et des rapports sociaux qui émergent de ce mode de production. Ce mode de production repose et est adossé à des conditions de reproduction d’ordre écologique et social, qui permettent de perpétuer le processus d’accumulation.
Exploitation du travail humain et expropriation de ses conditions de reproduction
Pour commencer, plonger avec Marx dans sa description de l’accumulation du capital s’impose. Chez Marx, le capitaliste investit son capital dans l’espoir d’en obtenir plus. La création de valeur supplémentaire, la survaleur (ou encore plus-value), se fait grâce aux travailleurs – seuls capables, par leur force de travail, de créer de la valeur et de transformer le capital (moyens de production et ressources apportées par le capitaliste). De là la célèbre formule marxienne d’accumulation du capital : A-M-A’ (Argent → Marchandise → Argent + plus-value), où la marchandise représente l’ensemble des moyens de production capitalistes – capitaux et travail humain. Chez Marx, le capital est avant tout un rapport social, caractérisé par la séparation des travailleurs d’avec les moyens de production (la propriété) et d’avec les produits de la production, le tout dans une visée lucrative de la propriété. C’est donc un rapport de subordination. Le capital, ce « processus circulatoire de valorisation », n’existe qu’en « suçant constamment, tel un vampire, le travail vivant pour s’en faire une âme ».
« Marx a toutefois une conscience aigüe que le mode de production capitaliste repose sur des conditions écologiques et sociales extérieures à sa sphère de valorisation. »
Pour Foster et Clark, Marx a toutefois une conscience aigüe que le mode de production capitaliste repose sur des conditions écologiques et sociales extérieures à sa sphère de valorisation. Pour que le cycle d’accumulation se perpétue indéfiniment, le système s’appuie sur des forces gratuites comme la nature ou le travail domestique, qui ne sont pas valorisées mais sont pourtant indispensables pour alimenter la machine A-M-A’. Tandis que dans son cycle de valorisation, le système du capital exploite le travailleur et la travailleuse, ce cycle nécessite aussi l’expropriation, le « pillage », de la nature. Les auteurs postulent l’existence d’une contradiction fondamentale entre la logique d’accumulation du capital et la préservation de ses conditions de reproduction écologiques et sociales. Foster et Clark distinguent dans le système capitaliste deux dynamiques complémentaires : une dynamique interne (à son circuit de valeur) qui le propulse reposant sur un rapport d’exploitation, et une dynamique externe reposant sur des conditions objectives qui « lui échappent et lui fixent ses limites », gouvernée par un rapport d’expropriation sans échange supposé équivalent. Cette expropriation se déroule en dehors du processus de production et de valorisation du capital. L’expropriation de la nature correspond à la « séparation entre les conditions inorganiques de l’existence humaine et son existence active » (le système économique, la sphère du travail), séparation qui est le fruit du développement du travail salarié et du capital.
Ainsi Marx distingue d’une part « l’exploitation de la force de travail dans l’industrie capitaliste moderne », différente de « l’expropriation au sens historique plus général de pillage ou vol en dehors du processus de production et de valorisation ».
Les auteurs avancent alors que le capitalisme sape ses propres fondations. Cette hypothèse s’appuie notamment sur les travaux précurseurs portant sur la « seconde contradiction du capitalisme » du penseur éco-marxiste James O’Connor (1992). Celui-ci détaillait déjà en 1992 comment « la logique du profit conduit le capital à refuser d’assumer les coûts de reproduction des ” conditions de production ” : force de travail, infrastructures, aménagement et planification, environnement. » Pour revenir à Marx, « le capital épuise les deux seules sources de toute richesse : la Terre et le travailleur ».
En cela, les auteurs rejoignent aussi l’analyse formulée par
Andreas Malm dans L’anthropocène contre l’histoire
. Malm explique que si le travail est « l’âme du capitalisme », la nature et les ressources qu’elle fournit en sont son corps. Sans la nature, les énergies et les ressources nécessaires à la mise en valeur du capital, le processus d’accumulation fondamental du capitalisme ne serait pas possible. Les énergies fossiles, qui permettent de démultiplier dans des proportions considérables la production d’un travailleur, sont l’adjuvant parfait et le corollaire nécessaire au processus de mise en valeur du capital par le travail humain. Le charbon et l’huile, plus tard le pétrole et le gaz, sont les auxiliaires de la production capitaliste. Ils sont, dit Malm, le « levier général de production de survaleur ». Ils sont les matériaux indispensables à la création de valeur capitaliste. En reprenant la terminologie de Foster et Clark, leur expropriation est une des conditions de reproduction indispensable du mode de production capitaliste.
Mais quelle est donc le mécanisme fondamental conduisant à une exploitation intensive systématisée des ressources naturelles ? Les chercheurs avancent que « les contradictions à la fois économiques et écologiques du capitalisme trouvent leur source dans les contradictions entre le processus de valorisation et les bases matérielles de l’existence indispensables à la production marchande capitaliste. ». Cette affirmation repose sur une analyse renouvelée de la théorie de la valeur marxiste. Il existe en réalité deux contradictions inhérentes à la machine capitaliste. La première, abordée ensuite, qui opère dans la sphère de la marchandise, intrinsèquement liée au processus de valorisation capitaliste, et la seconde, qui opère dans la sphère de la production, où les ressources naturelles sont surexploitées pour maximiser la productivité des agents.
Ainsi, la dissymétrie entre la logique du capital et l’environnement est issue du processus-même de valorisation du capital. Du point de vue théorique, le constat semble alors limpide. Alors que les conditions écologiques sont indispensables au déroulement de l’accumulation capitalistique, celles-ci ne sont pas prises en compte dans la sphère de valorisation du capital, au même titre que les autres conditions de reproduction à l’image du travail domestique principalement féminin.
Le paradoxe de Lauderdale
Au début du XIXème siècle, le comte de Lauderdale énonçait le paradoxe qui porte son nom qui stipule qu’il existe une corrélation négative entre la richesse publique et les fortunes privées. D’une part la richesse publique repose sur des valeurs d’utilité liées par exemple à l’abondance de l’air, de l’eau ou de jolies forêts, tandis que d’autre part, tout au contraire, les fortunes privées sont constituées à partir de valeurs d’échange, valeurs reposant sur le principe de la rareté. Lauderdale soulignait déjà ici la dialectique centrale de la théorie marxiste entre valeur d’usage et valeur d’échange. La logique du capital conduit alors à confondre valeur et richesse, dans un système fondé sur l’accumulation de valeurs d’échange, aux dépens de la richesse réelle. Le capitalisme se nourrit de la rareté et poursuit ensuite une logique de « marchandisation sélective » d’éléments de la nature. Les auteurs résument cela ainsi : « C’est l’opposition entre la forme valeur et la forme naturelle, inhérente à la production capitaliste, qui génère les contradictions économiques et écologiques associées au développement capitaliste. ». Ils rappellent ensuite que la valeur d’échange « est un rapport social spécifique à la société capitaliste, enraciné dans la classe et la division du travail ».
Certains travaux récents proposent donc de repenser le système de comptabilité actuel en prenant en compte le prix de la nature, le coût des externalités ou en introduisant des notions comme celle de « capital naturel ». Ce sont des travaux de ce type qui sont par exemple entrepris à la chaire de comptabilité écologique à l’Université Paris-Dauphine. Foster et Clark nous mettent toutefois en garde contre cette approche. Même s’ils permettent de mettre en évidence le caractère absurde du système actuel, ils rappellent que celui-ci reflète précisément les réalités capitalistes de la sous-valorisation des agents naturels. La notion de « capital naturel », quant-à-elle, constitue une « internalisation de la nature au sein de l’économie marchande ».
De là naît un double-enjeu pour un potentiel modèle socialiste de remplacement de la logique capitaliste. Comment créer un système qui est d’une part conscient de ces éléments indispensables au fonctionnement de notre système économique que sont le travail domestique ou bien les services rendus par la nature, mais d’autre part qui protège ces sphères de la logique de marchandisation et de valorisation ?
La rupture métabolique et l’exemple de l’Irlande au XIXème siècle
Les contradictions entre mode de production capitaliste et environnement s’expriment de manière concrète par ce que Marx appelle la rupture métabolique et qui constitue le concept central de l’œuvre de Marx écologiste.
La rupture métabolique repose sur le constat qu’il existe une « séparation entre les conditions inorganiques de l’existence humaine (i.e. les services de la nature) et l’activité humaine, séparation qui n’a été posée comme séparation totale que dans le rapport du travail salarié et du capital » (Marx, Manuscrits dits Grundrisse). Plus précisément, Marx observe qu’il existe dans les rapports entre capitalisme et nature un décalage entre les rythmes de régénération des conditions naturelles de reproduction du capitalisme et la vitesse à laquelle celui-ci dégrade ces conditions naturelles pour satisfaire ses pulsions d’accumulation. Le capitalisme perturbe le métabolisme entre l’Homme et la Terre et engendre une disjonction entre systèmes sociaux et cycles de la nature.
« Marx observe qu’il existe dans les rapports entre capitalisme et nature un décalage entre les rythmes de régénération des conditions naturelles de reproduction du capitalisme et la vitesse à laquelle celui dégrade ces conditions naturelles pour satisfaire ses pulsions d’accumulation.»
Cette analyse découle des travaux du chimiste allemand Justus von Liebig (1803-1873), dont Marx a attentivement lu les travaux. Von Liebig s’est employé à analyser l’impact de l’agriculture capitaliste sur les sols et met en évidence une rupture des cycles des nutriments au sein des terres. Plus précisément, la séparation entre les lieux de production agricoles (les campagnes) et les lieux de consommation (les villes) entraîne un déplacement des nutriments des champs vers les flux de déchets issus de la ville (effluents, ordures) qui ne retournent plus aux champs. Marx et Engels ont alors proposé une description fine des conditions et des rapports sociaux à l’origine de cette rupture métabolique dans le cas de l’Irlande du XIXème siècle (chapitre II).
Marx distingue dans l’organisation de la société agraire irlandaise deux phases, celle dite des « baux usuraires » (1801-1846) et celle « d’extermination » (1846-1866). Au XIXème siècle, l’Irlande est colonisée par les Anglais depuis au moins 1541, et c’est une classe propriétaire terrienne anglo-irlandaise qui possède la terre. Les propriétaires ne sont pas présents sur place et louent à de petits paysans et métayers irlandais des lopins de terre dans un système dit des « baux usuraires ». Les loyers à payer aux propriétaires sont particulièrement hauts et augmentent régulièrement. Toute amélioration technique (irrigation ou drainage) fait l’objet d’un loyer supplémentaire. La production agricole est orientée selon une rotation triple sur une même année : tout d’abord du blé puis de l’avoine, voués à l’exportation vers l’Angleterre, qui suffisent à peine à payer les loyers et dont l’argent des revenus n’est pas réinvesti mais envoyé vers l’Angleterre par les propriétaires terriens. Puis une rotation de pommes de terre pour assurer la survie des familles. La pression financière entraîne l’impossibilité d’organiser des jachères ou de planter du trèfle notamment pour laisser reposer et réenrichir le sol en nutriments (fixation d’azote, etc.). Ces cultures, très intensives en nutriments, obligent les paysans pauvres à déployer une grande ingéniosité pour assurer le renouvellement des nutriments : recours aux algues, aux excréments d’animaux, au sable, avec des techniques agricoles d’enfumage et d’épandage demandant un investissement humain considérable. Cette action permet de limiter la fuite des nutriments et la rupture métabolique qui va avec.

Figure 1 – Champs en Irlande
En 1845 survient en Irlande une maladie, le mildiou de la pomme de terre, qui va gravement pénaliser les rendements de pomme de terre. Aux famines s’ensuivent les exils massifs vers l’Amérique de 1846 à 1866. Au total, ce sont 1 millions d’habitants que perd le sol irlandais, et la disparition de près de 120 000 fermes. La main d’œuvre manquant fortement, l’enfumage des terres et l’entretien du cycle de nutriments ne peuvent plus être pratiqués, entraînant une baisse rapide des productions céréalières de l’Irlande. La loi du remplacement des nutriments de Liebig est violée. De 1855 à 1866, Marx indique que « 1 032 694 Irlandais ont été remplacés par 996 877 têtes de bétails ». L’organisation agraire capitaliste a contribué à stériliser l’Irlande en un demi-siècle pour la transformer en terre à vache peu productive.
Cette rupture dans le cycle des nutriments prend une dimension mondiale au cours du XIXème siècle pour les Anglais. Afin d’enrichir les sols anglais appauvris par l’agriculture capitaliste et pour augmenter les rendements, les Anglais vont littéralement piller des engrais naturels aux quatre coins du globe. Des quantités considérables de guano et de nitrates sont importées, notamment du Chili, jusqu’à épuiser les réserves des pays pillés. Celles-ci servent à soutenir la production agricole de l’hémisphère Nord. Plus extrême encore, les champs de bataille et les catacombes de l’Europe entière sont vandalisés pour en broyer les os et les répandre sur les champs britanniques, afin de répondre à la rupture du cycle des nutriments, dans une
forme d’échange écologique inégal.
Cette analyse est une illustration des liens que peuvent entretenir rapports sociaux de production et maintien de la fertilité du sol dans le cadre du secteur agricole. Marx explique notamment que « la fertilité n’est pas une qualité aussi naturelle qu’on pourrait le croire : elle se rattache intimement aux rapports sociaux actuels ». Cette analyse peut sembler convaincante dans le cas de la destruction de la terre par le capitalisme. Elle peut par exemple faire penser à la stagnation connue par les rendements agricoles du sol français depuis 1990, alors même que l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires ne cesse d’augmenter. Cette logique de « rupture métabolique » s’observe-t-elle dans nos interactions avec d’autres écosystèmes naturels ? Une telle enquête pourrait être d’une grande pertinence, pour s’intéresser par exemple à l’impact des rapports sociaux de production issus du capitalisme sur l’exploitation des forêts, sur la pêche ou encore en matière énergétique.
Une exploitation du travail domestique qui suit une même logique
A partir du même prisme analytique, Foster et Clark tentent dans cet ouvrage de réhabiliter la capacité de la pensée de Marx à théoriser d’autres types de domination s’exerçant sur les femmes, les colonisés [1], les « races inférieures » ou encore les animaux. Ils montrent en particulier l’intersection et la similarité des mécanismes qui existent de manière régulière entre l’expropriation et l’exploitation de la nature d’une part et l’exploitation du travail domestique. Ainsi, au chapitre 3 intitulé « les femmes, la nature et le capital », les auteurs montrent comment la domination de la femme et la non-reconnaissance du travail de reproduction domestique (entendons l’entretien du foyer et le soin des enfants notamment) relèvent d’une logique similaire à l’expropriation de la nature. Marx explique que « la logique interne du capital (…) fait peu de cas de tous les autres rapports naturels et sociaux et des conditions de production héritées, qui restent extérieures à son propre mode de production ». Le travail domestique, principalement accompli par les femmes, est, comme pour la nature, le symbole d’une « externalisation de ses coûts (du capitalisme) sur des domaines situés en dehors de son circuit de valeur interne ». Alors que le travail domestique est une des conditions de reproduction indispensable au mode de production capitaliste (au même titre que les conditions naturelles), celui-ci est exproprié et considéré là encore comme une « force gratuite de la nature ». La logique du capital exproprie le travail de reproduction sociale dans le foyer. En cela, les auteurs se rapprochent beaucoup des analyses faites par les tenants du courant féministe marxistes de la
théorie de la reproduction sociale
et en premier lieu de Tithi Bhattacharya.
Pour ce qui concerne l’expropriation du travail de reproduction domestique, les auteurs distinguent deux phases. Une première phase, analysée par Marx et Engels, est celle du 19ème siècle, au cours de laquelle, dans les villes industrielles anglaises, le travail capitaliste détruit profondément ce travail de reproduction pourtant indispensable. Les femmes ouvrières, enchaînées plus de 12h par jour, n’ont, dans l’Angleterre du 19ème, même plus le temps de s’occuper de leurs enfants. Ceux-ci sont confiés à des nourrices, allaités avec des mixtures très peu adaptées. Les taux de mortalité infantile atteignent des niveaux considérables. En somme, un tableau digne des romans de Charles Dickens. La malnutrition et la famine fait tomber à des taux extrêmement bas le nombre de survivants à l’âge adulte. En détruisant et en réduisant plus qu’au strict minimum le travail au foyer, le système capitaliste détruit la santé des travailleurs (et même leur fitness pour reprendre la terminologie spencérienne ou darwiniste sociale) et leur capacité à se reproduire, générant un réel enjeu anthropologique. Les auteurs montrent alors, en s’appuyant sur les travaux de la philosophe Nancy Fraser ou de Maria Mies, comment la société anglaise a paré à ce défi en développant la « femme-au-foyerisation » en faisant reposer ensuite le rôle de soutien de famille uniquement sur les hommes. Un nouveau rôle serait alors dévolu aux femmes, hors de la sphère de valorisation capitaliste, consistant à assurer le travail de reproduction au domicile, avec une nouvelle forme d’expropriation des services rendus par cette sphère.
 Figure 2 – La Spinning Jenny, la machine à filer qui va révolutionner l’industrie du textile britannique et contribuer à exploiter un prolétariat majoritairement féminin et (très) jeune
Figure 2 – La Spinning Jenny, la machine à filer qui va révolutionner l’industrie du textile britannique et contribuer à exploiter un prolétariat majoritairement féminin et (très) jeune
Cette analyse du travail domestique reste toutefois à prendre avec des pincettes, dans la mesure où cette dimension est très longtemps restée un impensé de l’analyse de Marx pour la majorité des spécialistes. De surcroît, les progrès scientifiques et médicaux ont profondément transformé le travail de reproduction au foyer au cours des 150 dernières années. En effet, la baisse forte des taux de mortalité infantile ainsi que les évolutions dans l’organisation de la société (déploiement des crèches, médecine infantile) ont permis de nouveau un retour des femmes dans la sphère productive, en retournant au travail. En cela, cette nouvelle dynamique réenclenche un développement des forces productives accru en lien avec la logique d’accumulation du capital.
Cet essai décrit aussi avec précision l’interaction entre exploitation de la nature et des formes d’oppression raciales. Ils décrivent notamment l’exemple de l’exploitation du guano au Pérou. Cet amas d’excréments d’oiseaux marins, indispensable à la fertilisation des champs britanniques, est exploitée localement par des « coolies », des travailleurs chinois émigrés, traités comme des esclaves et obligés de ramasser le guano dans des conditions épouvantables. Plusieurs autres exemples et analyse viennent émailler les différents chapitres d’illustration du lien entre domination coloniale et dégradation de la nature.
Capitalisme : un rapport aux frontières dévastateur
Enfin, l’analyse des auteurs est assez éclairante en ce qui concerne le rapport du système du capital aux limites et aux frontières qu’il rencontre. Selon eux, le capital se distingue par sa « tentative nécessaire et persistante de transcender ou de réajuster ses limites eu égard à ses conditions externes de production, afin de renforcer le processus d’accumulation ». Ainsi, lorsque le capitalisme se heurte à des frontières, à des limites à son expansion, il met en œuvre toute une série de mécanismes et de déplacements pour continuer cette expansion : utilisation de nouvelles ressources, de nouvelles réserves minérales, en changeant le lieu de production ou en développant de nouvelles technologies. Ces déplacements permanents créent de nouvelles frontières d’exploitation et de nouveaux lieux ou mécanismes de domination, de destruction, afin de perpétuer le processus d’accumulation.
Le capital est guidé par une volonté d’amasser de plus en plus de richesses, « exigeant un débit de plus en plus fort d’énergies et de ressources, (…), générant plus de déchets, (et qui) constitue la loi générale absolue de la dégradation sous le capitalisme ».
Pillage de la nature : un système socialement et historiquement situé et donc dépassable ?
Que retenir de cet essai ? Foster et Clark proposent une analyse globalement très convaincante de l’interaction entre logique capitaliste et destruction de la nature. Ils montrent avec précision comment le mode de production capitaliste repose sur des conditions de reproduction sociale et écologique extérieures à sa sphère de valorisation. Le capitalisme reposerait alors sur une externalisation de ses coûts hors de sa sphère productive, coûts qu’il n’assumeraient pas. De là naîtrait alors une contradiction inévitable de la logique du capital, incapable de valoriser ce qui est indispensable à sa reproduction. Cette contradiction est aussi le fruit du conflit entre valeur d’usage et valeur d’échange.
Le message que tentent de faire passer les auteurs est clair : nous ne pourrons traiter la crise écologique et climatique sans étudier puis transformer les rapports sociaux de production responsables de cette destruction. Pour cela, les auteurs proposent une voie socialiste ayant pour objectif de « sortir de la forme valeur du capitalisme pour permettre le développement d’un monde riche en besoins, tout en régulant le métabolisme entre humanité et nature ». Une sorte de « gouvernance par les besoins » capable de remettre en cause la pratique capitaliste de la valeur d’échange. Crise sociale et crise écologique sont les reflets d’une même image, d’un même système : « la source commune de ces deux crises se trouve dans le processus d’accumulation du capital ». Ou encore « fin du monde, fin du mois, même combat ».
L’essai livre pourtant une leçon qui permet de nourrir un certain optimisme. La dévastation écologique est le fruit d’un système d’organisation socialement et historiquement situé, celui de la forme capitaliste de l’organisation des modes de production. Loin d’être la conséquence d’une certaine « nature humaine originelle », le rapport dévastateur à l’environnement serait lié au système capitaliste. Pour sortir par le haut de la crise écologique, un dépassement du système d’accumulation du capital s’impose…
Note :
[1] Il existe chez les marxistes une controverse quant à la spécificité ou non des rapports entretenus par le capitalisme dans les pays colonisés entre notamment les tenants de « l’accumulation par dépossession » (Harvey) et ceux qui estiment que cette distinction est peu opérante et que le développement rapide du salariat dans les pays colonisés a conduit aux mêmes caractéristiques d’exploitation au Nord qu’au Sud (Wallerstein).
 Figure 1 – Champs en Irlande
Figure 1 – Champs en Irlande
 Figure 2 – La Spinning Jenny, la machine à filer qui va révolutionner l’industrie du textile britannique et contribuer à exploiter un prolétariat majoritairement féminin et (très) jeune
Figure 2 – La Spinning Jenny, la machine à filer qui va révolutionner l’industrie du textile britannique et contribuer à exploiter un prolétariat majoritairement féminin et (très) jeune