-
 chevron_right
chevron_right
L'armée romaine était-elle INVINCIBLE ? Trois raisons qui expliquent sa supériorité.
eyome · Monday, 1 May, 2023 - 15:37
Vraiment excellente cette chaine.
 chevron_right
chevron_right
L'armée romaine était-elle INVINCIBLE ? Trois raisons qui expliquent sa supériorité.
eyome · Monday, 1 May, 2023 - 15:37
Vraiment excellente cette chaine.
Europe sociale : aux origines de l’échec
news.movim.eu / LeVentSeLeve · Wednesday, 26 April, 2023 - 19:43 · 18 minutes
« Trahison » ? Facteurs structurels ? Les causes de l’échec du projet d’« Europe sociale », porté haut et fort par la gauche durant les années 1970, ont fait couler beaucoup d’encre. C’est l’objet de l’ouvrage d’Aurélie Dianara, Social Europe : the road not taken (Oxford University Press, 2022), issu de sa thèse. Elle met en évidence la difficulté du contexte européen dans lequel François Mitterrand parvient au pouvoir, marqué par le mandat de Margaret Thatcher et une volte-face des sociaux-démocrates allemands. Surtout, elle souligne l’absence de soutien populaire à l’idée d’Europe sociale défendue par les socialistes français, qui fut déterminante dans son abandon. Dès lors que François Mitterrand acceptait de poursuivre la construction européenne sur une voie libérale, elle ne devait plus en dévier… Par Aurélie Dianara, traduction d’Albane le Cabec.
« L’Europe sera socialiste ou ne sera pas »… À en juger par l’état de l’Europe actuelle, la prophétie séduisante de Mitterrand ne pouvait être plus éloignée de la vérité. Depuis, l’Union européenne plusieurs fois élargie s’est engagée sur une voie qui s’éloigne chaque jour davantage de cette « Europe sociale » que les socialistes européens défendaient dans les années 1970.
Loin d’une Europe régulatrice, redistributive, planificatrice et démocratisée au service des travailleurs, se dessine une Europe de plus en plus néolibérale, dont la dimension sociale n’est plus seulement compatible avec le marché : elle constitue un véritable levier à la libre circulation des capitaux et à l’extension de la propriété privée. Que l’on choisisse d’y voir une illusion, un alibi ou une réalité, « l’Europe sociale » qui émerge à partir du milieu des années 1980 est à bien des égards à l’opposé de celle qu’avait pensé la gauche européenne précédemment.
La victoire de la gauche en mai 1981 en France, lorsque François Mitterrand est élu président de la République et qu’un gouvernement de ministres socialistes prend les rênes, rejoints en juin par quatre ministres communistes, était un événement majeur pour la gauche européenne. La France était bien sûr un pays clé en Europe occidentale comme au sein de la Communauté Européenne (CE), l’ancêtre de l’Union européenne.
Le nouveau gouvernement était bien conscient des contraintes imposées par l’interdépendance des économies européennes et par la Communauté elle-même, dans un contexte où ses principaux partenaires adoptaient des politiques d’austérité déflationnistes. Dans son programme commun de 1972, la gauche s’était engagée à réformer la Communauté et à préserver sa liberté d’action, nécessaire à la réalisation de son programme. Lorsqu’elle est finalement arrivée au pouvoir en 1981, elle s’y est essayée.
Dès le 11 juin 1981, lors d’une déclaration commune, le nouveau ministre de l’Économie et des Finances Jacques Delors en appelait à un plan de relance concerté à l’échelle européenne, tandis que le ministre du Travail Jean Auroux plaidait pour des mesures radicales contre le chômage et défendait notamment la réduction du temps de travail. Le 29 juin, au Conseil européen, Mitterrand effectuait une déclaration officielle en faveur d’une Europe « sociale », appelant à la création d’un « espace social européen » fondé sur la réduction coordonnée du temps de travail, un dialogue social amélioré et l’adoption d’un plan européen de relance économique. Le gouvernement français publiait également un mémorandum le 13 octobre sur la revitalisation de la CE : l’Europe « doit parvenir à la croissance sociale et être audacieuse dans la définition d’un nouvel ordre économique », pouvait-on y lire.
La stratégie des socialistes français reposait sur l’espoir que leur avènement au pouvoir soulèverait un enthousiasme populaire en Europe. Mais une fois élus, ils bénéficièrent d’un soutien extérieur bien faible ; y compris au sein de la gauche européenne
Ces propositions avaient alors beau être prudentes, clairement dépourvues de rhétorique marxiste, moins ambitieuses que les revendications jusqu’alors portées par la gauche européenne, elles ne parvinrent pas à convaincre les partenaires de la France. Le chancelier social-démocrate allemand Helmut Schmidt ne se montrait pas beaucoup plus enthousiaste que son homologue Margaret Thatcher, frontalement hostile à cet agenda – et le soutien du gouvernement grec ne pesait pas bien lourd dans la balance. La proposition d’une relance européenne coordonnée en particulier, clé de voûte du plan français, fut accueillie avec un certain dédain.
Les raisons de l’échec de l’Europe sociale sont nombreuses et complexes. Parmi elles, le rôle du gouvernement social-démocrate allemand, qui avait pourtant été l’un des principaux promoteurs d’une « Union sociale européenne » quelques années plus tôt, ne doit pas être sous-estimé. Dès 1974, il œuvrait à l’émergence d’un ordre international fondé sur l’austérité et le libre marché. Au G7 comme au Conseil européen, Schmidt insiste sur la priorité de la lutte contre l’inflation, plaide pour la suppression des obstacles à la mobilité des capitaux et souhaite voir les gouvernements européens renoncer à leurs prérogatives dans le domaine monétaire – confié à des autorités « indépendantes » telles que les banques centrales.
Schmidt contribue en effet à engager non seulement le système monétaire européen mais les États-Unis eux-mêmes dans la discipline monétaire en 1979 – année du « choc Volcker ». Il plaide également pour que l’octroi de crédits par le FMI aux pays confrontés à des crises financières particulièrement graves – comme l’Italie et le Royaume-Uni en 1976 – soit conditionné à l’adoption de politiques anti-inflationnistes et de mesures d’austérité. À contre-courant des réponses interventionnistes et expansionnistes envisagées alors par la majorité de la gauche européenne, la réponse de l’Allemagne à la crise des années 1970 contribuait au « désencastrement » de l’ordre économique international.
Côté britannique, Thatcher, figure de proue de la « révolution » conservatrice d’Europe occidentale, constituait un obstacle inamovible à toute orientation « sociale » de l’Europe. En parallèle, entre 1979 et 1984, la question de la contribution du Royaume-Uni au budget de la CE empoisonnait les relations entre États-membres. Dans ce contexte, les perspectives d’une Europe de la redistribution, de la régulation des marchés et de la solidarité s’amenuisaient ; les propositions européennes de Mitterrand essuient donc un refus cordial.
En 1983, le fameux « tournant de la rigueur » du gouvernement de Pierre Mauroy, qui allait devenir un traumatisme dans la mémoire collective de la gauche française, fut entrepris au nom de l’Europe. Pour ceux qui avaient cru au socialisme par l’Europe et à l’Europe sociale, il s’agissait là d’une cuisante défaite. Bien entendu, les causes de l’échec de l’expérience socialiste ne peuvent être réduites à la construction européenne. Il faut bien sûr mentionner la récession internationale, la politique déflationniste menée par les principales puissances mondiales ou le rôle des marchés financiers.
De la même manière, le projet socialiste français n’était pas exempt de défauts qui ont pu nuire à sa mise en œuvre. Un élément demeure central : le soutien populaire manquait au projet « d’Europe sociale ». La stratégie des socialistes français reposait sur l’espoir que leur avènement au pouvoir soulèverait un enthousiasme populaire en Europe. Mais une fois élus, ils bénéficièrent d’un soutien extérieur bien faible ; y compris au sein de la gauche européenne.
Il faut dire qu’avec le départ des travaillistes et Thatcher à la tête du gouvernement britannique, la France avait perdu un allié majeur. Malgré le soutien des socialistes français au gouvernement allemand concernant la question des euromissiles au cours des années précédentes, la coalition sociale-libérale de Schmidt refusait alors de considérer la proposition de Mitterrand pour un plan de relance coordonné afin d’éviter une nouvelle dévaluation du franc et une sortie du système monétaire européen. À l’instar des partis de gauche, les syndicats européens se caractérisaient eux aussi par leur absence de mobilisation – aussi bien au niveau institutionnel que dans la rue – en faveur de l’agenda français. En l’absence d’un mouvement populaire domestique et transnational à même de soutenir ses réformes, le recul du gouvernement français était difficilement évitable.
Tous les efforts déployés pour accroître la coopération entre les syndicats et partis européens et construire l’unité programmatique nécessaire pour ériger une Europe alternative semblaient donc avoir été vains. Plus que jamais, la gauche européenne était prise dans le dilemme européen. D’un côté, le renoncement français semblait confirmer que le « socialisme dans un seul pays » n’était plus une option dans une économie mondiale de plus en plus interdépendante.
De quoi donner du grain à moudre au discours désormais porté par la gauche européenne, selon lequel la réalisation du socialisme nécessiterait de s’organiser au-delà de l’État-nation. Malheureusement, d’un autre côté, les déboires de la gauche française, tout comme la défaite du combat de la gauche européenne pour un « New Deal » européen, pour une réduction du temps de travail, une démocratisation de l’économie, et une régulation des entreprises multinationales, avaient démontré l’incapacité de la gauche européenne à transformer la CE en une « Europe sociale ».
Il était désormais évident que la Communauté constituait un carcan de plus en plus étroit dans lequel les politiques économiques, sociales, industrielles, budgétaires et fiscales ne pouvaient plus être décidées indépendamment par les États-membres. À la lueur de cet échec français, la gauche européenne fut contrainte de repenser sa stratégie socialiste. Alors que certains tiraient pour conclusion que le cadre institutionnel européen était intrinsèquement incompatible avec le socialisme, la plupart se convainquaient que ce dernier ne pourrait être atteint qu’à l’issue d’une réforme de la Communauté européenne. C’est ainsi que le « tournant européen » du gouvernement français fut justifié – celui-là même qui conduisit Mitterrand à relancer le processus d’union économique, monétaire et politique avec Helmut Kohl à Fontainebleau en 1984.
Le sommet de Fontainebleau, tout comme la nomination de Jacques Delors comme président de la Commission européenne (1985-1995), confirmait le choix du gouvernement français, après avoir renoncé au « socialisme dans un seul pays », de réaffirmer son engagement européen aux côtés de son nouvel « ami » allemand, Helmut Kohl. Jacques Delors appartenait à l’aile libérale du parti socialiste français. C’était un homme politique expérimenté, qui avait été l’un des principaux artisans du virage français vers l’austérité et la persévérance au sein du système monétaire européen. Selon les propres mots de Margaret Thatcher, « en tant que ministre français des Finances, on lui savait gré d’avoir freiné les premières politiques socialistes du gouvernement et d’avoir assaini les finances françaises ».
Les pressions des différents lobbies patronaux ont été déterminantes dans la refonte du marché européen à partir du milieu des années 1980. En 1979, le Comité d’action Jean Monnet incluait pour la première fois des représentants d’entreprises en son sein.
Delors avait gagné la confiance des néolibéraux mais aussi celle du gouvernement allemand ; il connaissait le jargon bureaucratique européen aussi bien que la politique communautaire. Bien que le « moment Delors » soit souvent présenté comme le temps fort de la promotion d’une « Europe sociale », c’est d’abord l’intégration économique et le projet de marché unique que le nouveau président de la Commission plaça au sommet de son programme. Ce choix était consensuel, comme l’explique Delors lui-même quelques années plus tard : « Je devais me rabattre sur un objectif pragmatique qui correspondait aussi à l’air du temps, puisqu’on ne parlait alors que de déréglementation, de suppression de tout obstacle à la concurrence et aux forces du marché. »
Bien que les droits de douane et les quotas aient été supprimés avec la création du marché commun suite au traité de Rome, de nombreuses « barrières non tarifaires » persistaient, comme les règles d’hygiène alimentaire, les normes techniques et les subventions étatiques aux entreprises et aux services. Le parachèvement du marché intérieur – grâce à la suppression des obstacles aux « quatre libertés » : libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes – était bien sûr encouragé par le gouvernement Kohl et par Thatcher elle-même. Le nouveau commissaire britannique chargé du marché intérieur et des services, Arthur Cockfield, ancien dirigeant de la chaîne britannique de pharmacies Boots qui avait détenu des portefeuilles ministériels dans les gouvernements Thatcher, joua un rôle central dans l’édification du projet.
Le projet de marché unique réunissait les aspirations de deux « fractions » rivales d’une classe capitaliste européenne de plus en plus transnationale. D’un côté, une frange « mondialiste », composée des plus grandes multinationales européennes (y compris les institutions financières). De l’autre, une frange « européiste » constituée de grandes entreprises industrielles desservant principalement les marchés européens et concurrencées par les importations bon marché extérieures à l’Europe. Les premiers défendaient un projet néolibéral pour l’Europe, avec une ouverture des marchés européens à l’économie mondiale appuyée par des déréglementations, des privatisations et la réduction de la place de l’État dans l’économie.
Les seconds étaient davantage favorables à un projet néo-mercantiliste, attachés à un « marché domestique » européen élargi ainsi qu’à des politiques publiques industrielles censées stimuler les « champions européens » – dans le but de les rendre compétitifs par rapport à leurs homologues nord-américains ou japonais. Ces deux fractions convergeaient alors pour exercer une pression croissante sur les élites politiques européennes pour la levée de tous les obstacles au libre-échange au sein du marché intérieur.
Les pressions des différents lobbies patronaux ont été déterminantes dans la refonte du marché européen à partir du milieu des années 1980. En 1979, le Comité d’action Jean Monnet incluait pour la première fois des représentants d’entreprises en son sein. En 1983, à l’initiative du directeur général de Volvo, Pehr Gyllenhammar, les dirigeants de dix-sept grandes multinationales – dont Volvo, Philips, Fiat, Nestlé, Shell, Siemens, Thyssens, Lafarge, Saint Gobain et Renault – se réunissaient à Paris pour fonder la Table ronde européenne des industriels (ERT). Son objectif était de promouvoir une plus grande ouverture des marchés ainsi qu’un soutien européen à l’industrie. Le « Livre blanc sur l’achèvement du marché intérieur » de la Commission de 1985 ressemblait comme deux gouttes d’eau aux recommandations de l’ERT. En particulier, il proposait quelques 300 mesures pour achever le marché unique d’ici 1992 par la suppression des barrières non tarifaires…
La logique qui sous-tendait le programme institutionnalisé par l’Acte unique était intrinsèquement liée à celle du libre-marché. Loin de la « planification socialiste » promue par Delors quelques années plus tôt, l’objectif de ce programme était de construire un marché plus étendu, « censé conduire à une concurrence plus rude entraînant une plus grande efficacité, de plus grands profits et finalement par un effet de ruissellement, plus de richesse générale et plus d’emplois ». Le marché était conçu comme indispensable à la croissance économique et à la création d’emplois et pour redonner à l’Europe occidentale sa place d’acteur économique dans un monde de plus en plus compétitif et globalisé.
Bien sûr, l’Acte unique européen ne se limitait pas à l’achèvement du marché unique européen : il étendait également le vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil (y compris sur quelques questions sociales telles que les normes de santé et de sécurité au travail) ; augmentait les pouvoirs législatifs du Parlement européen avec les procédures de coopération et d’avis conforme (plus tard consolidées avec la procédure de « codécision », bien que la chambre n’ait jamais obtenu le droit d’initiative) et définissait parmi ses objectifs le renforcement de la coopération en matière de développement régional, de recherche et de politique environnementale. Cependant, la majeure partie du nouveau traité concernait la libéralisation, l’harmonisation et la « reconnaissance mutuelle » dans le secteur économique. Au cours des années suivantes, des directives cruciales furent adoptées concernant la libéralisation des mouvements de capitaux et la déréglementation des banques et des assurances.
Historiquement, et contrairement aux partis socialistes et aux syndicats locaux et nationaux, les structures socialistes et syndicales déployées à l’échelle européenne n’ont pas émergé d’une poussée populaire.
Delors et ses collègues n’avaient-il pas prévu que l’explosion des échanges, la libéralisation des services et la libre circulation des capitaux sans harmonisation fiscale et sociale, mettraient inévitablement en concurrence les travailleurs et les régimes de protection sociale, provoquant un nivellement par le bas des droits sociaux et des salaires ? La question est d’autant plus prégnante que les socialistes européens avaient prôné tout au long des années 1970 une harmonisation sociale et fiscale par le haut, alliée à un contrôle accru des mouvements de capitaux et des entreprises multinationales.
Une des principales raisons de l’échec des projets « d’Europe sociale » a résidé dans l’incapacité de la gauche européenne à construire une mobilisation populaire transnationale pour soutenir ses propositions. Une telle mobilisation aurait été – et serait toujours – nécessaire pour inverser le rapport de force en faveur des travailleurs et des travailleuses à l’échelle continentale. Il est significatif qu’en-dehors d’un rassemblement sous la tour Eiffel quelques jours avant les premières élections au Parlement européen, les partis socialistes n’aient pas même envisagé de se mobiliser sur leur projet européen ces années-là. Tout au long des années 1970, la politique européenne est restée l’affaire des chefs de parti, tout en n’étant qu’une préoccupation lointaine pour les militants des partis socialistes et communistes.
Pourtant l’« Europe sociale » n’était pas complètement déconnectée des mouvements sociaux de l’époque. Ce projet avait été formulé par les élites de la gauche européenne en réponse aux revendications issues des contestations sociales vives et diverses des années 1970. Mais dans le même temps, cette évolution de la « vieille gauche » et de son projet d’Europe sociale peut être interprétée, au moins en partie, comme une tentative paternaliste de réaffirmation de son autorité sur ses électeurs sans jamais essayer de susciter un soutien populaire massif pour leur projet européen. Bien sûr, sa perte progressive de soutien au sein des classes populaires – qui allait s’accentuer dans les années 1980 – ne ferait que rendre la perspective d’un tel mouvement populaire en soutien à une Europe sociale plus lointaine et improbable…
Les choses étaient quelques peu différentes du côté des syndicats où, comme le montre ce livre, il y a eu une véritable intention de construire un mouvement transnational des travailleurs pour soutenir « l’Europe sociale » à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Néanmoins, bien que la Confédération européenne des syndicats ait joué un rôle crucial dans l’élaboration de positions et d’une culture syndicale communes en contribuant à « l’européanisation » du syndicalisme, elle est restée jusqu’à ce jour un organe de représentation au sein des institutions, plutôt que de lutte.
Historiquement, et contrairement aux partis socialistes et aux syndicats locaux et nationaux, les structures socialistes et syndicales déployées à l’échelle européenne n’ont pas émergé d’une poussée populaire. Elles ont résulté des décisions des dirigeants des partis et des syndicats, sont demeurées éloignées des mouvements de masse et donc limitées dans leur pouvoir et leur influence. Contrairement aux attentes de la fin des années 1970, faute de volonté politique de la plupart des confédérations nationales, et faute de moyens, la Confédération européenne des syndicats est toujours demeurée un colosse aux pieds d’argile.
La gauche européenne n’a jamais réussi à édifier le bloc unitaire et combatif nécessaire pour construire un rapport de force suffisant et imposer une Europe alternative. Si elle y était parvenue, nous vivrions peut-être aujourd’hui dans une Europe très différente. Tout comme l’intégration européenne d’après-guerre était principalement un processus dirigé par les élites, l’« Europe sociale » est restée dans une large mesure un projet formulé et promu par les élites politiques et technocratiques.
L’incapacité des partisans de « l’Europe sociale » à construire un lien organique avec les populations et avec les mouvements populaires n’est pas seulement la principale raison pour laquelle ce projet a échoué. C’est aussi une pièce du puzzle qui permet de mieux saisir la transformation de la social-démocratie européenne, et le changement de paradigme vers le capitalisme néolibéral à partir de la fin des années 1970.
« Meloni veut en finir avec le mouvement ouvrier » – Entretien avec David Broder
news.movim.eu / LeVentSeLeve · Monday, 17 April, 2023 - 15:44 · 23 minutes
L’arrivée au pouvoir de l’extrême droite en Italie a fait couler beaucoup d’encre. Pour David Broder, historien et responsable de l’édition européenne du magazine Jacobin (partenaire de LVSL), la victoire électorale de l’an dernier n’est pourtant pas surprenante. Au cours des dernières décennies, et particulièrement depuis les années 1990, la mouvance « post-fasciste » (distincte par bien des aspects du fascisme historique) a réussi à réécrire l’histoire de la Seconde guerre mondiale, apparaître comme une opposante à l’ establishment et devenir un mouvement légitime au sein des élites, grâce à une alliance des droites. Dans son livre Mussolini’s grandchildren (Pluto Books, non traduit en français), il revient sur l’histoire tourmentée de cette famille politique et la façon dont elle s’est progressivement installée au coeur du système politique. Entretien.
Le Vent Se Lève : Lorsque Giorgia Meloni est devenue Première Ministre de l’Italie il y a six mois, de nombreux journalistes ont évoqué un « retour du fascisme » tout juste 100 ans après la marche sur Rome de Mussolini. Si son parti, les Fratelli d’Italia (Frères d’Italie), réunit les représentants actuels des héritiers du fascisme, Meloni a cependant rejeté ces comparaisons en affirmant que « tout ça appartient au passé » et qu’il ne s’agit que d’une campagne de peur de la part de ses opposants. Vous consacrez justement tout votre livre à revenir sur la longue histoire de cette famille politique et ses nombreuses mutations depuis 1945. Selon vous, peut-on donc qualifier les Fratelli de « fasciste » ou ce terme n’est-il pas approprié ?
David Broder : Il y a une mutation importante entre le fascisme au début du XXème siècle et les mouvements d’aujourd’hui. Cela est largement dû à un renouvellement générationnel. C’est pour ça que le titre de mon livre est « Les petits enfants de Mussolini » et non « les clones de Mussolini ». Bien sûr, il y a des liens, parfois personnels, comme dans le cas du Président du Sénat Ignacio La Rossa, dont le père était un leader fasciste en Sicile. Il y a aussi une filiation politique, avec des idées et une culture politique qui se sont transmises. Mais si l’on parle de post-fascisme ou de néo-fascisme, c’est bien car il y a une distinction importante entre l’histoire du régime fasciste et le mouvement qui lui a succédé. Giorgio Almirante, leader du Mouvement Social Italien [ le MSI était le parti néo-fasciste de l’après-guerre, ndlr] faisait d’ailleurs cette distinction.
La démarche discursive de Giorgia Meloni est de séparer les deux choses. Dans ses discours, elle présente le MSI comme le parti de droite démocratique d’après-guerre, en rappelant que le MSI a condamné l’antisémitisme de Mussolini il y a déjà plusieurs décennies et a accepté la compétition électorale. Mais évidemment, réduire le fascisme à l’antisémitisme et à la dictature est incomplet et d’autres aspects n’ont pas véritablement été abandonnés. L’évolution s’est faite progressivement, en fonction du contexte politique. Durant les décennies d’après-guerre, par exemple durant les années de plomb [ années 1970, marquées par de nombreux attentats en Italie, ndlr], le MSI était déjà un parti important (quatrième ou cinquième suivant les élections) mais minoritaire.
« Meloni est un produit de la fin de l’histoire. »
Quand Meloni a adhéré au MSI à l’âge de 15 ans, dans les années 1990, l’époque avait déjà bien changé. C’était la fin de la Guerre froide, le Parti communiste et la Démocratie chrétienne, les deux grands partis de l’après-guerre, étaient en train de disparaître, l’Italie accélérait son intégration européenne avec le traité de Maastricht et Berlusconi invitait le MSI à rejoindre sa coalition de gouvernement (en 1994, ndlr). Meloni est un produit de la fin de l’histoire. En 1995, au congrès du MSI à Fuigi, où le parti est devenu Alianza Nationale, on parlait déjà de la fin des idéologies, des violences etc., comme le fait Meloni aujourd’hui. A l’époque, l’historien Robert Griffin parlait d’une hybridation d’une culture idéologique fasciste, avec d’un côté une vision exclusiviste et homogénéisante de la nation et d’autre part l’acceptation du cadre de compétition électorale de la démocratie libérale. C’est pourquoi je parle de post-fascisme.
Les comparaisons médiatiques de 2022 avec 1922 sont donc beaucoup trop réductrices : le monde a tellement changé. A l’époque, non seulement les seuils de violence étaient beaucoup plus hauts et la démocratie électorale était moins implantée, mais c’était aussi une époque de massification de la vie politique, avec des partis qui comptaient des centaines de milliers d’adhérents. Aujourd’hui, on constate plutôt l’inverse : l’abstention augmente et la politique n’intéresse plus les masses. Finalement, l’histoire du mouvement post-fasciste est celle d’un parti minoritaire de la Première République (période de 1945 au début des années 1990 avec un système politique dominé par la Démocratie chrétienne et le Parti communiste, qui a ensuite volé en éclats en quelques années, ndlr) qui a su devenir un parti important d’une démocratie en crise.
LVSL : Votre démarche à travers le livre est celle d’un historien. Ainsi, vous accordez une place importante aux questions mémorielles et à la façon dont le MSI et les partis qui lui ont succédé ont réussi à réécrire certaines pages de l’histoire italienne à son avantage. Vous donnez notamment l’exemple des foibe , ces fosses communes où ont été enterrés des partisans fascistes, mais aussi des Italiens innocents, tués notamment par les communistes yougoslaves. Comment le mouvement post-fasciste est-il parvenu à renverser l’antifascisme hégémonique dans l’après-guerre, notamment en s’appuyant sur l’anti-communisme ?
D.B. : Fratelli d’Italia est un parti obsédé par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il cherche à tout prix à détruire la culture mémorielle antifasciste de l’Italie d’après-guerre, qui était alors hégémonique. Comme je le disais, Meloni arrive en politique dans les années 1990, à une époque où la vie politique est marquée par la fin des grands récits, mais aussi des violences. Pour elle, l’enjeu n’est pas d’héroïser les fascistes, mais plutôt de les présenter comme des victimes. Elle s’inspire en cela de ce qui se fait ailleurs en Europe, comme en Pologne, en Hongrie ou en Lituanie. Pour elle, 1945 n’était pas une libération, mais le moment où les communistes profitent de la défaite de l’Italie pour tenter d’imposer une dictature pire que le fascisme.
Cette histoire de foibe est un bon moyen d’introduire cette culture mémorielle est-européenne en Italie. Selon ce discours, les communistes yougoslaves ne sont pas des paysans qui ont libéré l’Italie aux côtés des Alliés, mais des meurtriers qui ont tenté de commettre un nettoyage ethnique envers les Italiens. Certes, ce récit s’appuie sur une certaine réalité : il y a des exactions commises par les communistes qui ne sont pas excusables. On prend souvent l’exemple de Norma Cossetto , une jeune fasciste violée puis tuée et jetée dans un foibe . Bien sûr, elle ne le méritait pas. Mais les post-fascistes ont réussi à faire passer ces exactions (qui ont tué plusieurs milliers de personnes, ndlr) commises dans un contexte trouble pour un second Holocauste. Il y a d’ailleurs deux jours de commémoration en Italie : un pour les victimes de l’Holocauste, le jour de la libération d’Auschwitz, et l’autre pour les victimes des foibe . Cela témoigne du succès de ce discours révisionniste.
« Dans le discours des post-fascistes, l’Italie est victime des nazis et des communistes yougoslaves. »
C’est une vision de l’histoire ultra-auto-indulgente, qui met sur le même plan les victimes du fascisme et les victimes fascistes. A travers ce discours, ils excluent complètement les responsabilités du fascisme. Par exemple, ils reconnaissent que la Shoah et l’antisémitisme sont inexcusables, mais ils imputent ces faits à l’alliance à l’Allemagne nazie, qui aurait été une erreur de Mussolini. Dans le discours des post-fascistes, l’Italie est donc victime des nazis et des communistes yougoslaves. En revanche, l’invasion de l’Ethiopie [ où les troupes du dictateur ont notamment employé du gaz moutarde contre les civils et attaqué les équipes humanitaires de la Croix Rouge , ndlr] et de la Yougoslavie ou la colonisation de la Libye ne sont presque jamais mentionnées dans le débat public.
L’antifascisme se retrouve donc dépolitisé : les fascistes sont présentés comme des Italiens victimes de violence en raison de leur nationalité. Cette construction d’un nouveau récit historique avec les foibe a été répliquée avec les victimes des violences des années de plomb. L’exemple emblématique est celui de Sergio Ramelli, un jeune militant fasciste de 18 ans agressé dans la rue, alors qu’il n’était pas un véritable soldat politique qui aurait agressé des adversaires politiques. Meloni et ses lieutenants se servent de cet exemple pour se présenter comme innocents et affirmer que le MSI a été opprimé par la culture antifasciste d’après-guerre, dont il faudrait à tout prix se débarrasser. Selon elle, l’ennemi absolu est le communisme, qu’elle résume au goulag et au stalinisme, alors que le Parti communiste Italien a par exemple largement écrit la Constitution italienne.
LVSL : Outre cette question mémorielle, le MSI faisait face à de nombreux obstacles lors de son apparition après la guerre. Jusqu’aux années 1990, les deux partis ultra-dominants sont la Démocratie chrétienne, continuellement au gouvernement, et le Parti communiste Italien, continuellement exclu du pouvoir. Durant cette période appelée « Première République » par les Italiens, le MSI a tenté plusieurs tactiques : la stratégie de l’insertion, puis celle de la tension et enfin celle de la pacification. Pouvez-vous revenir sur ces différentes phases ?
D.B. : Dans le système politique italien d’après-guerre, il y avait des ex-fascistes dans tous les partis. Mais la spécificité du MSI, c’est qu’il défendait la République de Salò [ nouvelle version du régime mussolinien entre 1943 et 1945, ndlr] et que les fascistes qui avaient abandonné Mussolini en 1943 n’avaient pas le droit d’en faire partie. La ligne du parti vis-à-vis des 23 années au pouvoir de Mussolini est assez clairement définie dès le congrès fondateur du MSI en 1948 : ni restaurer le régime de Mussolini, ni renoncer à cet héritage. C’est une façon de réconcilier les deux âmes du parti, l’une plutôt sociale et anti-bourgeois, l’autre plus conservatrice. Ce positionnement a permis des prises de positions qui tranchent parfois avec l’histoire du fascisme sous Mussolini. Je trouve ça assez drôle quand certains s’étonnent de l’atlantisme de Meloni : le MSI soutient l’OTAN depuis 1951 !
LVSL : Oui c’est un tournant intéressant. Les Américains et leurs alliés ont contribué à la chute de Mussolini et pourtant, le MSI rejoint très vite le camp atlantiste car il le voit comme un rempart au communisme. Et cette position n’a pas changé depuis…
DB : En effet, cette transformation est assez remarquable. A l’origine, le récit du MSI autour de la République de Salò en fait une sorte de révolution manquée du fascisme, qui aurait tenté de se débarrasser de la monarchie et de l’Eglise pour créer une République sociale, ainsi que l’expression d’un patriotisme désintéressé, d’une défense coûte que coûte de l’Italie malgré une défaite certaine contre les Alliés. Mais seulement six ans plus tard, ils ont abandonné ce positionnement pour devenir un partenaire de l’Alliance atlantique. Bien sûr, certains courants et certains militants, comme Giorgio Almirante, n’ont pas adhéré à cette idée et ont plutôt repris l’idée gaulliste d’une équidistance entre Washington et Moscou. Mais la position hégémonique a bien été de chercher à construire la légitimité du parti en adhérant à cette alliance occidentale et anti-communiste.
Par ailleurs, pour se légitimer, les post-fascistes tentent de devenir un partenaire de coalition acceptable pour les Chrétiens démocrates, au nom d’une lutte commune contre le communisme. Cette volonté d’alliance a failli se concrétiser en 1960, quand Tambroni, le Premier ministre de l’époque, a eu besoin de leurs voix pour être majoritaires au Parlement. Mais cette période a été marquée par une contestation sociale très forte, qui a montré aux Chrétiens-démocrates que les Italiens ne toléraient pas cette alliance [ le gouvernement est alors tombé, ndlr].
 Le journaliste et historien David Broder. © Pluto Books
Le journaliste et historien David Broder. © Pluto Books
Suite à cet échec de la « stratégie de l’insertion », il y a au sein du MSI une analyse presque conspirationniste selon laquelle les Etats-Unis finiront par avoir besoin des fascistes pour combattre le communisme. L’objectif, notamment durant les années de plomb (années 1970, ndlr) est donc de faire un coup d’Etat afin d’instaurer un régime autoritaire, comme au Chili. Une telle option a bien été préparée à l’époque, notamment au travers de la loge P2 et de l’opération Gladio . Mais finalement, face à cette menace d’un coup d’Etat, des compromis réformistes ont été trouvés pour calmer la contestation sociale et cette option n’a jamais été déclenchée. En outre, le MSI a un peu surestimé sa propre utilité pour les soutiens d’un potentiel coup d’Etat, qui n’avaient pas nécessairement besoin de leur poids électoral pour mener cette opération.
« L’existence d’un pan électoral et légaliste du mouvement fasciste italien à travers le MSI a bénéficié à des militants et des organisations fascistes radicales plus violentes. »
En revanche, l’existence d’un pan électoral et légaliste du mouvement fasciste italien à travers le MSI a bénéficié à des militants et des organisations fascistes radicales plus violentes. Cela s’est vu par exemple avec l’attentat de la Piazza Fontana à Milan en 1969 , commis par le groupe paramilitaire Ordine Nuovo, fondé par Pino Rauti, qui était aussi un cadre important du MSI pendant des décennies et a même brièvement dirigé le parti en 1990. Les deux phénomènes vont de pair : pendant que le MSI cherchait à bâtir une alliance des droites, des mouvements terroristes d’extrême-droite qui partageaient à peu près la même idéologie commettaient des violences « préventives » pour éviter une victoire communiste en Italie.
LVSL : Néanmoins, qu’il s’agisse de la stratégie de l’insertion, c’est-à-dire d’une alliance des droites, ou de celle de la tension, par un coup d’Etat, ces deux tactiques échouent et le MSI reste un parti minoritaire. Mais tout change au début des années 1990 : le Parti communiste est délégitimé après la chute du Mur de Berlin et la fin de l’URSS, tandis que les socialistes et la Démocratie chrétienne s’effondrent suite au scandales de corruption Tangentopoli. De nouveaux acteurs politiques émergent, notamment Berlusconi, qui va tendre la main au MSI pour former un gouvernement. Pouvez-vous revenir sur les nombreux changements qui ont lieu avec l’émergence de la Seconde République ?
D.B. : La chute du mur de Berlin a certes achevé la chute du Parti communiste Italien, mais en réalité, elle a surtout fait exploser les contradictions préexistantes et aidé ceux au sein du parti qui voulaient le transformer en parti européiste et libéral. Cet événement, ainsi que l’effet de Tangentopoli sur la Démocratie Chrétienne et le Parti Socialiste, ont rendu plus probable une victoire électorale du nouveau centre-gauche, qui a émergé sur les décombres du Parti communiste. C’est ce qu’on a observé par exemple lors des élections locales en 1993, où se sont affirmés ces anciens communistes devenus libéraux, mais aussi la Lega – alors un parti régionaliste – et un peu le MSI. Lors des municipales cette année-là, le second tour à Rome a par exemple opposé un candidat écologiste à Gianfranco Fini, du MSI.
Comme il n’avait pas participé aux différents gouvernements, le MSI a été épargné par les scandales de corruption et s’est présenté comme le parti des honnêtes gens. En outre, le MSI a aussi été légitimé par le Président de la République de l’époque, Francesco Cossiga (ancien démocrate-chrétien, ndlr). Celui a repris les slogans du MSI, en évoquant la nécessité d’en finir avec la « particratie », c’est-à-dire la mainmise de certains partis sur la vie politique, pour passer à un régime plus plébiscitaire etc. Berlusconi a aussi profité du moment pour entrer en politique début 1994.
Déjà, l’année précédente, il avait soutenu Fini comme potentiel maire de Rome au nom de la lutte contre « l’extrême-gauche ». Son discours a été largement construit sur la peur d’une victoire des anciens communistes, qui, selon lui, auraient seulement changé leurs discours mais pas leurs idées. Ainsi, de manière assez bizarre, l’élection de 1994 s’est largement joué sur l’identité communiste ou anti-communiste de l’Italie, à un niveau inégalé depuis les années 1960. C’est d’autant plus absurde que tous ces progressistes ex-communistes ne cessaient de reprendre la rhétorique et les mesures originellement issues de la droite !
« De manière assez bizarre, l’élection de 1994 s’est largement joué sur l’identité communiste ou anti-communiste de l’Italie, alors que tous ces progressistes ex-communistes ne cessaient de reprendre la rhétorique et les mesures originellement issues de la droite ! »
Ainsi, Berlusconi et son « alliance des modérés » avec la Lega et le MSI, remporte l’élection de 1994. Giuseppe Tatarella, du MSI, devient alors vice-Premier ministre. A l’époque, sa présence choque : par exemple Elio di Rupo, futur Premier Ministre belge, refuse de lui serrer la main. On imagine mal cela aujourd’hui avec Meloni. Certes, ce moment coïncide avec une sorte de dédiabolisation du MSI conduite par son chef de l’époque, Gianfranco Fini. Mais il faut bien comprendre qu’il ne s’agit pas d’un abandon des racines du MSI, mais plutôt l’achèvement du processus lancé dès les années 1950 par Almirante : construire une grande alliance des droites anti-communistes dans laquelle la tradition néo-fasciste aurait droit de cité. Bien sûr, il y a eu des mobilisations antifascistes importantes – un million de manifestants à Milan en 1994 par exemple – mais clairement les barrières à une éventuelle alliance avec les néo-fascistes au sein de la droite avaient disparu.
En fait, quand on parle de la montée en puissance électorale de l’extrême-droite, on pense souvent à une arrivée au pouvoir de barbares violents, mais la réalité est celle d’un processus de long terme. Si on en revient à Meloni, elle ne doit pas tant sa victoire à son génie, mais plutôt à cette longue progression. Dès les années 1990, Alianza Nationale (nouveau nom du MSI après 1995, ndlr) réunissait six millions de voix; l’an dernier, Fratelli d’Italia en a réuni sept millions. En réalité, le fait le plus marquant est la victoire intellectuelle des idées d’extrême-droite au sein de l’alliance des droites. On voit un peu la même chose en France avec le Rassemblement National, en Espagne avec Vox ou en Suède : ce n’est pas tant l’extrême-droite qui se modère, mais plutôt la droite historique qui se recompose sur des bases nouvelles, nationalistes et tournées autour de l’idée d’un déclin national. Le même récit postmoderne se retrouve un peu partout. En Italie, Meloni a par exemple tout un discours autour des financiers – toujours plus ou moins sionistes ou juifs – qui s’allient avec les marxistes et les ONG pour organiser un grand remplacement. Ce qui est par ailleurs assez drôle, c’est le contraste entre la grande vision du défi civilisationnel et de l’extinction programmée du peuple italien et les moyens qu’ils proposent pour y faire face, qui sont assez faibles.
LVSL : Oui, on peut citer à ce sujet un discours où Meloni évoquait les « valeurs nationales et religieuses » qui seraient attaquées, pour transformer les individus en simples « citoyens x, parent 1 ou parent 2 » qui deviendraient alors « de parfaits esclaves à la merci des spéculateurs de la finance ». Tous ses discours sont très offensifs et permettent à Meloni de se présenter en outsider défendant les intérêts du peuple italien. Pourtant, son parti ne remet aucunement en cause l’appartenance à l’Union européenne et l’austérité qu’elle impose, à l’euro, à l’OTAN, les livraisons d’armes à l’Ukraine… Finalement, les Fratelli d’Italia semblent donc très bien s’accommoder du statu quo en matière économique et focalisent leurs actions sur des enjeux comme le droit à l’avortement, l’immigration ou les questions de genre.
D.B. : En effet, les Fratelli n’entendent pas remettre en cause la position de l’Italie sur la scène internationale et son appartenance à l’OTAN ou à l’UE. De toute façon, un Italexit n’a jamais été sérieusement envisagé : même il y a une dizaine d’années, lorsque Meloni avait un discours plus eurosceptique qu’aujourd’hui, elle proposait une vague sortie commune de tous les pays, avec une déconstruction organisée. Donc cela n’a jamais été une option. Meloni emprunte plutôt un discours de politique identitaire à l’américaine, qui dépeint les Italiens en victimes de l’histoire, trahis par leurs élites etc. Pour vous donner un exemple, la Lega de Salvini avait par exemple produit une affiche où l’on voyait un amérindien avec le slogan « il n’a pas su défendre son pays »
Bien sûr, il faut reconnaître que le racisme des Fratelli peut déjà s’exprimer dans le cadre des politiques migratoires actuelles de l’UE par exemple. Mais en accédant au pouvoir, Meloni va permettre de légitimer des positions encore plus extrêmes, d’autant que les libéraux ne défendent pas les fameuses « valeurs » et les droits de l’homme dont ils parlent en permanence. Même en France, sans arriver au pouvoir, le Rassemblement National réussit déjà à changer la vie politique française en profondeur. Ce qui est particulièrement dangereux en Italie, c’est qu’il n’y a pas d’opposition face aux propositions de l’extrême-droite. Je vous donne un exemple récent : après la publication d’un rapport de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur la torture dans les prisons italiennes, les Fratelli ont proposé de supprimer la torture du code pénal . En gros, les idées que défendent les Fratelli rejoignent beaucoup celles d’Orbán, par exemple en faisant une loi pour criminaliser ceux qui feraient une soi-disant apologie du communisme ou de l’islamisme. Donc plus qu’une prise de pouvoir par des milices fascistes dans la rue, c’est plutôt un scénario similaire à celui de la Pologne ou de la Hongrie qui se dessine. En ramenant toujours les ONG et les oppositions, pourtant dominées par les libéraux, au totalitarisme stalinien qui voudrait détruire l’Italie, Meloni veut achever la culture antifasciste et le mouvement ouvrier.
« En accédant au pouvoir, Meloni va permettre de légitimer des positions encore plus extrêmes. »
Donc même si je pense que Meloni n’aura pas trop de difficultés à conclure des accords avec des gens comme Biden par exemple, je pense qu’il ne faut rien laisser passer. Bien sûr, crier à la menace fasciste n’est souvent pas la bonne manière de les combattre politiquement et il est nécessaire d’aborder des questions centrales comme l’économie ou l’abstention. Mais tout de même, on ne peut pas renoncer à la lutte sur ces questions d’identité et d’histoire.
LVSL : A la fin du livre, vous abordez les liens des Fratelli avec d’autres partis d’extrême-droite à l’étranger, comme le Fidesz de Viktor Orbán, le parti Droit et Justice en Pologne ou les Républicains américains. Tous ces partis ont en commun de promouvoir des théories du complot, notamment l’idée d’un grand remplacement, et de remettre en cause des avancées progressistes , comme le droit à l’avortement. Lorsque Meloni a été élue, beaucoup de médias français ont fait des parallèles avec Marine Le Pen et le Rassemblement National. Selon vous, qu’ont-elles en commun et qu’est-ce qui les différencie ?
D.B . : Sur le plan des différences, j’en vois plusieurs. D’abord, si, un courant un peu plus social, en faveur de l’Etat-Providence, a existé au sein du MSI historiquement, il a disparu depuis longtemps, comme on l’a vu depuis les gouvernements dominés par Berlusconi. Certes, le parti se dit toujours « social » et se présente comme une droite défendant les petites gens, mais quand on regarde la réalité, Meloni a repris toutes les idées de Reagan. Elle parle tout le temps de « l’assistanat », on croirait presque entendre la droite du XIXème siècle. Tout récemment, un ministre a par exemple déclaré que les bénéficiaires des aides sociales devraient être envoyés dans les champs pour s’occuper des cultures , car ce serait de leur faute si l’Italie est obligée de recourir à des travailleurs migrants pour ces tâches. Donc, même si l’on peut fortement douter des promesses sociales de Marine Le Pen, pour moi, Meloni se rapproche plus de la ligne idéologique défendue par Jean-Marie Le Pen dans les années 1980.
« L’équivalent en France de Meloni est davantage Eric Zemmour que Marine Le Pen selon moi. »
Plus largement, l’équivalent en France de Meloni est davantage Eric Zemmour que Marine Le Pen selon moi . Marine Le Pen ne parle guère de la Seconde guerre mondiale ou de débats historiques par exemple, c’est plutôt Zemmour qui tente de réhabiliter Vichy et de polariser les débats sur des questions aussi clivantes. De même, Zemmour est le grand théoricien du grand remplacement, avec cette idée des ex-colonisés qui envahissent la métropole, que Meloni utilise très souvent. Enfin, c’est encore Zemmour et Marion Maréchal qui reprennent la stratégie des Fratelli, à savoir l’union des droites. Néanmoins, Marine Le Pen et Meloni ont tout de même des points communs. Toutes les deux cherchent à renouveler l’identité d’un vieux parti minoritaire, pour les rendre moins sectaires et marginaux. Le fait d’être des femmes y contribue en partie. Mais ces transformations concernent plus l’image que le fond idéologique de leurs partis.
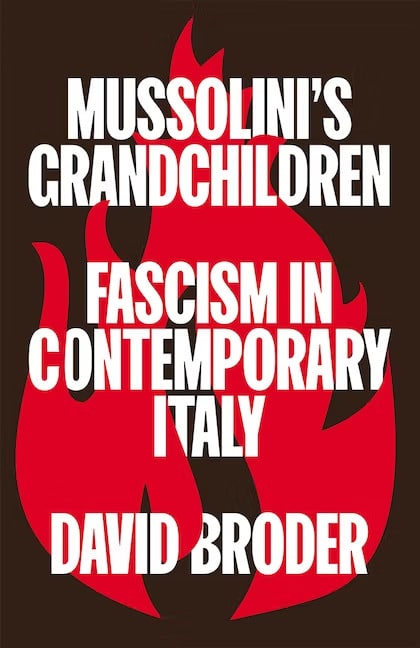
Mussolini’s Grandchildren (non traduit en français), David Broder, Pluto Books, 2023.
« Le gaullisme social a aujourd’hui encore une audience » – Entretien avec Pierre Manenti
news.movim.eu / LeVentSeLeve · Saturday, 15 April, 2023 - 14:31 · 28 minutes
L’opposition d’une partie des députés Les Républicains au projet de réforme des retraites porté par le gouvernement a fait rejaillir dans le débat public une expression aux contours flous, et pourtant récurrente : le gaullisme social. Quelle définition donner à ce concept qui a traversé plus d’un demi-siècle de vie politique ? Le général de Gaulle lui-même avait-il théorisé ce courant ? Quelle est d’ailleurs la part de réalité et celle du mythe derrière l’action « sociale » du Général ? Auteur d’une Histoire du gaullisme social (Perrin, 2021), Pierre Manenti, conseiller politique, retrace la généalogie et l’héritage de cette tradition politique qui a marqué la IV e et la V e République de son empreinte. Des « gaullistes sociaux » aux « gaullistes de gauche », cette histoire ne se résume pas à quelques trajectoires individuelles. Au contraire, elle s’est traduite, selon l’auteur, dans des organisations politiques et syndicales qui ont cherché à reconcilier Capital et travail auprès du monde ouvrier, tout en défendant l’héritage du Conseil national de la Résistance. Au risque de servir de caution de gauche aux tendances plus conservatrices du gaullisme ? Entretien réalisé par Léo Rosell et retranscrit par Guillemette Magnin.
LVSL – Qu’est-ce qui est à l’origine de votre intérêt pour la figure du général de Gaulle et pour son héritage politique ?
Pierre Manenti – Pendant mes études à l’École normale supérieure, j’ai étudié et exploré le mandat du général de Gaulle, président de la République, de 1958 à 1969. Dans ce cadre, j’ai beaucoup travaillé sur les archives de la Fondation Charles-de-Gaulle et de l’Institut Georges-Pompidou. J’ai découvert que, contrairement à l’idée que je m’en faisais, il n’y avait pas un gaullisme monolithique, un chef indiscuté avec un parti encadré et rigide, mais en réalité des gaullismes, des personnalités diverses, parfois voire souvent opposées entre elles. Le parti gaulliste était en effet composé d’hommes de droite mais aussi d’hommes de gauche, ceux qu’on a appelé les tenants du gaullisme social. Tout ce petit monde était réuni par sa fidélité au général de Gaulle, tout en ayant des pensées radicalement différentes sur l’économie ou la société.
Il se trouve par ailleurs qu’en 2020, le Premier ministre de l’époque, Jean Castex, a fait sa première interview télévisée en se présentant comme un « gaulliste social ». Le lendemain, la presse a unanimement salué son positionnement politique, parce qu’alliant le meilleur de la droite, le gaullisme, et l’esprit de la gauche, celui des luttes sociales. Ce qui est incroyable, c’est que le gaullisme social est donc passé d’une chapelle politique du gaullisme à un mot-valise de la vie politique française, une sorte d’équilibre politique parfait.
À ce compte-là, de nombreux centristes pourraient se revendiquer du gaullisme social, alors que pour les hommes de gauche engagés dans l’aventure gaulliste, il s’agissait de construire un véritable « socialisme gaulliste ». Il manquait donc un travail d’historien pour rappeler l’origine de la pensée sociale du général de Gaulle, l’histoire politique de ses partis et mouvements, ainsi que la place des hommes de gauche dans cette aventure et, après sa disparition, la vie de ce courant du gaullisme social qu’ont incarné, tour à tour, René Capitant, Louis Vallon, Philippe Dechartre ou encore Philippe Seguin plus récemment.
LVSL : À vous écouter, on a l’impression qu’il manque une vraie définition du gaullisme…
C’est vrai. De son vivant, le général de Gaulle s’est toujours refusé à définir le gaullisme. Il n’existe donc pas de définition donnée par le Général lui-même ; ce sont donc ses contemporains, notamment les hommes politiques, ou plus tard les historiens, qui ont construit la définition du mot « gaullisme ». La plupart des commentateurs s’accordent cependant pour dire qu’elle est fondée sur trois éléments invariables.
Le premier élément est le dépassement des clivages politiques au service de l’intérêt de la nation. Le gaullisme un courant politique qui refuse le clivage droite-gauche, le système des partis, la politique politicienne, et qui veut agréger au sein d’un même mouvement des personnalités de droite et de gauche, toutes animées par la volonté de servir leur pays.
Le deuxième élément intrinsèque au gaullisme est la politique de la grandeur, c’est-à-dire l’idée que le gaulliste doit contribuer à faire rayonner la France à l’international, notamment à travers de la défense des valeurs des Lumières, de la Révolution et du Conseil national de la Résistance (CNR). Il doit porter avec noblesse ces valeurs inhérentes à l’identité française. Dans cette politique de grandeur, il y a aussi la défense de la francophonie, de l’identité française, dit autrement l’idée d’une France éternelle.
L’ambition du gaullisme, c’est un État ni capitaliste, ni socialiste, mais une troisième voie française, c’est-à-dire un État interventionniste.
Le troisième et dernier élément, qui est pour moi inscrit dans l’ADN du gaullisme, c’est le combat en faveur du progrès social. Le gaullisme s’est toujours soucié des plus faibles, des plus nécessiteux, de ceux qui en ont besoin. L’ambition du gaullisme, c’est un État ni capitaliste, ni socialiste, mais une troisième voie française, c’est-à-dire un État interventionniste, participationniste et libéral, au sens où le libéralisme, contrairement au capitalisme, implique une intervention de l’État pour corriger les défaillances du marché.
LVSL : Quelle est la part du général de Gaulle dans tout cela ? Quelle définition donne-t-il du gaullisme social ?
Charles de Gaulle est d’abord un homme du XIX e siècle – il est né en 1890. Il a été très marqué par l’éducation de son père et de son oncle, tous deux imprégnés du catholicisme social. Avec eux, il a acquis la conviction que l’homme politique a un rôle social. Dans la bibliothèque du général de Gaulle, il y a également un livre du maréchal Lyautey sur le rôle social de l’officier. Charles de Gaulle a été très influencé par ce livre et par l’idée que le militaire a un rôle dans l’organisation de la société et de ses solidarités. Pour lui, la dimension de fraternité catholique est très importante dans la construction du corps social. Sa foi a donc nourri sa pensée politique.
Pour répondre à votre question, si l’on s’en tient à la définition la plus simple, le gaullisme désigne l’action et la pensée du général de Gaulle. Pour la pensée, il existe dix-neuf tomes de lettres, notes et carnets qui permettent d’étudier la doctrine politique du Général, sans compter ses très nombreuses archives. Pour l’action, c’est la manière dont il a mis en œuvre cette pensée au contact de la réalité, pendant la guerre, sous la IV e et la V e République.
La naissance du gaullisme politique tient donc profondément à l’expérience de la guerre et à l’entrée des Soviétiques et des Américains dans le conflit en 1941, lorsque l’on commence à se dire que les Alliés pourraient gagner.
La première fois que le général de Gaulle a développeé cette pensée politique, il était à Londres, en 1940. Il avait déjà cinquante ans et avait été, jusque-là, un militaire, un tacticien, un stratège, mais pas un homme politique. La naissance du gaullisme politique tient donc profondément à l’expérience de la guerre et à l’entrée des Soviétiques et des Américains dans le conflit en 1941, lorsque l’on commence à se dire que les Alliés pourraient gagner.
On demande alors au général de Gaulle quelle serait sa doctrine politique s’il devait demain gouverner le pays libéré. D’où l’émergence, à ce moment donné de l’histoire, d’un des premiers discours politiques du Général à Oxford, le 25 novembre 1941. Dans ce discours, il développe trois idées fondamentales qui caractérisent le gaullisme et plus particulièrement sa dimension sociale.
La première idée, c’est de faire attention aux effets de la mécanisation de l’économie. On est à l’époque du film Les Temps modernes de Charlie Chaplin, dans lequel le héros est écrasé par la roue de la machine. Il y a une inquiétude réelle sur la place du travailleur dans l’usine et il faut veiller à ce que la machine ne le détruise pas. La seconde idée concerne la société à rebâtir. Il faut tout faire pour que cette société épanouisse l’ouvrier et le détourne des totalitarismes. La troisième idée est qu’il faut être capable de penser à long terme, aussi bien dans sa vision de l’économie que de la politique. L’homme politique doit être capable de se projeter à vingt ou trente ans, de faire les choix difficiles, qui s’imposent pour la survie du pays.
LVSL – Qu’est-ce qui distingue alors le gaullisme social des autres courants du gaullisme?
P. M. – Dans l’aventure de la France libre, qui pose les prémices du gaullisme social, il y a évidemment des tendances, des grandes idées qui se sont dégagées au fur et à mesure des débats politiques, mais c’est véritablement lors de l’épopée du Rassemblement du peuple français (RPF), le parti animé par le général de Gaulle de 1947 à 1954-55, que les différentes écuries politiques du gaullisme se sont construites, avec leurs personnalités et leurs chefs.
Il y a d’abord le gaullisme anticommuniste, avec notamment André Malraux, qui est conduit avant toute chose par le rejet du modèle soviétique et la « peur du rouge ». Il y a ensuite le gaullisme social, qui est persuadé que pour lutter contre cette ascension du modèle soviétique, il faut aller parler aux ouvriers, aux travailleurs, dans les usines, donc il faut un gaullisme social et populaire pour convaincre les classes ouvrières de la justesse du gaullisme. Puis, au fil des années, la IV e République connaît une crise économique sans précédent et se développe alors un gaullisme libéral, qui épouse l’esprit de libéralisation et modernisation de l’économie française.
La particularité du gaullisme social, par rapport aux autres courants du gaullisme, c’est son ancrage dans le temps long et l’affection personnelle du général de Gaulle pour ce courant politique.
Ces différentes chapelles sont en concurrence auprès du général de Gaulle, qui va soutenir tantôt les unes, tantôt les autres, et les rendre plus ou moins influentes au gré de son humeur et de l’actualité nationale. La particularité du gaullisme social, par rapport aux autres courants du gaullisme, c’est son ancrage dans le temps long (dès la France libre et jusqu’aux jours les plus récents) et l’affection personnelle du général de Gaulle pour ce courant politique (qui se manifeste notamment via le financement de leur journal sur les deniers personnels du Général).
Après la disparition du général de Gaulle, un gaullisme orthodoxe et conservateur émerge autour de Pierre Messmer et d’Hubert Germain [le dernier Compagnon de la Libération, NDLR]. Ces deux hommes veulent préserver le gaullisme des origines et s’inquiètent d’éventuels dévoiements. Chacun se revendique alors d’être le plus légitime dans son discours gaulliste : c’est le combat qui oppose Georges Pompidou, président de la République, et les barons du gaullisme (Chaban-Delmas, Debré, Frey).
LVSL – L’un des mythes fondateurs du gaullisme social est l’application du programme du CNR à la Libération, en particulier la mise en place de la Sécurité sociale. Certains ont même parlé d’un « gaullo-communisme » pour qualifier cette période. Souscrivez-vous à cette thèse, qui semble évacuer la grande conflictualité qu’il y avait à cette époque, entre gaullistes et communistes ?
P. M. – Sur la question de la Sécurité sociale ou des comités d’entreprise, qui sont deux grandes réformes mises en place à la Libération, l’empreinte du général de Gaulle est très forte. Sans le général de Gaulle, cela n’aurait pas pu se faire. Néanmoins, il a travaillé dans le cadre d’un gouvernement de coalition, d’abord avec la gauche socialiste puis avec la gauche communiste, après les élections d’octobre 1945. Avant l’entrée des communistes au gouvernement, Charles de Gaulle défend le comité d’entreprise, que les communistes rejettent à l’Assemblée nationale. Après les élections législatives, il les fait entrer dans son gouvernement et c’est seulement à partir de ce moment que les communistes se mettent à défendre cette idée.
[Sur la Sécurité sociale], de Gaulle avait une vision très technique de ce sujet, là où les communistes ont apporté un regard plus politique et populaire.
Il y a donc une forme de captation et de réappropriation politique par les communistes de cet acquis gaulliste de la Libération. Quant au modèle de Sécurité sociale, il est vrai que la vision du général de Gaulle était encore très marquée par le paternalisme, issu du grand courant du catholicisme social. Le retrait progressif du Général des affaires politiques en novembre-décembre 1945, puis son départ du pouvoir en janvier 1946, ont conduit à l’émergence d’un modèle de Sécurité sociale qui n’est peut-être pas celui que de Gaulle aurait voulu mettre en place.
C’est donc à la fois la volonté politique initiale du général de Gaulle de porter ces réformes et leur reprise puis leur transformation par la gauche communiste et socialiste – plus ambitieuses que le projet initial – qui ont permis l’émergence du modèle que l’on connaît aujourd’hui. De Gaulle avait une vision très technique de ce sujet, là où les communistes ont apporté un regard plus politique et populaire sur de ces réformes.
Paradoxalement, à partir de 1947, l’argument massue du général Gaulle dans sa lutte pour revenir au pouvoir est celui de la participation des ouvriers à la gouvernance des entreprises et au partage de ses résultats. C’est une sorte de « match retour » pour le Général, qui a beaucoup évolué sur ces questions dans l’intervalle. On parle d’ailleurs parfois, pour désigner le gaullisme, d’une politique de circonstances, c’est-à-dire de grands principes qui doivent être appliqués selon les circonstances. C’est une forme de realpolitik .
LVSL – Vous montrez l’importance du catholicisme social dans la pensée de Charles de Gaulle, en même temps que des visées stratégiques. C’est la fameuse phrase que vous utilisez, « homme de droite par conviction et homme de gauche par nécessité de l’action »…
P. M. – Tout à fait. Pourquoi Charles de Gaulle développe-t-il ce discours social ? Parce qu’en 1941, alors qu’il est à Londres, certains Français libres le soutiennent mais d’autres s’inquiètent du régime qu’il pourrait mettre en place dans la France libérée. L’amiral Muselier, grand-père de Renaud Muselier, fait ainsi partie de ces gens, plutôt marqués à gauche, qui s’inquiètent de ce que le Général pourrait faire après la guerre. Les Anglais, les Américains mais aussi beaucoup de socialistes français réfugiés à Londres le voient comme un militaire de droite, conservateur, donc dangereux par définition. Certains journaux français le qualifient même de fasciste. De Gaulle comprend rapidement qu’il a besoin de développer un discours social pour parler au peuple de gauche. C’est quelqu’un qui est fondamentalement, par son éducation et son milieu d’origine, un homme de droite, mais qui va développer un discours de gauche, par la politique et le besoin de rassemblement des Français.
Pourquoi Charles de Gaulle encourage-t-il l’émergence d’un gaullisme social sous la IV e République ? Parce qu’il existe alors deux partis de droite, le Parti républicain de la liberté (PRL), qui s’est construit sur les débris de la droite d’après-guerre, et le Mouvement républicain populaire (MRP), qui incarne une droite chrétienne et humaniste. Le général de Gaulle se dit qu’il doit aller chercher les ouvriers, en développant un discours sur la condition sociale et le statut des travailleurs afin d’installer son parti, le RPF, dans le paysage politique d’après-guerre ; c’est donc une stratégie politique, nourrie par une conviction intime sur le sens de la nation et de la République.
Si je vais plus loin : pourquoi y a-t-il un sursaut du gaullisme social sous le mandat présidentiel de Charles de Gaulle ? De 1958 à 1965, les avancées du gaullisme social sont très mineures et les premières tentatives du Général en faveur de l’intéressement sont un échec, en raison de l’hostilité de son entourage comme du patronat. Lors de l’élection présidentielle de 1965, le général de Gaulle est mis en ballotage, alors même qu’il pensait être élu dès le premier tour. Il avait refusé de faire des entretiens avec des journalistes et il finit par accepter, sous la pression de Jacques Foccart, face au risque d’être défait. Il fait alors trois entretiens avec Michel Droit, qui sont entrés dans la légende.
En janvier 1966, lorsque Charles de Gaulle réélu reconduit Georges Pompidou à Matignon, il prend cependant la décision de rappeler Michel Debré dans son gouvernement. C’est le retour d’une certaine tradition gaulliste, dit autrement la victoire des anciens face aux modernes. C’est aussi la fin de la parenthèse libérale conduite par Pompidou entre 1962 et 1965. C’est dans ce contexte que le général de Gaulle relance la réforme de la participation avec plusieurs lois successives, mais surtout un grand référendum, en 1969, sur la participation à la gouvernance des entreprises, des universités, de la vie politique, etc. Ce que de Gaulle recherche, c’est un modèle d’association du Capital et du travail, un modèle paritaire, dans lequel chacun est reconnu pour son apport à une œuvre commune.
Derrière cette main tendue aux ouvriers et aux travailleurs, il y a une stratégie politique et une inquiétude sociale.
Il ne faut pas oublier qu’il y a, chez de Gaulle et les gaullistes, la peur de l’insurrection communiste. On pense aux grandes grèves de 1947-1948, à la peur du rouge dans l’après-guerre, aux menaces de la rue en 1968, etc. Tout cela se construit et s’exprime dans un contexte de Guerre froide, où l’Union soviétique est une menace réelle pour les démocraties occidentales. Derrière cette main tendue aux ouvriers et aux travailleurs, il y a donc une stratégie politique – aller chercher le vote ouvrier avec un discours de rassemblement du pays pour dépasser les clivages – et une inquiétude sociale – si on ne partage pas suffisamment, le pays explosera et une révolution pourrait alors s’emparer du pouvoir.
LVSL – Vous expliquez cependant que le courant du gaullisme social a toujours été assez minoritaire, au point d’apparaître à certains moments comme une caution politique pour une doctrine plus autoritaire et conservatrice.
P. M. – Oui, c’est particulièrement vrai dans l’aventure du RPF [entre 1947 et 1955], où les grands cadres du parti étaient des hommes plutôt anticommunistes et conservateurs, peu portés sur la question sociale. Le parti était alors sous l’influence d’hommes de droite. Pourtant, certains militants, comme Jacques Baumel ou Yvon Morandat, sont parvenus à convaincre le général de Gaulle de créer un syndicat gaulliste, l’Action ouvrière. Son existence permet alors une forme d’équilibre politique au sein de la famille gaulliste et fait taire certaines accusations sur le positionnement très à droite du RPF.
Il faut rappeler qu’avant que le RPF ne soit créé en 1947, il y avait eu un autre mouvement gaulliste, créé en 1946 à l’initiative de René Capitant, qui s’appelait l’Union gaulliste et qui avait servi de ballon d’essai. Très vite pourtant, le général de Gaulle s’était aperçu que cette Union gaulliste ne marchait pas, car elle était devenue un rassemblement hétéroclite de gens d’extrême-droite, qui venaient de la droite autoritaire et qui tentaient de « se recycler ». De ce point de vue, dans l’aventure du RPF, l’Action ouvrière et le gaullisme social ont donc servi de caution pour replacer le gaullisme au centre de l’échiquier politique.
Par la suite, notamment après la mise en sommeil du RPF, le gaullisme social a pris son indépendance du reste du parti gaulliste : plusieurs clubs et mouvements ont ainsi existé entre 1955 et 1958, puis différents partis se sont structurés comme le Centre de la Réforme républicaine (CRR) en 1958 ou l’Union démocratique du travail (UDT) entre 1959 et 1962. C’est peut-être d’ailleurs le grand échec politique de Philippe Seguin, qui a voulu ressusciter le gaullisme social non pas comme un mouvement autonome mais comme une composante du RPR chiraquien. Il a voulu faire percer le gaullisme social au sein de la famille chiraquienne.
Or, à partir de 1969 et plus encore à partir de 1974, il y a une rupture au sein de la famille gaulliste, car les héritiers du gaullisme social estiment que la défense du gaullisme n’est ni avec Georges Pompidou, ni avec Valéry Giscard d’Estaing, ni même avec Jacques Chirac, mais qu’elle est à gauche, quitte à travailler avec les ennemis d’hier. Jean Charbonnel ou Léo Hamon, tous les deux des anciens ministres, vont ainsi œuvrer directement avec la gauche socialiste de François Mitterrand. Ce moment marque, pour moi, la rupture entre les gaullistes sociaux et les gaullistes de gauche, les premiers cherchant à faire vivre une droite sociale, les seconds ralliant les partis de la gauche socialiste et communiste.
Les gaullistes de gauche vont, au nom d’une certaine idée du gaullisme, travailler main dans la main avec la gauche.
Au contraire, à partir de 1978-1981, un mouvement inverse s’opère. Certains gaullistes de gauche vont revenir dans le giron du RPR chiraquien, notamment à l’occasion des élections européennes de 1979, et vont donc redevenir des tenants de la droite sociale. D’autres vont néanmoins définitivement décrocher, comme Michel Jobert, ancien ministre de Pompidou, qui devient ministre de Mitterrand. Ces deux familles, issues de la vision sociale du général de Gaulle, coexistent pendant de nombreux années… Les gaullistes sociaux font vivre l’idée d’une droite sociale et populaire au sein de la famille gaulliste puis chiraquienne ; tandis que les gaullistes de gauche, au nom d’une certaine idée du gaullisme, travaillent main dans la main avec la gauche. Ce sont eux que l’on retrouve, en 2002, autour de la candidature de Jean-Pierre Chevènement.
LVSL – Certains observateurs, tel que l’historien Grey Anderson, ont décrit le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958 comme un coup d’État, dans un contexte de guerre civile. Que pensez-vous de cette analyse ?
P. M. – Je ne pense pas qu’on puisse qualifier le retour au pouvoir du général de Gaulle de coup d’État, mais il est vrai que la crainte d’un coup de force militaire a indéniablement pesé sur les conditions de son accession aux responsabilités en mai 1958. De Gaulle s’est toujours tenu à l’écart des tractations avec les militaires de l’Algérie française, ce qui n’est pas le cas de tous les gaullistes, notamment son premier cercle, ainsi Jacques Foccart et Olivier Guichard.
Le général de Gaulle ne pouvait pas non plus ignorer la volonté qu’avaient les pieds-noirs et l’armée d’Algérie de le voir revenir au pouvoir, ni même les agissements de son entourage. Au moment où le gouvernement de Salut public est proclamé à Alger, le Général profite donc de la situation pour mettre la pression sur l’écosystème politique métropolitain et pour être choisi non seulement comme dernier président du Conseil mais aussi pour obtenir les pleins pouvoirs au début du mois de juin 1958.
Je dirais donc que de Gaulle n’a pas organisé de coup d’État militaire, mais qu’il a profité d’un climat général d’angoisse politique, vis-à-vis de la possibilité d’un tel coup d’État, pour accéder au pouvoir.
LVSL – En-dehors de ce que vous appelez la « valeur refuge » que constitue le gaullisme dans une partie très importante du champ politique français, quel est, selon vous, l’héritage du gaullisme aujourd’hui, et en particulier du gaullisme social ?
P. M . – Ce qui est très intéressant, c’est que lorsque le général de Gaulle est décédé en 1970, la question de savoir s’il existait encore un gaullisme s’est immédiatement posée. Or elle n’a jamais été résolue depuis. Si l’on reprend la définition de la pensée gaulliste apportée dans mes réponses précédentes, y a-t-il eu une continuité à travers d’autres figures politiques ? On peut bien sûr penser aux barons du gaullisme, avec la candidature de Chaban-Delmas en 1974 ou celle de Michel Debré en 1981.
Pour rappel, on parle généralement de six barons du gaullisme : Chaban-Delmas, Debré, Foccart, Frey, Guichard et Palewski. Pourquoi ces six hommes sont-ils considérés comme des barons du gaullisme ? Parce qu’ils étaient des hommes qui parlaient au nom du général de Gaulle et au général de Gaulle. Ils étaient parmi les rares personnes capables de lui tenir tête. Ils déjeunaient régulièrement ensemble, à la Maison de l’Amérique latine, boulevard Saint-Germain. À partir de là, est né une sorte de mythe selon lequel ils seraient les grands décideurs du régime. Dans la vie quotidienne du parti, le Général se refusant aux bases œuvres de la vie politique, les barons du gaullisme étaient en effet les animateurs du gaullisme politique.
Puis, au fur et à mesure de la disparition des barons, disparition politique ou personnelle, d’autres ont essayé de reprendre cet étendard et ce rôle au sein de la famille gaulliste comme Pierre Lefranc (fondateur de l’Institut Charles-de-Gaulle en 1971) ou encore des anciens Premiers ministres comme Maurice Couve de Murville ou Pierre Messmer. Ces nouveaux barons ont cherché à faire vivre le gaullisme après de Gaulle. Dans des temps les plus récents, d’autres figures se sont imposées comme les derniers gardiens du temple du gaullisme, comme Albin Chalandon qui, en 1986, était le seul ministre du général de Gaulle à servir dans le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac. Il apportait alors une caution politique importante mais aussi un témoignage de la survivance du gaullisme, comme je le raconte dans mon livre [NDLR : Albin Chalandon, Le dernier baron du gaullisme , Perrin, 2023].
L’élection présidentielle de 2022 l’a montré : la quasi-totalité des candidats, de droite mais aussi de gauche, a en effet invoqué la figure du général de Gaulle
De là, une question demeure. Les derniers grands représentants du gaullisme ayant disparu, existent-ils encore des gens légitimes en France pour porter cette parole politique ? Je suis persuadé que le gaullisme est un ensemble de grands principes qui ont encore toute leur légitimité et leur vitalité dans la France contemporaine. L’élection présidentielle de 2022 l’a montré : la quasi-totalité des candidats, de droite mais aussi de gauche, a en effet invoqué la figure du général de Gaulle, qu’il s’agisse d’Anne Hidalgo qui s’est rendue à Colombey-les-Deux-Églises ou de Marine Le Pen qui l’a célébré à Bayeux, d’Éric Zemmour qui a utilisé la référence au discours du 18-juin dans son clip de campagne, d’Emmanuel Macron qui a appelé à voter pour lui des sociaux-démocrates aux gaullistes, ou encore de Valérie Pécresse, qui se présentait comme une gaulliste sociale et libérale.
Alors pourquoi cette appropriation politique unanime du terme de « gaullisme » ? Parce que les grands principes du gaullisme sont devenus transpartisans. De Gaulle et le gaullisme sont désormais plus que des notions politiques, ce sont des concepts historiques. Qui se souvient en effet des tensions politiques inhérentes à l’époque de général de Gaulle, exception faite des événements de mai 1968 ? En revanche, on se souvient tous du héros de la France libre, de celui qui, après avoir relevé le pays, a voulu réconcilier la droite et la gauche, bref de la figure de rassemblement.
J’ajouterais que lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il est persuadé qu’il est légitime pour parler à la droite, mais aussi à la gauche, et que ce qu’il entreprend devrait avoir son soutien. Il est donc écœuré de voir que la gauche, derrière François Mitterrand (qui publie Le coup d’État permanent en 1964), refuse de le soutenir pour ce qu’il estime être une histoire de politique politicienne. Il confie d’ailleurs à un proche : « La gauche se réclamera de moi lorsque je serai mort », ce qui est une manière de dire que son différend avec la gauche est uniquement personnel. Tout cela lui semble contraire à l’intérêt du pays ; c’est le fameux « régime des partis », qu’il abhorre et contre lequel il s’est battu toute sa vie.
LVSL – Qu’est devenu le gaullisme après de Gaulle ? Vous parlez beaucoup du gaullisme social mais vous écrivez aussi qu’il existe aussi un gaullisme néolibéral et européen, ce qui peut sembler antithétique…
P. M. – Le gaullisme néolibéral, qu’on présente aussi parfois comme un néo-gaullisme, est l’héritier des politiques libérales menées par le général de Gaulle en 1958-1959, au moment de la réforme Pinay-Rueff de l’économie française. Il s’enracine, en 1962, avec l’arrivée de Georges Pompidou à Matignon.
Quant au gaullisme social, il a lui-même muté du catholicisme social des origines, au gaullisme ouvrier, en passant par l’opposition au pompidolisme puis par les grandes heures du séguinisme.
Quant au gaullisme européen, il faut rappeler que le général de Gaulle n’est pas contre l’Europe ; il est pour l’Europe des nations. Mais lui-même évolue au cours de son mandat. À la fin de sa vie, en 1969, il a ainsi des entretiens avec l’ambassadeur britannique Soames et lui confie : « Je suis prêt à faire entrer l’Angleterre dans une certaine Europe, telle que je l’ai imaginée ». Ce changement de pied explique qu’il y a, dans la famille gaulliste, un courant pro-européen, avec Jacques Chaban-Delmas, par exemple, partisan de l’accord de Maastricht, et à l’opposé, un courant souverainiste, dans lequel on retrouve Philippe Séguin ou Charles Pasqua, défenseurs de l’Europe des nations.
Quant au gaullisme social, il a lui-même muté du catholicisme social des origines, au gaullisme ouvrier, en passant par l’opposition au pompidolisme puis par les grandes heures du séguinisme. Je suis persuadé que le gaullisme social, qui est à la fois un discours souverainiste d’exaltation de la nation française et en même temps un discours de lutte contre la fracture sociale, a aujourd’hui encore une audience particulière mais aussi une légitimité forte.
L’usage et la captation du « gaullisme social », comme mot-valise du parfait équilibre entre la droite et la gauche, est donc évidemment politique. C’est une expression qui répond aux nécessités d’une époque où les Français, après avoir goûté à la globalisation, recherchent un État qui protège face aux crises comme aux marchés concurrentiels, et en même temps, un État qui préserve leur identité, leurs particularismes, face à une sorte d’uniformité culturelle, économique, sociale, qu’on cherche à nous imposer.
Alors faut-il préserver, coûte que coûte, les particularités françaises ? Ou faut-il, au contraire, rechercher l’efficacité en allant vers le copier-coller de modèles étrangers ? Je crois que, dans ce débat, le discours gaulliste résonne de manière particulièrement évidente aujourd’hui : volonté de dépasser les clivages politiques, souci de la grandeur du pays et de la défense de son modèle si unique, mais aussi recherche d’une concorde sociale, qui soit le ferment de l’unité nationale, il y a là un véritable programme politique !
1848 : UNE RÉVOLUTION SOCIALISTE AU SERVICE DES TRAVAILLEURS ?
news.movim.eu / LeVentSeLeve · Tuesday, 11 April, 2023 - 20:39
Pour l’anniversaire de la révolution du 25 février 1848, dans laquelle la France s’embrase à nouveau dans un élan romantique et social et proclame à nouveau la République, Le Vent Se Lève organisait une journée de conférences en partenariat avec la Fédération Francophone de Débat. Dans la loi du 25 février 1848, on peut lire les mots suivants : « Le gouvernement provisoire de la République française s’engage à garantir l’existence de l’ouvrier par le travail. Il s’engage à garantir du travail à tous les citoyens. Il reconnaît que les ouvriers doivent s’associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur travail. Le gouvernement provisoire rend aux ouvriers, auxquels il appartient, le million qui va échoir à la liste civile. ». Le droit du travail, proclamé avec fracas, n’a pas tardé à diviser le mouvement socialiste naissant et la bourgeoisie libérale, qui avaient mené ensemble la révolution de 1848. La dernière conférence est dédiée à cet enjeu. Redécouvrez ici cette discussion entre Hugo Rousselle Nerini, Christos Andrianopoulos et Frédéric Thibault.
Robespierre et Danton : revisiter le destin tragique des géants de la Révolution
news.movim.eu / LeVentSeLeve · Monday, 10 April, 2023 - 12:22 · 14 minutes
« Mon cher Danton, si dans les seuls malheurs qui puissent ébranler une âme telle que la tienne, la certitude d’avoir un ami tendre et dévoué peut t’offrir quelque consolation, je te la présente. Je t’aime plus que jamais et jusqu’à la mort ». L’auteur de ces mots n’est autre que Robespierre. En février 1793, il offre à Danton son épaule amicale après le décès de sa première épouse. Il poursuit : « Faisons bientôt ressentir les effets de notre douleur profonde aux tyrans qui sont les auteurs de nos malheurs publics et de nos malheurs privés ». Un an plus tard, Danton allait finir à l’échafaud après une lutte intense contre les robespierristes. Cette unique lettre connue de Robespierre à Danton a été acquise le week-end du 12 mars dernier par un collectionneur privé 1 . L’État n’a pas choisi de la préempter, comme l’ont déploré plusieurs historiens et personnalités publiques 2 . Depuis la Révolution, la relation entre ces deux protagonistes fascine. Mais au-delà de son caractère romanesque, qu’a-t-elle à nous dire des dilemmes de la Révolution ? La biographie croisée Danton-Robespierre : le choc de la Révolution écrite par Loris Chavanette (Passés composés, 2021) est l’occasion de s’y replonger.
« Que s’est-il passé entre toi et moi ? Nous qui avions souhaité les mêmes choses…
– Nous n’avons jamais souhaité les mêmes choses vous et moi ».
Ce dialogue, tiré du film La Révolution française (Robert Enrico et Richard Heffron), imagine ce qu’ont pu être les derniers mots échangés entre Danton et Robespierre à l’aube de la bataille décisive qui allait emporter le premier. Conformément à la légende noire, c’est Robespierre qui tient le rôle sinistre. C’est lui qui clôture cette ultime entrevue par une phrase lapidaire, un vouvoiement qui dit toute la distance froide qu’il place entre Danton et lui, une menace tranchante comme le couperet de la guillotine qu’il prépare pour son adversaire.
Cette lecture classique des évènements de l’an II (1793-1794) est certes renouvelée mais pas vraiment modifiée par la nouvelle étude publiée par Loris Chavanette. D’ailleurs, ce dernier tombe d’accord avec Robespierre pour expliquer que Danton et lui ne « nourrissaient pas totalement les mêmes idées » (p. 263). Pour expliquer ces divergences, Chavanette renoue avec la méthode de l’historien romain Plutarque en proposant la biographie des deux vies parallèles de Danton et Robespierre. Deux parcours qui ne se croisent que par intermittences mais qui paraissent toujours rester dans l’ombre l’un de l’autre jusqu’au dénouement tragique.
L’ouvrage de Chavanette met en scène ces destins romancés en faisant la part belle aux mythes qui jalonnent les biographies des deux personnages. Ainsi, il raconte les manières différentes dont les deux futurs députés ont vécu le sacre de Louis XVI, le 11 juin 1775 alors qu’ils étaient encore adolescents. D’un côté, il met en scène la fugue de Danton qui quitta sa pension à Troyes pour assister à la cérémonie dans la cathédrale de Reims.
De l’autre, il reprend la légende d’un Robespierre, jeune élève de Louis-le-Grand qui aurait prononcé l’éloge destiné au roi lors du passage en calèche sur la route du sacre. Bien qu’il joue avec cette mythologie, l’auteur considère que les légendes qui entourent Robespierre et Danton ont, sinon un fond de vérité, en tout cas une origine et une diffusion qui dit quelque chose de ce qu’ils furent aux yeux de leurs contemporains.
Plus largement, Loris Chavanette se livre à un exercice original : celui de la constitution d’une biographie totale. Une étude qui, sans se prétendre exhaustive, aspire à embrasser du regard toutes les dimensions des personnages. Leur enfance, leur éducation et le début de leurs deux carrières d’avocats sont largement prises en compte pour peindre le tableau de leur genèse. La biographie évite ainsi l’écueil qui consisterait à faire naître Danton et Robespierre en 1789.
Elle livre une analyse méticuleuse de ce que furent leurs vies avant la Révolution. L’intérêt porté à la différence d’éducation entre la pédagogie avant-gardiste dont a bénéficié Danton et l’austère bachotage dans lequel Robespierre fut plongé paraît assez pertinent pour expliquer leurs divergences intellectuelles. L’ouvrage s’intéresse aussi aux vies privées que mènent les deux jeunes magistrats, à Arras pour Robespierre et déjà à Paris pour Danton. Il montre comment ce dernier joue un coup d’avance en se constituant un réseau dans la capitale avant que la révolution n’éclate.
En ce sens, cette étude tranche avec les plus récentes biographies consacrées à l’Incorruptible. Un chapitre entier sur les douze est dédié au « corps, ce miroir ». Il contient beaucoup de développements autour de l’apparence physique des personnages ou plutôt autour de leurs représentations dans la peinture et la littérature. Le but étant de comprendre comment ces deux figures ont marqué physiquement leurs contemporains. L’auteur examine d’abord Danton. Il explique que sa voix de stentor, sa face de bouledogue et sa « présence physique colossale » 3 ont été autant d’atouts qui lui ont permis d’incarner la révolution plébéienne.
Prenant le contre-pied de l’historiographie récente, Chavanette restitue un caractère exceptionnel à la répression politique de l’an II. Il redonne à la Terreur la majuscule qu’elle avait perdue avec les travaux de Jean-Clément Martin
À côté d’un tel volcan, Robespierre fait pâle figure. Son visage paraît insipide tandis que ses yeux « très voilés » posent un regard « vague et flottant » (Lamartine) 4 continuellement troublé par un clignement désagréable des paupières. Rien donc qui ne soit en mesure de retenir quelque attention. En fait, cette description de Robespierre souligne l’absence d’un corps physique dans cet « homme-idée » tout en abstraction 5 . Par contraste, elle met en évidence l’ascendant physique que Danton a pris sur ses rivaux. Un ascendant qui lui permet de devenir le héros du peuple des faubourgs – le « ventre de Paris » (Victor Hugo) – dès les premières semaines de la Révolution.
De plus, l’implication physique et directe de Danton dans les évènements révolutionnaires est soulignée par opposition à l’empreinte théorique et discursive imprimée par Robespierre. L’action personnelle de Danton dans la journée du 10 août 1792 – qui marque le renversement de la monarchie en France – est particulièrement mise en valeur. L’auteur détaille les multiples efforts du député pour coordonner l’insurrection jusqu’à la prise du palais des Tuileries.
Clairement, Danton apparaît comme le soldat de la guerre extérieure et Robespierre comme le prêtre de la régénération intérieure. Le sabre et le goupillon de la Révolution. Cette analyse fait écho au dialogue imaginé par Victor Hugo dans Quatre-Vingt-Treize. À la question de savoir où se trouve l’ennemi de la Révolution, Danton s’y exclame : « Il est dehors et je l’ai chassé » ; et Robespierre de répondre : « Il est dedans et je le surveille ».
De ce point de vue, l’étude de Chavanette vient replacer Danton et Robespierre au sommet de la Montagne. Elle démontre que si le couloir de la Révolution était trop étroit pour deux héros, ce n’est que lorsque la tête et le corps de celle-ci ont marché ensemble qu’ils ont balayé l’ancien monde. La complémentarité des deux Jacobins est démontrée tandis que leur différence de tempérament est constamment mise en exergue. Néanmoins, cette opposition physique et psychologique entre « deux types humains radicalement opposés » 6 , si elle est largement étayée, paraît exagérée à certains endroits. Surtout, son omniprésence dans le livre conduit à minorer des divergences plus significatives : l’opposition philosophique et politique des deux députés de Paris.
Par ailleurs, l’auteur présente une opposition philosophique irréconciliable entre Danton et Robespierre. Notamment dans leur rapport divergent à la religion. Cet enjeu métaphysique commence par unir les deux députés avant de les diviser. Pour l’auteur, leur opposition commune à la déchristianisation menée par les sans-culottes doit ainsi être retenue comme l’élément décisif expliquant leur ultime rapprochement à la fin de l’hiver 1793-1794.
Mais alors que Danton agit ainsi pour renouer avec l’ancienne religion, l’hostilité de Robespierre envers l’activisme sans-culotte obéit à une autre motivation. Il s’agirait pour lui de n’inaugurer rien de moins qu’un nouveau culte. Son ambition serait de fusionner « la régénération des hommes à la volonté divine ». Robespierre est un croyant fervent dans l’immortalité de l’âme et son Dieu, l’Être Suprême, est le Dieu vengeur qui libère « les humbles et les affligés » 7 . Loris Chavanette assimile le nouveau culte de la raison à une vérité religieuse comparable à la croyance catholique. Cette thèse est cependant nuancée par d’autres auteurs comme Marcel Gauchet qui le considère plutôt comme une religion civile destinée à favoriser la communion des citoyens par-delà leurs différences spirituelles 8 .
L’auteur exploite aussi la question théologique pour établir un parallèle entre la terreur religieuse de l’Ancien Régime et la terreur politique de la jeune République. Prenant le contre-pied de l’historiographie récente, Chavanette restitue un caractère exceptionnel à la répression politique de l’an II. Il redonne à la Terreur la majuscule qu’elle avait perdue avec les travaux de Jean-Clément Martin 9 et d’Annie Jourdan 10 . L’auteur dresse un réquisitoire contre la politique robespierriste 11 . Pour cela, il n’hésite pas à piocher dans l’argumentaire conçu par ceux-là même qui ont participé à la chute de l’Incorruptible avec notamment l’affaire Théot 12 . Plus généralement, l’auteur occulte les éléments pouvant contrebalancer la violence politique de l’Incorruptible.
Ainsi, il accuse ce dernier d’avoir voulu envoyer les Girondins au tombeau 13 alors qu’il protégea plusieurs dizaines de leurs députés lors des journées révolutionnaires des 31 mai et 2 juin 1793. Il n’insiste pas sur la condamnation de « l’exagération » des « ultra-révolutionnaires » que Robespierre renouvelle à de nombreuses reprises 14 . Il ne note pas non plus que ce dernier s’oppose aux représentants en mission les plus violents comme Carrier à Nantes ou Fouché à Lyon. Il obtient pourtant le rappel de ces proconsuls dans le but d’arrêter « l’effusion du sang humain, versé par le crime » 15 .
Danton comme Robespierre ont été deux Jacobins et deux montagnards. C’est-à-dire des des républicains « avancés » prônant des idées sociales considérées comme radicales par leur époque.
Rien de tout cela n’est réellement pris en compte par l’auteur qui renouvelle – en l’étayant – l’image d’Épinal attribuant une chaleureuse humanité à Danton et une froideur totalitaire à Robespierre. Loris Chavanette rappelle pourtant que Danton a d’abord été à la pointe de la « surenchère » révolutionnaire. Et ce, depuis les premières insurrections jusqu’aux massacres de Septembre 16 . Mais il excuse la violence dantoniste car elle serait le produit d’un contexte, une « violence révolutionnaire voulue par les circonstances » quand Robespierre défendrait une violence « érigée en système d’éradication des impurs » 17 . Un contexte qu’il refuse par contre d’expliquer lorsqu’il s’agit de Robespierre.
L’étude néglige ainsi largement le rôle et l’influence des révolutionnaires les plus radicaux, « l’opposition de gauche », aux Jacobins dans le cours des évènements. C’est la principale limite de la simple dualité Danton-Robespierre pour analyser la Révolution. Victor Hugo avait en plus convoqué Marat pour comprendre 1793. Il semble donc impossible de ne pas étudier davantage Hébert et ses Exagérés pour comprendre 1794. La Convention, même dominée par la Montagne, vit sous la menace permanente de ces radicaux, susceptibles de déclencher une insurrection sans-culotte.
Les députés sont donc contraints d’afficher une fermeté politique s’ils ne veulent pas passer pour des traîtres et être ainsi renversés. C’est sous l’effet de cette tension que la Convention déploie une répression qui vise aussi à canaliser la violence plus grande encore des meneurs sans-culottes. Indiscutablement, Robespierre n’est pas le dernier à souscrire à cette violence. Danton qui a institué le tribunal révolutionnaire n’y renâcle pas particulièrement non plus.
C’est donc peut-être qu’il aurait fallu chercher ailleurs que simplement dans leur rapport à la violence ce qui distingue les deux hommes. Notamment en se posant la question des fins politiques concrètes de Danton et Robespierre. Celles qui justifieraient, selon eux les moyens violents qu’ils ont soutenus. Cette question ne trouve qu’une réponse très partielle dans cette étude. L’auteur traite exclusivement de la politique sous l’angle de la violence répressive. Il n’en retire ainsi que les portraits d’un Danton indulgent et d’un Robespierre fanatique.
De ce point de vue, cette biographie renoue avec ces deux images telles qu’elles ont été façonnées par la III e République et telles qu’elles ont majoritairement survécu. L’auteur avait vu dans la victoire de Robespierre sur Danton en avril 1794, la preuve que l’Incorruptible avait compris mieux que l’Indulgent la véritable nature de la Révolution. C’est-à-dire, son caractère de « guerre sociale » 18 . En refermant l’ouvrage, on ne peut que regretter que cet enjeu n’y ait finalement pas été davantage développé.
À plusieurs reprises, l’auteur justifie la réalisation de son étude par un constat. Celui de l’intérêt toujours renouvelé pour les personnages de Robespierre et de Danton. Un intérêt qu’il explique de la façon suivante : pour lui, Robespierre serait plus que jamais actuel en raison de la demande croissante de « transparence » et de la « mode des dénonciations ». Face aux affaires de corruption et à l’opacité de la vie politique, la figure de Robespierre continuerait ainsi de catalyser une volonté citoyenne de reprendre le contrôle sur la technocratie.
De son côté, le personnage de Danton camperait la résistance à cette abolition de la frontière entre la vie publique et les affaires privées. Là encore, cet enjeu soulevé par l’auteur et par son préfacier Emmanuel de Waresquiel nous paraît être pertinent. Pour autant, il ne nous semble pas être l’écho le plus important de la Révolution française parvenu jusqu’à nous. Danton comme Robespierre ont été deux Jacobins et deux montagnards. C’est-à-dire des révolutionnaires ardents et des républicains « avancés » prônant des idées sociales considérées comme radicales par leur époque.
Tous les deux partageaient une haine de l’aristocratie à laquelle ils opposaient l’idée d’une République permettant aux citoyens d’accomplir leur destination. Il aurait été intéressant que cette étude nous expose les visions que ces deux révolutionnaires se faisaient de la propriété, de la répartition de celle-ci et des inégalités économiques. Dans notre moment de crise sociale aiguë, une telle analyse pourrait en tout cas ne pas être inutile.
Notes :
1 Loris Chavanette, « “Je t’aime plus que jamais et jusqu’à la mort” : la lettre de Robespierre à Danton raconte une part de l’histoire de France », Le FigaroVox , 10 mars 2023.
2 Tribune collective, « La préservation de l’unique lettre de Robespierre à Danton est une cause nationale », Le Monde , 21 mars 2023
3 Loris Chavanette op. cit. p.81
4 Alphonse de Lamartine cité par Loris Chavanette op. cit. p.83
5 Marcel Gacuhet, Robespierre : l’homme qui nous divise le plus , Paris, Gallimard, coll. « Ces hommes qui ont fait la France », 2018.
6 Loris Chavanette, op. cit. p.423
7 Loris Chavanette cite ici l’historien Jules Michelet. P.62
8 Marcel Gauchet op. cit.
9 Jean-Clément Martin, La Terreur : vérités et légende , Paris, Perrin, 2017, 240 p.
10 Annie Jourdan, Nouvelle histoire de la Révolution , Paris, Flammarion, coll. « Au fil de l’histoire », 2018, 656 p.
11 L’objectif de l’étude est ainsi de « démontrer le rôle central qu’a joué Robespierre […] dans la dérive répressive »
12 Catherine Théot est une mystique française qui affirmait voir en Robespierre le précurseur du nouveau messie. Elle a été emprisonnée et utilisée pour ridiculiser le culte de l’Être Suprême et peindre Robespierre sous les traits d’un dictateur en puissance.
13 « Il ne fait aucun doute [que Robespierre] rumine intérieurement un verdict de mort contre les Girondins », Loris Chavanette op. cit. (p.288)
14 Marcel Gauchet op. cit.
15 Loris Chavanette op. cit. p.402
16 Début septembre 1792, face à l’imminence de l’invasion prussienne, la panique s’empare d’une foule révolutionnaire qui envahit les prisons et massacre ainsi plus d’un millier de contre-révolutionnaires mais aussi des prisonniers de droit commun. La responsabilité de certains discours révolutionnaires, comme ceux de Danton ont parfois été pointés du doigt pour expliquer l’ampleur de la violence populaire.
17 Loris Chavanette p.394
18 Loris Chavanette p.293
 chevron_right
chevron_right
L’ADN de Beethoven cachait un étonnant secret de famille
news.movim.eu / JournalDuGeek · Wednesday, 29 March, 2023 - 10:00


Près de deux siècles après sa mort, Ludwig van Beethoven continue de susciter un vif intérêt chez les historiens modernes. Des chercheurs sont tombés sur un étonnant secret de famille.
 chevron_right
chevron_right
Envolez-vous à la découverte de l’histoire de Flight Simulator
news.movim.eu / Korben · Saturday, 25 March, 2023 - 08:00 · 2 minutes

Saviez-vous que Microsoft a publié plus de dix simulateurs de vol différents ?
Le dernier Microsoft Flight Simulator est d’ailleurs sorti en 2020, mais connaissez-vous les débuts de ce jeu mythique ?
Pour le découvrir, il y a ce projet libre nommé FSHistory , qui va vous permettra de jouer aux quatre premiers Flight Simulators de 1982 à 1989.
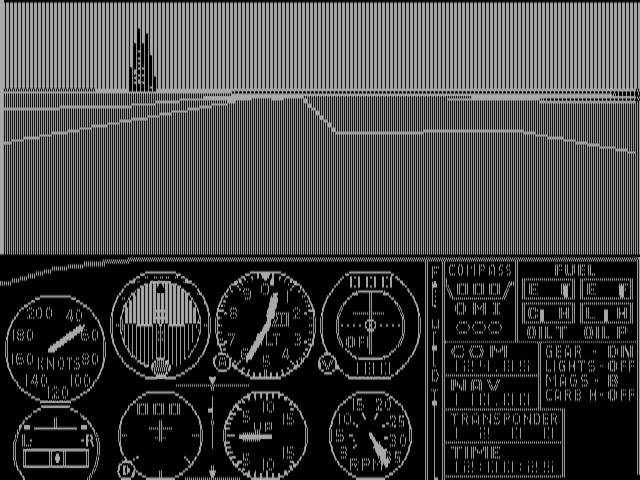
La première version de Flight Simulator a été publiée en novembre 1982. Développé par Sublogic, ce simulateur de vol proposait des graphismes en fil de fer monochromes, des paysages simplistes et une expérience de jeu rudimentaire. Néanmoins, il a été salué à l’époque pour son réalisme. Puis en 1984, Microsoft a sorti Flight Simulator 2.0 pour les PC IBM. Cette version incluait des améliorations mineures par rapport à la première version, notamment en termes de graphismes et de simulation plus précise en général. Elle prenait en charge les entrées de joystick et de souris, ainsi que les moniteurs RVB (graphismes CGA à 4 couleurs), les ordinateurs IBM PCjr et (dans les versions ultérieures) les graphismes Hercules et les écrans LCD pour ordinateurs portables.
Le nouveau simulateur a également étendu la couverture de la région simulée à l’ensemble des États-Unis.
En 1988, Microsoft a sorti Flight Simulator 3.0, qui offrait une expérience de vol améliorée en ajoutant des avions et des aéroports supplémentaires à la zone simulée trouvée dans Flight Simulator 2.0, ainsi que des graphismes EGA améliorés et d’autres fonctionnalités provenant des versions Amiga/ST. FS3 a permis pour la première fois aux utilisateurs de visualiser l’avion de l’extérieur, grâce à la prise en charge de vues externes. Cette version comprenait également un programme pour convertir les anciens disques de paysage de Sublogic en fichiers de paysage, qui pouvaient alors être copiés dans le répertoire FS3, permettant ainsi à l’utilisateur d’étendre le monde FS.
Enfin, la version 4.0, sortie fin 1989, a apporté plusieurs améliorations par rapport à Flight Simulator 3.0, notamment des modèles d’avions améliorés, des modèles de temps aléatoires et des fonctionnalités de paysages dynamiques. La version de base de FS4 était également disponible pour les ordinateurs Macintosh en 1991.
Ce sont donc ces 4 premières versions que FSHistory veut vous emmener découvrir. FSHistory est donc un émulateur qui fonctionne parfaitement avec la souris et le clavier, et peut même fonctionner sur votre smartphone. Cependant, un vrai clavier PC avec toutes les touches qui vont bien est recommandé pour une expérience de jeu optimale.
Sur le plan technique, le projet est codé en C, ce qui est assez logique pour cette émulation de bas niveau. Le code s’exécute dans le navigateur avec seulement quelques centaines de lignes de code et la lib dos.js.
Il émule un processeur 8086 ainsi que des éléments d’un processeur 286 et 386, un clavier, une souris, un contrôleur graphique…etc. Il implémente également des fonctions DOS et BIOS similaires à celles de DOSBox.
Pour les plus curieux, sachez qu’un easter egg a été ajouté dans la version spéciale 40e anniversaire de Flight Simulator. En appuyant sur le bouton ELT d’un Diamond DA62 sur la piste, vous pouvez accéder aux quatre premières versions du jeu en DOS.

Et devinez quoi ? C’est cet émulateur FSHistory qui est intégré dans l’easter egg !
Quand la Russie, la Prusse et l’Autriche se partageaient la Pologne
ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Tuesday, 14 March, 2023 - 03:40 · 10 minutes
Par Bernard Herencia et Thérence Carvalho.
Au moment où, dans le contexte de la guerre en Ukraine, les querelles mémorielles opposant de longue date Varsovie à Moscou sont exacerbées, il est utile de revenir sur un événement ancien mais encore très vivace dans la mémoire collective polonaise : le troisième partage de la Pologne, intervenu le 24 octobre 1795.
Ce jour-là, la République des Deux Nations, qui réunissait, depuis le traité de Lublin de 1569 , le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie , est rayée de la carte. Ce n’est qu’à l’issue de la Première Guerre mondiale que les deux entités – Pologne et Lituanie – recouvreront, mais séparément, leur indépendance.
Au milieu du XVIII e siècle, la fragilité et l’éventuelle disparition de la République des Deux Nations inquiètent les grandes cours européennes. À son apogée, son territoire couvre près d’un million de kilomètres carrés, surtout composé de vastes plaines et d’épaisses forêts. Il s’agit d’un espace tampon sans véritables frontières naturelles, situé entre trois puissances avides d’expansion : l’Autriche, la Prusse et la Russie.
Sa population, estimée à plus de 11 millions d’habitants, est disparate tant ethniquement que linguistiquement et religieusement : Polonais, Lituaniens, Ukrainiens, Biélorusses, Tatars, Juifs ; mais il faut encore compter une multiplicité de communautés grecques, arméniennes et germaniques. L’essentiel de la population est rurale et vit des activités agraires ; à l’exception de Varsovie, Cracovie et Lviv, les grands ensembles urbains sont rares.
La Pologne-Lituanie est fondamentalement aristocratique avec une soumission à la szlachta , la toute-puissante noblesse polonaise. Cette aristocratie capte toutes les richesses, les honneurs et les pouvoirs politiques en se référant à une idéologie sarmatique : la szlachta serait issue du peuple guerrier scythique des Sarmates , invaincu par l’Empire romain.
Cette idéologie nourrit un esprit belliciste défenseur de la gloire de vaillants ancêtres mythifiés. Elle se traduit par une arrogance à l’endroit des étrangers et de mépris à l’égard des paysans et généralement de tous ceux vivant de leur travail.
Au plan économique, les activités sont fortement freinées par un servage enraciné et par l’insuffisance chronique d’investissements dans les infrastructures. Tandis que les voisins autrichien, prussien et russe se sont dotés d’États puissants capables de moderniser leurs économies, les dirigeants polonais n’ont pas su accroître la productivité agricole et favoriser le développement du commerce et des manufactures. Les terres sont la propriété de la Couronne (pour 15 %) et des magnats – la haute noblesse – (pour 85 %) ; mais la moitié de la szlachta reste non possédante.
En Pologne-Lituanie, le sort des paysans semble s’être détérioré dans la première moitié du XVIII e siècle, principalement à cause de l’alourdissement des corvées. L’économie du pays est largement non monétaire, avec de puissants comportements autarciques et des pratiques de dons. Les serfs ne consomment qu’une faible part de leur production tandis que les magnats profitent de leurs richesses lors de fêtes organisées pour s’attacher leurs importantes cours et confient des charges aux nobles pauvres pour assurer leurs trains de vie respectifs.
En matière juridique, la Pologne-Lituanie demeure entravée par une forte pluralité de coutumes auxquelles s’ajoutent les statuts royaux et les lois votées par la Diète . En dépit de plusieurs tentatives de codification, la république ne parvient pas à uniformiser son droit civil et pénal. Il en résulte un ordre social profondément inégalitaire au bénéfice de la noblesse et surtout des magnats. La seconde moitié du XVIII e siècle est cependant marquée par quelques progrès notables : les seigneurs perdent le droit de vie et de mort sur leurs serfs (1767) ; la torture et les procès en sorcellerie sont interdits (1776).
Politiquement, son régime hybride, mêlant républicanisme nobiliaire et monarchie élective, est source d’importants blocages et dysfonctionnements. Les citoyens aristocrates contribuent aux affaires publiques via des assemblées de districts en charge des affaires locales et de l’élection des nonces, députés à l’assemblée supérieure du royaume – la Diète – convoquée tous les deux ans. Cette institution centrale de la république, qui réunit le roi et les deux Chambres (le Sénat et la Chambre des nonces), vote les lois, les impôts, déclare la guerre, signe les traités et désigne le roi.
Ce dernier partage son pouvoir avec le reste de la Diète mais il remplit des fonctions particulières : il propose et sanctionne la loi, dirige l’armée et la diplomatie, nomme aux emplois publics et convoque les assemblées. Le monarque s’entoure de ministres qu’il nomme à vie (maréchaux, généraux, trésoriers et chanceliers) et qui tempèrent son autorité, voire constituent de véritables contre-pouvoirs. Le roi doit encore composer avec le Sénat, réunissant les évêques et des administrateurs provinciaux (palatins et castellans) en charge de le conseiller et de le contrôler.
Toutefois, la szlachta n’a eu de cesse d’élargir ses privilèges et ses capacités d’action sur les affaires publiques notamment dans l’exercice du pouvoir législatif grâce au liberum veto . Ce dispositif repose sur la recherche de l’unanimité dans les votes de la Diète et sur le principe d’une véritable égalité des droits politiques de tous les nobles. Il permet à un seul député de repousser un projet de loi, voire d’obliger toute l’assemblée à se séparer en annulant toutes les décisions de la session. Naturellement, les usages répétés du liberum veto paralysent le travail parlementaire et, par suite, le fonctionnement des institutions. Ce système politique de démocratie nobiliaire a de facto dégénéré en une oligarchie de quelques grandes familles de magnats : les Czartoryski, les Potocki, les Radziwill, les Branacki, les Poniatowski, etc.
Du point de vue militaire, la Pologne-Lituanie souffre également de handicaps structurels : son armée régulière n’est que de 10 000 hommes. Une levée en masse des nobles est possible mais pourrait être bloquée par l’usage du liberum veto . L’armée polonaise n’est ainsi guère en situation de rivaliser avec les importantes armées de ses puissants voisins. Les observateurs et voyageurs contemporains insistent généralement sur le retard et l’immobilisme de la république dans la plupart des domaines.
Le 6 septembre 1764, la Diète élit Stanislas II Auguste Poniatowski (1732-1798) roi de Pologne et grand-duc de Lituanie grâce aux manœuvres de son ancienne maîtresse l’impératrice de Russie Catherine II (1729-1796). Dès lors considéré comme une créature au service de la tsarine, sa légitimité est d’emblée fragilisée. Il est pourtant loin de n’être qu’un agent servile de la Russie. Ce prince éclairé souhaite poursuivre la politique réformatrice des Czartoryski pour renforcer l’efficacité de l’État polonais en substituant une véritable monarchie au régime en place, générateur d’anarchie dans cette république aristocratique.
La Pologne est l’un des rares États européens à pratiquer une véritable tolérance religieuse sans toutefois aller jusqu’à une égalité juridique des diverses confessions. Les nobles « dissidents » (protestants et orthodoxes) réclament les mêmes droits que les catholiques. Cette revendication sert les intérêts des Prussiens (protestants) et des Russes (orthodoxes) qui les soutiennent. Les nobles catholiques refusent cette égalité de droit qui, par l’usage de liberum veto , les rendrait dépendants des dissidents et donc de la Russie et de la Prusse.
En 1767, Nicolas Repnine (1734-1801), ambassadeur de Russie à Varsovie, manœuvre auprès de la Diète pour structurer le conflit, qui est loin de n’être que religieux, en créant des confédérations. La confédération est un dispositif politique légal dont la vocation est de créer une union nobiliaire destinée à défendre la république d’un péril intérieur ou extérieur. Repnine encourage la formation de trois confédérations : à Słuck pour les orthodoxes ; à Toruń avec les protestants ; à Radom pour des catholiques conservateurs hostiles aux réformes de Stanislas II.
Ces créations aboutissent à une Diète extraordinaire en 1767-1768 : l’égalité des droits est accordée aux non-catholiques et Catherine II est reconnue comme protectrice des « libertés polonaises ». Le 24 février 1768, un traité d’amitié et de garantie perpétuelle est signé entre la Russie et la Pologne. La tsarine s’engage à garantir les institutions politiques et le territoire polonais : la République des Deux Nations tout entière sombre alors dans la dépendance de la Russie.
Par réaction à cette tutelle de fait, une nouvelle confédération se forme à Bar (29 février 1768) pour défendre la patrie et la foi catholique. La confédération de Bar est soutenue par la France et l’Empire ottoman. Ce dernier déclare la guerre à la Russie (6 octobre 1768) à la suite d’un massacre perpétré par des pro-russes sur son territoire. L’insurrection polonaise tourne simultanément à la guerre civile et interétatique.
La situation, en contenant l’expansion russe, sert les intérêts autrichiens et prussiens. Cependant, les revers militaires se multiplient tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Lorsque la confédération est finalement vaincue, les troubles qu’elle a provoqués servent de prétexte à un premier partage du pays par un traité que Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780), Frédéric II de Prusse (1712-1786) et Catherine II signent le 5 août 1772. Entre-temps, la confédération de Bar avait cherché des appuis en France et obtenu que des intellectuels, tels Paul Pierre Lemercier de la Rivière (1719-1801), Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785) et Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) œuvrent – vainement – à des projets de réformes institutionnelles.
Au partage de 1772, la République perd un tiers de son territoire et de sa population. Le pouvoir polonais en place, toujours dirigé par Stanislas II, aspire encore à la réforme de ses institutions. La « grande Diète » de 1788-1792 œuvre à la rédaction d’une Constitution écrite.
Un Acte de gouvernement (3 mai 1791) fonde une monarchie héréditaire et non plus élective, dont la couronne reviendra à la maison de Saxe à la mort de Stanislas II. Le roi détient l’entièreté du pouvoir exécutif et assure la « garde des lois », assisté du primat, de cinq ministres et de deux secrétaires d’État. Le pouvoir législatif appartient à la Diète, permanente et bicamérale (Chambre des nonces et Sénat). Les confédérations et le liberum veto sont abolis. Les prérogatives locales et celles de la bourgeoisie sont élargies.
Catherine II s’oppose à ces réformes porteuses d’émancipation à l’égard de la Russie. Une nouvelle guerre russo-polonaise s’engage. Des magnats conservateurs soutenus par la Russie forment la confédération de Targowica . La pression militaire contraint le roi à y adhérer et à revenir à l’ordre politique ancien. La Prusse de Frédéric-Guillaume II (1744-1797) reste en retrait mais participe à un nouveau partage du territoire de la Pologne en janvier 1793 avec la Russie, qui s’opère cette fois sans l’Autriche, occupée à la guerre contre la France révolutionnaire. La Pologne est dès lors réduite à un espace d’environ 200 000 km 2 pour 3 millions d’habitants.
En réaction, le général Tadeusz Kościuszko (1746-1817), vétéran de la guerre d’indépendance états-unienne, organise et conduit un soulèvement pour libérer la Pologne. Il dirige l’armée régulière et lève plusieurs milliers de volontaires issus de la paysannerie. De premiers succès sont remportés, mais Kościuszko est blessé et capturé le 10 octobre 1794. L’insurrection est ensuite violemment réprimée par la Russie qui organise un troisième et dernier partage de la Pologne , à nouveau avec l’Autriche et la Prusse, le 24 octobre 1795. La Pologne succombe alors à la voracité de ses puissants voisins et le pays disparaît complètement de la carte européenne jusqu’à sa résurrection , en même temps que la Lituanie, à l’issue de la Première Guerre mondiale en 1918. ![]()
Bernard Herencia , Maître de conférences, chercheur en histoire de la pensée économique, Université Gustave Eiffel and Thérence Carvalho , Professeur d’Histoire du droit et des institutions, Université de Nantes
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’ article original .