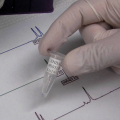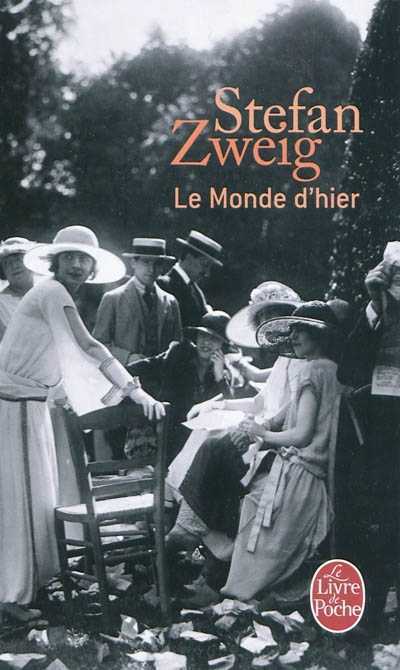-
Co
chevron_right
Écologisme, wokisme, féminisme : les leurres de l’hydre
Pascal Avot · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Thursday, 24 November, 2022 - 04:15 · 6 minutes
Si, à la suite d’ Alain Besançon, l’on considère que l’idéologie est :
- Une croyance délirante
- qui se prend pour une science exacte et
- qui entend prendre le pouvoir afin de
- mettre en coupe réglée la totalité de l’activité humaine
- dans le but ultime d’anéantir toute forme de civilisation,
nous vivons à n’en pas douter une ère idéologique.
Le mouvement woke , l’ écologisme , le féminisme , pour ne prendre que ces trois exemples les plus frappants du moment, correspondent parfaitement à la définition besançonienne de la prise d’assaut du réel par l’incendie idéologique.
Les trois ressemblent étrangement à des maladies mentales. Les trois sont persuadés d’être intellectuellement aussi rationnels, aussi certains, aussi fiables que l’astrophysique.
Les trois ont pour objectif la conquête de l’État, soit par l’élection, soit par la révolution, soit par une guerre civile froide et hybride composée de pression médiatique, de combats juridiques et d’entrisme institutionnel.
Les trois ont la ferme intention de changer le monde en changeant l’Homme, qu’il le veuille ou non.
On affirmera donc volontiers que wokisme , écologisme et féminisme sont de dangereuses idéologies. Toutefois, la prudence doit nous inciter à aborder le problème sous un autre angle.
L’histoire de l’idéologie
L’idéologie a une histoire. Elle a même une préhistoire : la Révolution française . C’est avec elle que naît la volonté enragée de quadriller la vie au nom de la Raison. Cette volonté se traduit par un système politique athée, monopolistique et tout-puissant. Et cette toute-puissance mène droit à la Terreur , à la famine et aux massacres de masses. La Révolution française met en place un prototype du totalitarisme qui servira de diapason à Lénine et à ses disciples sous toutes les latitudes.
Mais Robespierre n’a que des idées et de la rage et cela ne suffit pas : il ne dispose pas d’une idéologie suffisamment structurée, architecturée, systémique. Au pouvoir, il improvise. Il a une vision dépourvue de méthode et, malgré l’intensité de ses intuitions, il échoue.
Ce n’est qu’au XIX e siècle que ses chimères se dotent d’un squelette et d’organes et deviennent le monstre totalitaire : l’idéologie se constitue comme une science de la réalité et une science du pouvoir. Netchaïev et Bakounine , Marx et Engels , seront les premiers docteurs Frankenstein de cette évolution. Il y en aura bien d’autres par la suite.
À la fin du XIX e siècle, la bête est prête à bondir sur le monde. Selon les périodes, les pays et les auteurs, elle se nomme « social-démocratie », « socialisme », « communisme ». Le premier parti de Lénine est le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, fondé en 1898. Il compte une poignée de membres. Nul ne peut deviner qu’un siècle plus tard, descendant direct de ce groupuscule, le Parti communiste chinois, muni d’exactement la même idéologie, comptera des dizaines de millions de membres.
Tout bascule à la fin de la Première Guerre mondiale.
Faisant preuve d’un flair et d’un opportunisme impressionnants, Lénine renverse le tsarisme. À part lui et son gang, la planète entière pense que le nouveau régime bolchévique est une pitoyable farce et qu’il ne tiendra pas plus de quelques semaines. Hélas, la farce est une tragédie et elle va durer beaucoup plus longtemps qu’on ne pense et s’étendre sur les cinq continents. Malgré les succès spectaculaires de la démocratie et du capitalisme, le XX e siècle sera constamment pris en otage par l’idéologie de gauche comme Saint-Pétersbourg l’a été par les Bolchéviques. Il est fort possible que le XXI e lui ressemble.
Parfaite illustration de cette mainmise du socialisme sur l’Histoire : la Seconde Guerre mondiale . Elle est déclenchée par un socialiste, Adolf Hitler , et elle a pour conséquence l’extension cyclopéenne de l’empire d’un autre socialiste, Joseph Staline . L’alpha et l’omega de ce conflit inouï, c’est l’idéologie. C’est elle qui se répand comme une pandémie. C’est elle qui rend fous les peuples et qui les extermine. C’est elle qui invente des maux que l’humanité n’avait aucunement imaginés jusque là.
Wokisme, écologisme, féminisme : l’idéologie est contagieuse
Le dernier livre d’Alain Besançon s’appelle Contagions . L’idéologie est contagieuse. Elle progresse suivant le même schéma que la mégalomanie et la paranoïa, ces « folies partagées », comme disent les psychiatres.
Elle se transmet par la parole, par l’image, par le sentiment d’injustice, par la peur, la violence, la torsion du bon sens et le détournement de l’intelligence. Elle peut prendre l’apparence d’un bain de sang ou d’un cours de philosophie.
Impossible d’en isoler le virus, sinon dans cette formule : « S’il existe des gens malheureux, c’est parce qu’il existe des gens heureux et il suffit d’éliminer ces derniers pour que règne le bonheur universel. » Vous pouvez remplacer « gens heureux » par « bourgeois », « riches », « juifs », « chrétiens », « réactionnaires », « pollueurs », « mâles », « blancs ». L’idéologie est tout-terrain.
Les idéologies actuelles comme l’écologisme devraient-elles exister ?
C’est pourquoi il est loisible de se demander si les mouvements woke , écologiste et féministe existent vraiment : s’ils ne sont pas, tout bonnement, des excroissances conjoncturelles du socialisme et, ce qui devrait nous inquiéter, des leurres. Car plus on s’indigne pour une statue de Victor Hugo barbouillée par des imbéciles, pour un délire supplémentaire au sujet de l’empreinte carbone, ou un lynchage de plus de la mentalité masculine par des lesbiennes endurcies , moins on prend pour cible prioritaire, nécessaire et suffisante, la maison-mère de toutes ces gargouilles : le socialisme.
Greta Thunberg n’est pas Trotsky, ni Himmler, ni Pol Pot. Elle n’a tué personne.
« Ça ne saurait tarder ! », répondent les catastrophistes de droite. Pendant ce temps, tandis qu’ils s’escriment sur les trolls de la déconstruction, Xi Jinping achète la dette de notre Sécurité sociale. Et lui, des camps de concentration emplis d’innocents qui agonisent, il en a à revendre.
Comparée à la CGT qui bloque le pays à la moindre occasion, que pèse une manif d’adolescents arc-en-ciel brandissant des pétitions et des hashtags ? « Greta Thunberg, combien de divisions ? », aurait judicieusement demandé Staline. Ainsi nous égarons-nous et nous nous épuisons dans des batailles de polochons contre des dragons en mousse.
Et s’il n’y avait qu’un seul combat à mener, toujours identique depuis 1917 et qui a donné tant de héros, Churchill, Soljenitsyne , Orwell ?
On ne peut qu’être frappé par le fait que ni Le Pen, ni Zemmour, ni Pécresse, n’ont frontalement attaqué le socialisme pendant l’élection présidentielle. C’est pourtant bien lui qui hante le cerveau d’Emmanuel Macron : s’il est woke , écologiste et féministe, c’est parce qu’il est socialiste.
Certes, le président est à géométrie variable, flou, insaisissable, mais il est profondément contaminé : idéologisé.
« La langue de bois ne veut pas être crue, elle veut être parlée », écrit Alain Besançon. Elle est la langue maternelle de Macron. La dette au grand galop, le confinement aveugle, l’antiracisme de salon, c’est du socialisme.
Distraits par les innombrables gueules de l’idéologie crachant des fumées multicolores, nous ne faisons plus notre travail, le seul qui vaille : poignarder le cœur rouge de l’hydre.