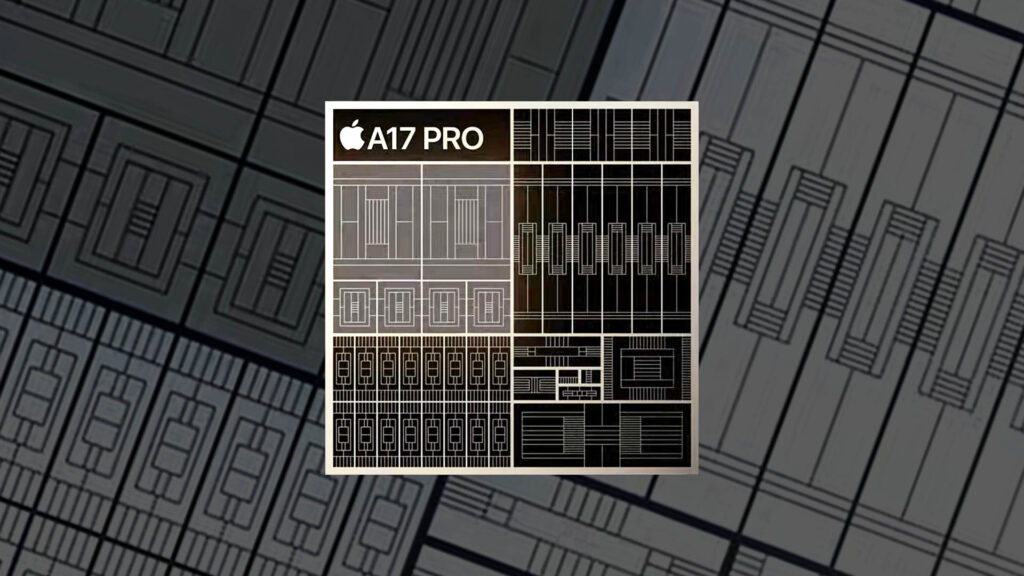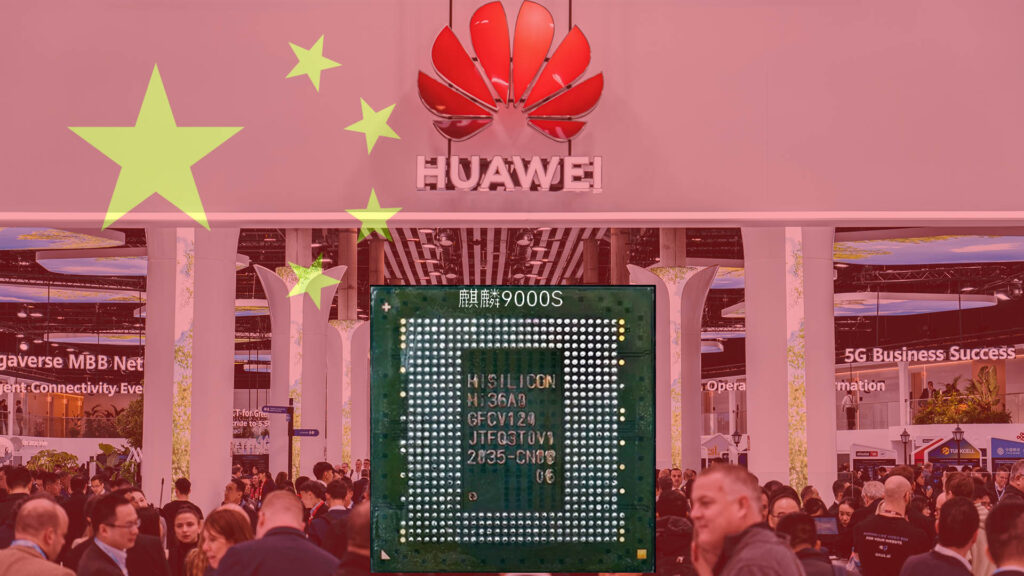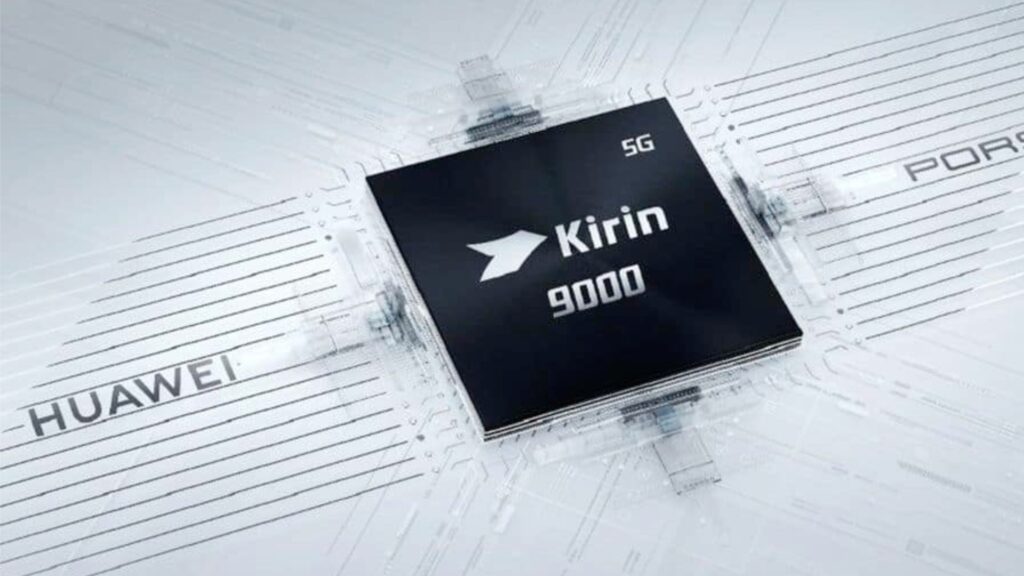Recruter des profils atypiques pour encourager l’innovation, cela semble logique : l’homogénéité de son corps social est un danger mortel pour une organisation dans un monde qui change rapidement. Enfermée dans un modèle unique qui fonctionne comme des œillères, celle-ci est en proie aux surprises stratégiques, incapable de voir le monde qui change. Logique donc, mais ça ne marchera pas car ils se heurteront aux modèles mentaux de l’organisation. Encore une de ces fausses bonnes idées qui coûtent cher à nos organisations.
L’un de mes amis a travaillé chez un grand constructeur automobile allemand. Il me racontait que les ingénieurs recrutés par la firme à la sortie de l’école arrivaient la tête pleine d’idées mais qu’au bout de six mois, ils étaient entrés dans le cadre. « La lumière s’est éteinte en eux. » Ils resteront certainement de bons ingénieurs et l’entreprise est très performante, mais seront bien dans le cadre et plus du tout atypiques. Car s’obstiner à rester atypique c’est perturber le fonctionnement du groupe et s’exposer tôt ou tard à un rejet du corps social. S’il veut rester dans l’organisation et y faire carrière, il a tout intérêt à se conformer. Il peut bien se dire que c’est pour mieux contribuer de façon atypique plus tard, mais c’est une illusion. Une lumière éteinte se rallume difficilement quelques années après lorsqu’on a basé sa réussite sur le conformisme.
Le profil atypique se heurte aux modèles mentaux
Car un nouveau recruté arrive dans une organisation qui a ses propres modèles mentaux .
Ces modèles traduisent la façon dont elle voit le monde et dont, pour simplifier, elle définit sa façon de créer de la valeur. Plus l’organisation a connu le succès, plus ces modèles sont ancrés, invisibles et considérés comme évidents, comme l’eau pour le poisson. Le conformisme est simplement le nom péjoratif que l’on donne au respect de ces modèles qui, pourtant, explique le succès jusque-là. Logiquement, un profil atypique, autrement dit qui vient avec des modèles mentaux différents, suscitera une réaction immunitaire au sens où l’organisation va se sentir mise en danger. Il n’y a aucune chance que le nouveau venu les fasse évoluer par lui-même.
Les deux options rationnelles pour lui sont alors soit de se conformer, soit de partir. Le premier choix a été dominant pendant très longtemps tant les avantages d’un travail dans une grande entreprise (sécurité, prestige, etc.) étaient grands. Mais le développement de nouvelles alternatives socialement prestigieuses, comme travailler dans une startup, et les évolutions de valeurs, font que de moins en moins d’employés acceptent de se conformer et préfèrent partir, voire de ne même pas postuler. Cette puissance des modèles mentaux explique pourquoi le recrutement de profils atypiques pour renouveler l’organisation et la rendre plus innovante est une fausse bonne idée. Toute stratégie de diversité basée sur cette croyance est vouée à l’échec.
Cette difficulté à s’appuyer sur des profils atypiques concerne également les équipes. C’est en particulier vrai dans les nouveaux domaines (RSE) ou les nouvelles technologies (IA, digital) qui souvent réclament non seulement des compétences nouvelles mais des modèles mentaux différents, c’est-à-dire des croyances différentes sur des aspects fondamentaux de l’activité de l’organisation.
Un bon exemple est celui de cette grande entreprise française qui a voulu, il y a quelques années, miser sur le big data . Prenant le train en marche assez tard, elle décide de frapper fort et recrute à prix d’or une équipe d’ingénieurs. Pour bien souligner l’importance du projet, elle installe cette équipe dans son siège social, situé dans un beau quartier de Paris. La direction générale a été claire : il s’agit de changer la culture de l’entreprise pour qu’elle soit plus « pilotée par la data » (sic). Deux ans plus tard, le projet est abandonné, l’équipe dissoute et la perte sera de plusieurs dizaines de millions d’euros. Que s’est-il passé ? Là encore, un choc de modèles mentaux et une réaction immunitaire du corps social.
L’organisation se retrouve en effet dans une situation paradoxale : les nouveaux atypiques sont encensés par la direction générale qui leur accorde un grand prestige (meilleurs bureaux, gros budgets, salaires élevés, privilèges) pour s’assurer de la réussite du projet, tandis que les anciens sont implicitement présentés comme ringards.
Or, et sans doute pour longtemps, ce sont eux qui font vivre l’organisation et en assurent le fonctionnement au quotidien. Ce sont eux qui financent les nouveaux. Pas étonnant que le ressentiment gagne et que la greffe ne prenne pas. Cet échec tient aussi à des situations que l’on pourra considérer comme anecdotiques, mais à tort. Imaginez la cafétéria le midi : les anciens, soignés et avec des habits de marque y croisent des jeunes en jean, cheveux longs, piercing et tatouages. Les deux tribus se regardent consternées l’une par l’autre. « Les barbares sont parmi nous », murmurent les premiers. « Les ringards n’ont honte de rien » se disent les seconds. Chacun est enfermé dans son modèle et tout le monde est perdant. C’est dans le réel que se noient les stratégies les plus sincères.
Recruter des profils atypiques est risqué
Le dilemme est le plus marquant au niveau du manager. La RH le presse de recruter des profils atypiques. Supposons qu’il y soit tout à fait favorable, bien conscient de la nécessité d’apporter un peu d’oxygène dans son équipe. Il a donc en face de lui un candidat atypique. Celui-ci est arrivé en retard et en jean. Il pose son téléphone sur la table au début de l’entretien. En bref, il viole d’entrée de jeu une série de codes que le manager considère pourtant comme évidents. Mais bon, celui-ci persévère. La RH l’a prévenu : ne vous laissez pas égarer par les apparences, le fond est bon. Sauf que. Le manager a une équipe à gérer. Il est responsable de son bon fonctionnement. Il va donc devoir mettre en balance, d’une part, le souhait sincère d’avoir un peu plus de profils atypiques et d’autre part, l’impératif de fonctionnement de l’équipe. Or, c’est sur ce dernier critère qu’il est évalué. Il sait que la moindre performance de son équipe sera sanctionnée collectivement. Il va donc rationnellement résister au recrutement du profil atypique. Ce qui se passe ici est que la direction générale, via la RH, a déterminé un objectif dont elle n’assume en pratique pas la responsabilité. Elle fait porter au manager le coût et le risque d’un recrutement de profil atypique. Autrement dit, elle se défausse sur lui.
Si la direction générale estime important de diversifier le corps social avec des profils atypiques, elle doit assumer le coût et le risque associés et déterminer des dispositifs de management appropriés pour que son intention soit effectivement traduite dans les faits sur le terrain. Comme je le suggère dans mon ouvrage Petites victoires , une façon de faire serait pour elle de commencer par travailler avec quelques managers volontaires et s’engager auprès d’eux à accepter des performances moindres et à fournir un accompagnement du nouveau salarié et du manager pour s’assurer que les choses se passent bien.
Pour innover, c’est l’organisation qui doit devenir atypique
Si pour être plus innovant la diversification du corps social est une nécessité évidente dans un monde complexe et en changement rapide, elle ne doit pas être faite de manière naïve.
Il ne s’agit pas tant de recruter des profils atypiques que de faire en sorte que l’organisation puisse penser et agir de manière atypique, c’est-à-dire se libérer de ses modèles mentaux. Il doit s’agir d’un effort collectif et systémique dans lequel l’engagement de la direction générale est indispensable. Se contenter de recruter des profils atypiques permettra sans doute de se donner bonne conscience mais ne mènera nulle part.
—
Sur le web
 chevron_right
chevron_right